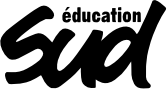- Pour commander la brochure (version papier), rendez-vous sur le site materiel.sudeducation.org (accès réservé aux syndicats)
- Téléchargez la version PDF gratuitement en cliquant ici.
L’école est à un point de bascule
L’école est à un point de bascule, elle a été largement abîmée par les cinq années Blanquer : celui-ci a supprimé presque 9000 postes dans le second degré public et il a imposé la politique des “savoirs fondamentaux” tout en imposant Parcoursup, la réforme du bac et les réformes des lycées dont les élèves comme les personnels paient encore le prix aujourd’hui. Depuis, cinq ministres se sont succédés et aucun·e ne s’est attaqué aux vrais problèmes de l’école : la difficulté à recruter des personnels, l’indigence de la formation, les bas salaires, le manque de moyens pour enseigner, la lutte contre les inégalités sociales, l’absence de politique d’éducation prioritaire…
De Gabriel Attal à Anne Genetet, le ministère de l’Éducation nationale est conduit à coup de plans de communication dont la traduction sur le terrain marque ses effets délétères : choc des savoirs, uniforme, labellisation des manuels, acte II de l’école inclusive…
Au contraire, pour SUD éducation, l’école publique comme l’enseignement supérieur sont des priorités, il faut préparer la société de demain. Dans cette brochure, SUD éducation revient d’abord sur l’état de l’école et de l’enseignement supérieur publics, et propose des réflexions sur les mesures à prendre d’urgence pour garantir un vrai service public d’éducation et d’accès au supérieur.
Ensuite, ce diagnostic de l’école et de l’enseignement public est mis en perspective avec la complaisance de l’État vis-à-vis de l’enseignement privé et de la dernière réforme éducative, celle du “choc des savoirs”.
Enfin, un focus plus important est fait sur la question centrale de la lutte contre les inégalités sociales, y compris postcoloniales.
Sommaire
- École publique en danger
- « Le choc des savoirs contre l’école publique »
- En finir avec le financement public de l’enseignement privé
- Le dualisme scolaire : d’où ça vient ?
- L’école privée, c’est 75% d’argent public !
- Quel est le rôle du privé dans la ségrégation scolaire et sociale ?
- Une mixité sociale qui ne s’embarrasse pas de la lutte contre les inégalités sociales !
- Des établissements majoritairement catholiques : de véritables atteintes à la laïcité !
- Tribune collective pour la défense de l’école publique
- Quand l’État développe le financement public de l’enseignement privé hors contrat…
- Pour lutter contre les inégalités, relancer l’éducation prioritaire !
- Le système scolaire français creuse les inégalités et contribue à perpétuer des déterminismes liés au colonialisme
- Le privé à l’assaut de l’enseignement supérieur
- Des moyens pour l’école publique, et vite !
1 - École publique en danger
L’éducation représente le plus gros objet de dépenses de l’État. C’est un enjeu majeur pour préparer la société de demain, une société plus juste socialement et écologiquement. Or on constate que les moyens engagés sont insuffisants et la politique éducative à l’œuvre creuse les inégalités. L’école est à un point de rupture, et cela a des conséquences sur la société dans son ensemble.
Les derniers gouvernements prétextent la baisse démographique pour justifier les suppressions de poste, cet argument ne tient pas face aux données de l’OCDE. Or le projet de budget 2025 présenté par Barnier prévoit 4035 suppressions de postes réparties ainsi :
· 3 155 ETP sont supprimés dans le premier degré public ;
· 181 ETP sont supprimés dans le second degré public ;
· 660 ETP sont supprimés dans le premier degré privé sous contrat ;
· 40 ETP sont supprimés dans le second degré privé sous contrat ;
· 35 ETP administratifs sont créés.
On remarque que le privé subira moins les effets des suppressions de postes que le public puisque, alors que l’enseignement privé concerne 20% des élèves, ce sont moins de 20% des suppressions de postes qui seront pris en charge par le privé.
La 1er degré devrait supporter les suppressions de postes les plus importantes selon le projet de budget 2025. Pourtant, en 2024, on compte en moyenne 18,2 élèves par enseignant·e (ce qui ne correspond pas à la taille moyenne des classes) dans le 1er degré en France tandis que la moyenne de l’OCDE se situe à 14 élèves pour un·e enseignant·e. La rentrée 2024 a vu ainsi la suppression de 650 postes, ce qui traduit la volonté du gouvernement de ne pas se rapprocher de la moyenne de l’OCDE.
Le manque de personnels enseignant·es conduit à une situation de mise sous tension permanente : les personnels ne sont plus remplacé·es et chaque absence pèse sur l’école entière. Dans le 2d degré, entre 2017 et 2023, on a compté 8 865 suppressions de postes dans le second degré, l’équivalent de 166 collèges, à rapporter aux 7441 élèves supplémentaires. Pour retrouver le taux d’encadrement de 2006, il faudrait recruter 45257 enseignant·es sur le programme 140. Selon l’OCDE, la France est l’un des pays où l’élève entend le moins bien l’enseignant·e.
Le déficit de personnels médico-sociaux est criant : 900 médecins, moins de 8 000 infirmièr·es pour 12 millions d’élèves. Moins de 20% des élèves de 6 ans passent la visite médicale, pourtant obligatoire.
De même, le ministère de l’Éducation nationale est l’un des plus mal dotés en gestionnaires au regard de l’effectif important d’agents puisque le ratio gérants-gérés est de 0,6%, soit 6 gestionnaires pour 1000 agents.
On compte près de 134000 personnels AESH, pour plus de 93% des femmes, au salaire moyen de 850 euros, et sans perspective d’évolution salariale.
L’Éducation nationale crée des postes d’AESH pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap mais ne parvient pas à les pourvoir. Chaque année, ce sont les AESH qui contactent le plus nos équipes syndicales dans les départements pour être accompagné·es dans leur démission. L’annonce des 2000 créations de postes d’AESH à la rentrée 2025 est illusoire tant l’Éducation nationale ne parvient pas à recruter.
Pour professionnaliser les missions d’AESH et répondre aux besoins de l’école inclusive, il faut reconnaître que l’accompagnement des élèves en situation de handicap est un métier et créer un statut de la Fonction publique.
Créer un statut de fonctionnaire pour 129 000 AESH avec un temps plein à 24h face élève et un salaire net à 1700 euros coûterait 0,216 milliards d’euros, soit une augmentation de 0,3% du budget du ministère de l’Éducation nationale.
En comparaison : la généralisation du SNU est évaluée de 3,5 à 5 milliards d’euros par an.

La crise d’attractivité est persistante et a des conséquences désastreuses :
· le non-remplacement fréquent : dans le bilan de la rentrée 2024, selon les académies, entre 21% et 72% des établissements manquent de professeur·es. Au niveau national, ce sont 56% des établissements qui avaient au moins un·e professeur·e manquant·e.
· la baisse de la qualité du service rendu à la population : les académies doivent recruter des contractuel·les insuffisamment formé·es.
· la perte de confiance dans le système éducatif est palpable dans la population et profite au secteur privé.
Les causes de la crise sont connues :
· des salaires trop faibles en milieu et fin de carrière et peu compétitifs avec des emplois du secteur privé ;
· le recrutement à bac+5 a asséché le vivier de recrutement et modifié sa sociologie ;
· les suppressions de postes rendent inaccessibles des mutations permettant de retourner dans leur département d’origine pour une part importante des personnels du second degré ;
· les réformes successives détériorent les conditions de travail et la qualité de la relation avec les élèves et le reste de la communauté éducative ;
À cela s’ajoutent le délabrement du bâti, l’inexistence d’une médecine du travail, et un management libéral brutal et inefficace.
Une école qui combat les inégalités sociales et les discriminations
Pour faire mieux réussir les élèves il faut améliorer leurs conditions d’études en baissant le nombre d’élèves par classe et en garantissant des classes encore moins nombreuses en éducation prioritaire. Mais il est également nécessaire d’améliorer les conditions d’étude des élèves en les accompagnant hors de la classe : tous les personnels sont nécessaires au bien-être et à la réussite des élèves. L’école manque de personnels médico-sociaux, de vie scolaire, d’AESH, de personnels administratifs et techniques.
Depuis la révision de la carte de l’éducation prioritaire en 2015 et l’exclusion des lycées de la carte, la situation s’est largement dégradée avec une homogénéisation par le bas des IPS (Indice de Position Sociale) des écoles et des collèges d’éducation prioritaire à mesure que les IPS des établissements privés n’ont cessé de s’homogénéiser par le haut. Aujourd’hui, l’octroi de moyens supplémentaires en éducation prioritaire résulte de choix académiques, de réalisation de projets portés par des personnels volontaires ou de concentration des moyens sur certains niveaux (dédoublements par exemple) au détriment des autres. La politique d’éducation prioritaire ne conçoit pas la scolarité de l’élève dans son entièreté ni dans sa continuité. De même, les politiques d’appels à projets ou de dispositifs d’excellence témoignent d’une vision méritocratique de la lutte contre les inégalités.
L’éducation prioritaire est malmenée, or elle reste la réponse la plus appropriée pour lutter contre les inégalités sociales : donner plus de moyens aux élèves des milieux les plus défavorisés afin de leur permettre d’accéder à un même service public d’éducation. On constate aujourd’hui que les classes de collège ne sont pas beaucoup moins chargées en éducation prioritaire (25,9 pour la moyenne nationale pour 24 en éducation prioritaire) et que les bâtiments y sont largement insalubres.
Le rapport de la Depp (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) de juillet 2022, mis à jour en avril 2024, au sujet de l’éducation prioritaire en France, donne des éléments sur les inégalités sociales en jeu : 84 % des collèges en REP+ et 34 % des collèges en REP accueillent au moins 60 % d’élèves d’origine sociale défavorisée, contre seulement 2 % dans les collèges publics hors éducation prioritaire.
On peut à partir des résultats au DNB mesurer à quel point les inégalités sociales produisent des inégalités scolaires : en 2022, 23,7 % des élèves des collèges REP+ et 32,3 % des élèves des REP ont obtenu une moyenne supérieure à 10/20 aux épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB), contre 52,8 % dans les collèges publics hors éducation prioritaire. De même, la carte de 2015 exclut toute une partie des écoles et des établissements dont les IPS des élèves ont évolué et qui devraient être classés en éducation prioritaire. C’est le cas de l’école Mandela à Saint-Herblain, pour laquelle SUD éducation est intervenu en CSA (Comité social d’administration) ministériel, mais aussi des écoles du Biollay (Chambéry), Notre Dame de Briançon (La Léchère), Roosevelt et Sierroz (Aix-les-Bains) dont les IPS sont semblables à ceux des écoles d’éducation prioritaire du département. Cette carte n’intégrant plus aucun lycée, elle prive également de nombreux lycées, et en particuliers grand nombre de lycées professionnels, de la politique d’éducation prioritaire, malgré des IPS inférieurs à ceux des collèges classés.
Enfin, alors que la lutte contre le harcèlement scolaire était une priorité de l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, on regrette que les paroles ne soient pas suivies d’actes. Toutes les politiques de lutte contre le harcèlement, les discriminations, les violences ou pour améliorer le climat scolaire butent sur un manque de personnels : la formation continue disparaît pour limiter les cours annulés faute de remplaçant·es, il n’y a pas assez de personnels médico-sociaux, de Vie scolaire pour accompagner, écouter et mettre en sécurité les élèves… Pour prendre un exemple concret, le défaut de formation que subissent les personnels explique en partie le chiffre inquiétant de 85% des élèves qui ne bénéficient pas des trois séances annuelles d’éducation à la sexualité.
Une école qui répond aux enjeux écologiques et de santé
L’école doit prendre sa part dans la reconversion écologique de la société : SUD éducation revendique une approche globale de la rénovation du bâti scolaire qui représente 45% du patrimoine immobilier des collectivités territoriales. Pour tenir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les 140 millions de m², où sont accueilli·es les élèves et les personnels dans les écoles et établissements scolaires, doivent être rénovés. Par ailleurs, les épisodes de canicule, qui se répètent à présent chaque année, mais aussi les inondations, mettent au jour la nécessité d’adapter le bâti pour garantir l’accès du service public d’éducation sur tous les territoires. Un rapport d’Oxfam France sur l’adaptation au changement climatique montre que 1,3 millions d’enfants en maternelle seront exposés à des chaleurs excédant 35° dans les classes d’ici 2030, soit dans 5 ans et demi.
Selon le rapport sénatorial de François Demarcq sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires datant de 2020, 40 milliards d’euros sont nécessaires pour rénover le bâti scolaire. Dans le cadre du programme EduRénov, la Banque des territoires a annoncé une enveloppe de
2 milliards d’euros pour rénover
10 000 établissements scolaires d’ici à 2027 afin d’atteindre au minimum 40% d’économies d’énergie. À cela s’ajoutent 50 millions pour accompagner les collectivités territoriales.
SUD éducation constate que l’enveloppe allouée est très insuffisante au regard des besoins chiffrés par le rapport Demarcq. Le financement des rénovations manque de transparence et d’un pilotage global qui devrait répartir les moyens en fonction des territoires, de leurs caractéristiques sociales et de leur vulnérabilité face au dérèglement climatique.
Retrouvez nos revendications et notre analyse
pour la reconversion écologique de l’école
> sudeducation.org/tracts/brochure-n92-changer-lecole-pas-le-climat
pour la restauration scolaire et universitaire
> sudeducation.org/
mobilisons-nous-pour-des-restaurations-scolaires-et-universitaires-qui-promeuvent-lagroecologie-2
Face à l’amiante, réagissons !
L’amiante est un matériau hautement cancérogène qui peut provoquer des maladies mortelles dès la première exposition. En France, il a été interdit en 1997. 85% des écoles et établissements scolaires et universitaires ont été construits avant cette date, il y a donc de l’amiante dans la plupart d’entre eux. La vétusté de ces bâtiments implique une dégradation grandissante des matériaux de construction, qui libère de plus en plus de fibres d’amiante dans l’air. Aujourd’hui, le réchauffement climatique met en lumière les problématiques d’isolation thermique des bâtiments. D’importants fonds sont débloqués pour une rénovation thermique du bâti scolaire et universitaire : cette rénovation, qui va toucher un grand nombre de bâtiments où l’amiante est présent, ne doit se faire ni en ignorant cet enjeu, ni au péril de la santé des ouvrièr·es, des agent·es, des élèves et étudiant·es.
Le scandale de l’amiante qui a retenti avec fracas dans les années 1990 est donc loin d’être terminé, et nous ne sommes encore qu’aux prémices de la catastrophe : les estimations tablent sur 100 000 décès liés à l’amiante d’ici à 2050 selon le Haut Conseil de la santé publique, qui se base sur plusieurs rapports de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), rapports rédigés par des membres de la communauté scientifique. Combien de décès dans l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche ? Il y a donc là un enjeu de santé publique majeur ! La campagne de SUD éducation contre l’amiante en milieu scolaire et universitaire témoigne de la nécessité d’un investissement massif de l’État pour procéder au recensement des DTA (dossiers techniques amiante) et aux opérations de désamiantage. Retrouvez notre campagne en une de notre site internet. Le refus de l’administration de communiquer nombre de documents administratifs (les dossiers techniques amiante, mais aussi le calcul de la répartition des moyens entre établissements, les moyens alloués au privé, etc.), pose des problèmes de transparence et de démocratie. Il y a nécessité d’obliger les collectivités territoriales à faire les diagnostics et les travaux qui s’imposent pour protéger la santé des personnels comme celle des élèves. Notre campagne a mis au jour des situations dramatiques : matériaux dégradés, actions correctives immédiates qui attendent des années, mise en danger des personnels et usagers, inertie des pouvoirs publics…
Pour financer ces travaux et aider les collectivités territoriales qui n’ont que peu de fonds, SUD éducation revendique la création d’un fonds de diagnostic et de désamiantage abondé par les industriels.

Une dépense publique par étudiant inégalitaire
La dépense publique par étudiant·e est de 8 800 € par an à l’université (en moyenne car la dépense est de 4 200 € à l’université de Nîmes contre 14 369 € à l’université Paris Saclay) mais elle est de 15 000 € par an en classe préparatoire, de 17 000 € par an à Sciences Po, de 42 000 € par an à l’École normale supérieure, et de 107 000 € à l’INSP (ex ENA). Ces inégalités de dépenses renforcent un enseignement supérieur à 2 vitesses qui reproduit les inégalités sociales et pousse de plus en plus d’étudiant·es vers les formations privées, faute de place dans le public.

Deux mesures fortes permettraient de corriger les inégalités :
• porter le financement des licences au niveau des CPGE coûterait 5 milliards d’euros
• mettre en place un salaire étudiant à 1000 € par étudiant·e, mesure évaluée aux alentours de 21 milliards d’euros.
Ces 2 mesures seraient compensables par :
• la fin du crédit d’impôt recherche (7,2 Md€) qui va pour moitié à 500 grandes entreprises privées et qui n’a aucun impact réel sur la recherche (ni même la recherche et développement dans le privé) ;
• la suppression des exonérations aux entreprises type CICE et CVAE : 20 milliards d’euros.
Crise de l’ESR public
Le nombre d’étudiant·es sur les dix dernières années a augmenté de 16%. Mais sur la même période, le nombre de personnels n’a lui augmenté que de 2,3%. Le taux d’encadrement s’est effondré de 12% entre 2008 et 2021, avec des inégalités énormes : 4,21 pour 100 étudiant·es à l’université de Nîmes, contre 14,39 pour 100 à l’université Paris Saclay ; soit un rapport de un à trois. Il faudrait désormais ouvrir plus de 11 000 postes pour retrouver les taux d’encadrement de 2010. Il faut également construire 10 universités de proximité notamment pour permettre un réel maillage territorial et des possibilités de poursuite d’études. Un effort de recrutement de 10 000 enseignant·es chercheur·ses et 10 000 BIATSS est nécessaire dès maintenant pour accueillir les 300 000 étudiant·es sans fac ou dans des formations très éloignées de leurs vœux. Une loi de programmation budgétaire avec une trajectoire de recrutement de 60 000 personnels supplémentaires sur 10 ans constitue la revendication centrale de l’intersyndicale de l’ESR.
Depuis des années, les budgets de l’ESR sont très largement insuffisants et bien loin de l’objectif des 3% du PIB. Ces choix budgétaires mettent en danger l’ESR public, la formation des étudiant·es et les conditions de travail des personnels. Une politique de casse du service public profite aux formations privées qui se développent de plus en plus (voir 6/Le privé à l’assaut de l’enseignement supérieur).
2 - « Le choc des savoirs contre l’école publique »
Le 5 décembre 2023, l’ex-ministre Attal a fait une série d’annonces destinées à “élever le niveau des élèves” en réponse aux “mauvais résultats” de l’enquête PISA. Ces résultats montrent, d’une part, un décrochage en français et en mathématiques plus important en France que dans la moyenne des autres pays de l’OCDE et, d’autre part, que la France est l’un des 6 pays de l’OCDE où l’origine sociale pèse le plus sur les résultats des élèves. Les élèves issus de milieux défavorisés sont toujours sur-représentés dans les filières professionnelles. Mais plutôt que de donner davantage de moyens pour la scolarité des élèves les plus fragiles en raison de leurs difficultés scolaires et/ou sociales, d’une histoire familiale liée à l’immigration, de leur handicap, l’ex-ministre Attal fait le choix de mesures qui sanctionnent, qui sélectionnent et qui trient ces élèves. La politique éducative du ministère répond aux pressions de la droite libérale et réactionnaire et de l’extrême-droite en reprenant leurs propositions.
Au contraire, SUD éducation porte des revendications pour lutter contre les inégalités sociales en améliorant les conditions d’études des élèves : baisse du nombre d’élèves par classe, formation des personnels, accompagnement médico-social des élèves, reconnaissance du métier d’AESH par la création d’un véritable statut…
PISA montre l’ampleur des inégalités sociales à l’œuvre à l’école et le gouvernement a choisi avec sa réforme “choc des savoirs” de les aggraver !
Dans le premier degré, le ministère est tout à la fois revenu à une pratique régulière du redoublement « à l’ancienne » dont l’utilité est loin d’être prouvée, a écrit de nouveaux programmes avec des objectifs annuels renforcés et a décidé de contrôler davantage l’utilisation des manuels.
On assiste en effet à une véritable inflation du volume des programmes de français et de mathématiques dans le premier degré, programmes qui ne se contentent plus de fixer les objectifs d’apprentissage généraux mais détaillent les situations-types à présenter aux élèves, prescrivent des attendus chronométrés (nombre de mots à lire, nombre de calculs à réussir, etc.) et multiplient les exemples normatifs : le ministère a constaté que les petits guides colorés envoyés dans les écoles n’étaient pas assez utilisés et il décide donc de les copier/coller dans les programmes ! Les projets de nouveaux programmes de français sont ainsi trois fois plus longs en cycle 1 et deux fois plus longs en cycle 2 tandis que les projets de nouveaux programmes de mathématiques sont sept fois plus longs en cycle 2 et dix fois plus longs en cycle 1. Cela risque de laisser peu de place aux autres domaines d’enseignement… Cette incroyable prolixité, qui rapproche plutôt ces nouveaux programmes d’un manuel scolaire ou d’un guide d’application (au total presque 100 pages de programmes rien qu’en mathématiques de la petite section au CE2 !), trahit à la fois une défiance vis-à-vis du travail des professeur·es des écoles (dont la liberté pédagogique se trouve remise en cause par des dizaines de pages prescriptives) et une volonté de cadrer très fermement les rythmes d’apprentissage.
Jusqu’alors les programmes fixaient les objectifs à atteindre ; désormais ils risquent de fixer aussi les méthodes à employer et les activités à pratiquer.
Conjuguée à la labellisation des manuels scolaires, cette inflation des programmes s’inscrit dans la même logique que l’ensemble des mesures du « choc des savoirs » : formater les enseignements, fixer des normes d’apprentissage et écarter, de fait, les élèves qui ne peuvent pas s’y conformer. Avec un tel volume d’injonctions pédagogiques, comment aménager des possibilités d’adaptation au rythme des élèves ? comment prendre en compte les élèves en difficulté ? Comment aménager les activités scolaires pour les élèves à besoins particuliers ?
Dans les contenus, les programmes de cycle 1 marquent une étape supplémentaire dans l’élémentarisation de l’école maternelle, qui se retrouve jusque dans le vocabulaire employé : le domaine « mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » devient « français » et « acquérir les premiers outils mathématiques » devient « mathématiques ». Il ne s’agit pas là d’un simple effet de mode terminologique (comme le remplacement de « lexique » par « vocabulaire ») mais bien d’une évolution du regard porté sur l’école maternelle, qui est peu à peu transformée en une simple école préparatoire au CP.
En cycle 2, outre la surenchère normative, l’évolution la plus notable concerne les programmes de mathématiques, qui sont censés faire la part belle à la « méthode de Singapour ». Cela se traduit par l’introduction précoce de certaines notions (en particulier les fractions et l’écriture décimale des nombres) et par une description détaillée des méthodes à employer en numération et en résolution de problèmes.
SUD éducation exprime sa plus vive inquiétude face à ces programmes qui brident la liberté pédagogique des enseignant·es et ne prennent absolument pas en compte les rythmes d’apprentissage des élèves, au risque de nourrir le décrochage scolaire.
La même volonté de normalisation des méthodes d’enseignement se retrouve dans l’annonce d’une labellisation des manuels scolaires, à commencer par les manuels de lecture de CP à la rentrée 2024. Cette labellisation doit s’accompagner d’investissements de l’État pour favoriser l’achat de manuels en CP et en CE1. Face à ce contrôle par l’État des manuels utilisés (et qui concernera d’ici 2026 tous les manuels du CP à la terminale !), SUD éducation rappelle son attachement à la liberté pédagogique : ce sont les enseignant·es qui sont les plus à même de choisir la méthode et les outils les plus adaptés à leurs élèves et à leur approche pédagogique.

Le démantèlement du collège unique est une revendication de la droite et de l’extrême-droite. Le collège unique est un acquis social, c’est l’assurance pour tous les élèves d’avoir accès à un même enseignement, qu’importe leur origine et leur milieu social, afin de combattre les déterminismes sociaux. L’hétérogénéité des classes est l’instrument de l’élévation du niveau moyen. Pour mettre en œuvre ce projet de démocratisation scolaire, il faut donner les moyens nécessaires, or on constate un abandon de l’éducation prioritaire ainsi que la suppression de 8865 postes dans le second degré depuis 2017 alors que le nombre d’élèves a augmenté de 7441 élèves.
Une des mesures phares du “choc des savoirs” est la création de groupes de niveaux, de besoins ou hétérogènes en français et en mathématiques en 6e et 5e. La mobilisation a permis de faire reculer le ministère dans sa volonté d’imposer strictement cette mesure comme Blanquer l’avait fait pour ses réformes des lycées. Le ministère a fini par accepter une plus grande souplesse dans la mise en oeuvre de ces groupes puisqu’il n’est pas parvenu à imposer le tri des élèves aux enseignant·es : on constate que 2/3 des collèges n’ont pas appliqué les groupes tels qu’ils avaient été annoncés par Gabriel Attal. Cette situation reste inacceptable et va à l’encontre de l’égalité de traitement des élèves sur le territoire puisque leurs conditions d’études résultent de la capacité de leurs enseignant·es à amoindrir cette mesure.
Par ailleurs, on constate que pour financer ces groupes en français et en mathématiques, les autres disciplines ont perdu les heures leur permettant d’enseigner en demi-effectif sur certaines heures. Ce sont des pertes d’heures pour les langues vivantes, les sciences ou le français et les mathématiques en 4e et en 3e, qui ne permettent plus de travailler l’oral, de faire des expériences, de la méthodologie.
Les groupes de niveau sont particulièrement préjudiciables pour le service public : la recherche a montré que l’enseignement en groupes de niveaux a des effets délétères sur le niveau moyen des élèves. Les résultats des élèves les plus performant·es n’augmentent pas et, au contraire, les résultats des élèves en difficulté s’effondrent car les enseignant·es nivellent leurs attentes vers le bas dans ces groupes.
L’organisation en groupes de niveaux/de besoins/hétérogènes casse les dynamiques d’apprentissage des classes, fragilise les élèves et désorganise les collèges. On peut citer le bilan catastrophique de la casse des groupes-classes au lycée. C’est aussi une casse en profondeur de nos métiers puisque les enseignant·es de français et de mathématiques n’auront plus de classe en charge mais des groupes de niveau qui pourront évoluer au cours de l’année : est-il toujours possible d’être prof principal·e ou de travailler sur un projet interdisciplinaire si l’on n’a pas de classe ?
Attal a voulu aller plus loin dans le collège “à la carte” qui sélectionne les élèves avec des scolarités aménagées autour du lire-écrire-compter, mais aussi avec des “prépa-lycée” qui tendent à externaliser la difficulté scolaire hors de la classe ordinaire dans des dispositifs qui enferment les élèves dans leurs difficultés scolaires. La rentrée 2024 a montré l’échec de ce dispositif de prépa-seconde puisque celles-ci n’ont pas trouvé leur public. Pire encore, dans certaines, ce sont des élèves qui ont obtenu le DNB mais qui étaient sans affectation qui y ont été scolarisés.
Enfin, le ministère entend agir sur le brevet pour lui donner à terme un vrai rôle de sélection sociale (obtention indispensable pour accéder au lycée, renforcement du poids des notes dans le contrôle continu, abandon des consignes de corrections académiques…). Si la fin des consignes de correction académique a bien été appliquée sur la session 2024 du DNB, mettant au jour un effondrement des notes dans les territoires les plus défavorisés, la transformation du DNB devrait être repoussée à 2028, c’est-à-dire après les élections présidentielles. En attendant, le ministère souhaite revoir le Socle et les programmes.
La politique éducative du ministère de l’Éducation nationale est particulièrement inquiétante : la ministre Anne Genetet répète sans cesse qu’elle veut “élever le niveau”, néanmoins elle refuse d’agir sur les véritables causes des difficultés scolaires. PISA a montré que ce n’était pas tant le niveau qui avait baissé mais les inégalités scolaires qui s’étaient creusées. Dès lors, il faut une politique éducative qui réponde spécifiquement aux enjeux des inégalités en agissant dans les territoires défavorisés via l’éducation prioritaire. Enfin, le ministère semble n’avoir pas compris à quel point l’école s’est transformée du fait de l’inclusion scolaire : il y a pourtant urgence à donner les moyens aux personnels pour accueillir véritablement tou·tes les élèves dans les classes.

3 - En finir avec le financement public de l’enseignement privé
« Je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l’école Stanislas […] Notre aîné, Vincent, a commencé comme sa maman à l’école publique, celle de Littré. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu un paquet d’heures qui n’étaient pas sérieusement remplacées […] À un moment on en a eu marre comme des parents de milliers de famille qui ont fait un choix d’aller chercher une solution différente », narre Amélie Oudéa-Castéra, fraîchement nommée ministre de l’Éducation nationale, en janvier 2024. La polémique est lancée : l’école Littré, où étaient scolarisés les enfants de l’ex-Ministre, n’a pas souffert des non remplacements. La ministre a donc dénigré le service public d’éducation pour justifier son choix de scolariser ses enfants dans le privé. La polémique se poursuit avec la diffusion par Mediapart d’un rapport accablant de l’inspection générale de l’Éducation nationale sur le collège Stanislas où sont scolarisés les enfants de la Ministre : on y lit des exemples de non-respect de la liberté de conscience et des programmes, et le rapport relate des choix et des comportements qui entretiennent des stéréotypes de genre. Un débat s’ouvre alors sur le financement de l’école privée et sur les carences en matière de contrôle des établissements privés.
En effet, depuis 2017 on observe, d’une part un embourgeoisement des établissements privés et en parallèle une dégradation de la mixité sociale dans les établissements publics, et d’autre part, un manque de financement et d’ambition pour l’école publique qui contraste avec les 10 milliards d’argent public attribués chaque année au privé.
En 1959, la loi Debré établit la possibilité de passer des contrats d’association entre les établissements d’enseignement privé et l’État. L’État s’engage à rémunérer les enseignant·es et à prendre en charge les frais de fonctionnement de ces établissements qui doivent en retour dispenser un enseignement conforme aux programmes et garantir la liberté de conscience et l’égal accès de tou·tes les élèves.
La loi Debré intervient dans un contexte de très forte augmentation du nombre d’élèves du fait de l’extension de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans : c’est une loi de transition adoptée pour faire face à une situation d’urgence. Elle tend également à remplacer progressivement les enseignant·es religieux par des enseignant·es laïcs. Avant 1959, les établissements privés sont globalement financés par les contributions religieuses et celles des familles. Les écoles privées, appelées “écoles libres” depuis la charte constitutionnelle de 1830 par opposition aux écoles publiques, ne reçoivent aucuns fonds de l’État.
Le dualisme scolaire naît officiellement avec la loi Falloux du 15 mars 1850 qui distingue les écoles publiques et les écoles privées dites “libres” et garantit l’utilisation des fonds publics pour les écoles publiques uniquement, sauf dans son article 69 qui prévoit un plafonnement du financement public des établissements privés à hauteur de 10% maximum des dépenses annuelles de l’établissement. La loi Gobelet du 30 octobre 1886 réaffirme la distinction de financement entre les établissements publics et les établissements “libres”.
La loi Debré rompt avec les lois précédentes et sera suivie de toute une série de lois qui accroissent le financement public des établissements privés. Récemment la loi Blanquer pour une école de la confiance qui abaisse la scolarité obligatoire à 3 ans a eu pour conséquence des transferts d’argent public aux maternelles privées du fait de l’obligation pour les communes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées dont le financement public était facultatif avant. De même avec le Pacte, dont on observe que malgré une enveloppe paritaire (400 millions pour le privé), il a permis de financer davantage l’enseignement privé que le public, et on constate que les établissements privés, moins contrôlés que ceux du public, ont utilisé le Pacte pour rémunérer d’autres missions.

En 2022, l’enseignement privé aurait perçu 13,8 milliards d’euros, dont au moins 10,4 milliards d’argent public : 8,5 milliards viennent de l’État et 1,9 milliards des collectivités territoriales. La somme allouée au privé est en hausse en 2024 puisque l’État a déjà versé 9 milliards d’euros au privé. Entre 2014 et 2024, le programme 139 du ministère de l’Éducation nationale qui finance le privé a augmenté de 27%.
Le rapport parlementaire de la mission d’information sur le financement public de l’enseignement privé présenté par Paul Vannier et Christopher Weissberg le 2 avril 2024 montre le défaut de transparence dans l’utilisation des fonds publics pour financer l’enseignement privé, en particulier dans l’utilisation des fonds des collectivités territoriales.
Il y a par exemple une forte pression du privé pour augmenter le forfait externat à la charge des communes et pour y inclure la cantine. Il est également très difficile de vérifier si les dotations des collectivités territoriales sont bien utilisées pour financer l’externat ou si, au contraire, l’établissement les utilise pour financer son “caractère propre”, c’est-à-dire son caractère religieux.
Le scandale de l’établissement Stanislas où étaient scolarisés les enfants de l’ex-ministre Amélie Oudéa-Castéra montre à quel point il est complexe de rompre un contrat d’association, alors même que des manques graves sont constatés : non respect de la liberté de conscience, non respect des programmes, des choix et des comportements qui entretiennent des stéréotypes de genre…
Enfin, l’État finance directement l’inclusion scolaire dans le privé puisque les personnels AESH rémunérés par l’Éducation nationale peuvent être affecté·es indifféremment dans le public comme dans le privé.
Les défenseurs de l’enseignement privé utilisent souvent l’argument selon lequel le coût par élève est plus fort dans le public que dans le privé, néanmoins il faut fouiller la réalité derrière les chiffres. Le coût par élève est plus faible dans le privé que dans le public car la masse salariale y est moins coûteuse (moins de personnels agrégé·es, davantage de contractuels et de personnels à temps incomplet, pas d’éducation prioritaire), les filières professionnelles les plus coûteuses se trouvent dans le public et le bâti scolaire est pris en charge après les collectivités territoriales contrairement au privé.
Le modèle français reste toutefois atypique parmi les pays de l’OCDE puisqu’aucun autre pays ne finance autant l’enseignement privé en le contrôlant si peu. L’État finance lui-même la mise en concurrence du service public d’éducation, hors de tout contrôle. Cette situation résulte en partie de la complaisance des gouvernements pour l’enseignement privé catholique et/ou bourgeois. Jean-Michel Blanquer a suivi sa scolarité à Stanislas, les enfants de Pap Ndiaye sont scolarisés à l’École alsacienne, établissement parisien privé laïque sous contrat où étudiait Gabriel Attal.

Au début des années 1960, on comptait 1,3 million d’élèves dans le privé, ils sont 2 millions en 2022, soit 17% des élèves.
13,4% des élèves du premier degré sont scolarisés dans le privé contre 21% dans le second degré.
L’implantation du privé est très hétérogène selon les territoires et a évolué depuis 2017 : on compte plus de 50% d’établissements privés en Vendée alors qu’ils sont moins de 5% dans la Creuse. Selon le chercheur Julien Grenet dans son rapport “L’école publique a‑t-elle encore un avenir à Paris ?”, il pourrait y avoir plus d’élèves scolarisés dans le privé que dans le public d’ici 10 ans à Paris. Le fort développement du privé a une forte incidence dans les établissements publics. On constate que le privé rural et moins bourgeois ferme peu à peu au profit d’un privé plus urbain destiné aux élèves des milieux aisés.
En 2021, 40,1% des élèves scolarisés au sein des collèges privés sont issus de milieux très favorisés contre 19,5% des élèves des collèges publics. De même, à la rentrée 2022, l’IPS moyen des élèves est plus élevé de 15 à 20 points dans le privé. Le secteur privé est responsable à hauteur de 33 à 45% selon les territoires de la ségrégation sociale entre les collèges.
À Paris, la ségrégation sociale des collèges résulte à 5% d’inscriptions dans le public mais hors secteur, à 49% de la ségrégation spatiale ou résidentielle et à 46% des inscriptions dans le privé.
La publication des Indices de Positionnement Sociaux (IPS) en octobre 2022 a montré le lien entre enseignement privé et ségrégation sociale : lorsqu’un collège favorisé est situé près d’un établissement défavorisé, dans 85% des cas c’est un établissement privé. De même, les établissements de REP+ accueillent un public homogène aux IPS bas et les établissements privés accueillent un public homogène aux IPS élevés puisqu’ils scolarisent 40% des élèves favorisés. Les collèges publics non classés accueillent des élèves aux profils plus hétérogènes.
Dans l’enseignement privé catholique, les moyens du premier et du second degré sont fongibles, contrairement aux dotations publiques où le premier et le second degré constituent deux programmes budgétaires distincts. Ainsi l’enseignement privé catholique s’emploie à concentrer ses moyens dans le second degré, et particulièrement en lycée pour attirer les élèves les plus aisés mais aussi pour capter les bons élèves du public.
L’enquête menée par France info et publiée en septembre 2024 au sujet du meilleur financement des lycées privés expose l’exemple du lycée public Victor Duruy à Paris qui dispose d’un H/E (nombre d’heures par élève) de 1,04 heure par élève alors que le lycée privé Stanislas, à peu près similaire en termes de taille et de composition sociale a un H/E de 1,16. Le lycée public Duruy bénéficie d’une centaine d’heures de cours hebdomadaires en moins, c’est autant d’options ou de dédoublements de classe qui ne seront pas proposés à Duruy mais qui le seront à Stanislas. L’enquête montre que dans 19 académies sur 24, le nombre d’heures par élève (H/E) est plus élevé dans les lycées privés que dans les lycées publics. Alors que les réformes Blanquer ont largement abîmé le lycée et que le nombre d’élèves par classe a explosé, la liberté de répartition des moyens dans l’enseignement privé permet aux lycées privés de rester compétitif. De même, dans son rapport de 2023, la Cour des Comptes notait que : « certains rectorats sont contraints d’accepter des ouvertures de classes proposées par le réseau catholique ou d’autres réseaux, qui leur paraissaient parfois difficilement compréhensibles ».
Les sociologues Stéphane Bonnéry et Pierre Merle ont également montré que l’enseignement privé a été mieux doté que le public pour faire face au baby boom des années 2000 puisque l’enseignement public a perdu 56000 postes d’enseignant·es depuis 1998, soit 7% de baisse alors que le privé n’a perdu que 3800 postes, soit une baisse de 2,6%. Cet effort particulier de l’État pour le privé lui a permis de scolariser davantage d’élèves.
Nous rencontrons à présent une baisse démographique avec une baisse du nombre d’élèves dans le premier degré, le privé va devoir se montrer encore plus compétitif et capter toujours plus d’élèves du public pour justifier sa masse salariale. La dégradation du service public d’éducation sert bien entendu cette politique au profit du privé.
Pendant son bref passage au ministère de l’Éducation nationale, l ’ex-ministre Pap Ndiaye avait voulu ouvrir le dossier de la mixité sociale, néanmoins il n’était pas question pour l’ancien ministre de revenir sur la racine du problème : le dualisme scolaire.
Le ministère envisageait au contraire la signature d’un protocole avec le Secrétariat général de l’enseignement catholique pour augmenter le nombre d’élèves issus de milieux défavorisés dans le privé. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement catholique a pris l’engagement d’augmenter de 50% d’ici 5 ans le nombre d’établissements proposant des tarifs adaptés aux revenus des familles défavorisées pour multiplier par deux le nombre d’élèves boursiers. Ainsi l’ex ministre Pap Ndiaye a participé à organiser la fuite des meilleurs élèves de l’éducation prioritaire vers le privé.
Pour atteindre cet objectif de démantèlement de l’école publique, Pap Ndiaye avait annoncé six mesures : la publicité par l’Éducation nationale des tarifs du privé, l’augmentation de la part d’élèves à besoins particuliers dans le privé, l’implantation du privé dans les quartiers socialement mixtes, une communication renforcée entre les académies et le privé et enfin un encouragement des collectivités territoriales à attribuer les mêmes aides sociales (cantine, transports…) aux élèves du privé qu’à ceux du public et à financer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments scolaires du privé. Elles ont donné lieu à la signature d’un plan Mixités en mai 2023 entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, à nouveau on peut s’interroger sur le caractère laïque d’un tel accord.
Ce plan est particulièrement particulièrement scandaleux dans le contexte de sous-financement de l’école publique.
On constate à travers les échanges qui ont eu lieu sur le sujet en 2023, que le ministère conçoit la mixité sociale comme une politique au service de l’enseignement privé. Au contraire, SUD éducation revendique la réouverture du dossier de l’éducation prioritaire : il faut donner aux écoles et aux établissements scolaires des quartiers défavorisés les moyens de lutter contre les inégalités sociales et non donner plus de moyens au privé pour qu’il capte les meilleurs élèves du public !
Pour SUD éducation, il est plus que jamais temps de reprendre le débat sur la fin du dualisme scolaire :
• en mettant fin au financement public de l’enseignement privé
• en nationalisant l’enseignement privé, sans indemnité ni rachat, et en transférant ses personnels dans les corps correspondants de l’enseignement public

On constate que l’enseignement privé est actuellement très majoritairement catholique : 96% des 7500 établissements privés sont catholiques, 35000 élèves sont scolarisés dans du privé laïque, 25000 élèves dans des établissements juifs, 15000 élèves dans les établissements d’enseignement en langue régionale, 3000 élèves dans des établissements protestants, 1300 dans des établissements musulmans.
Le rapport Vannier-Weissberg met en lumière une pratique qui porte atteinte au principe de laïcité et qui n’est pas prévue par la loi Debré. En effet, l’État entretient une relation privilégiée avec le SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique) dont le secrétaire général est nommé par la Conférence des évêques de France.

Depuis la loi de 1905, l’État “ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte” or ici l’État entretient un dialogue de gestion, non pas avec chaque établissement privé par le biais des rectorats comme cela est prévu par la loi Debré, mais avec un réseau d’enseignement catholique nommé par le pouvoir clérical. On parle d’une “confessionnalisation” de la relation entre l’État et les établissements privés. À SUD éducation, on considère que cette pratique aggrave l’atteinte à la laïcité que constitue déjà le financement de l’enseignement privé par l’argent public.
Chaque année, la DAF (Direction des Affaires Financières du ministère de l’Éducation nationale) négocie avec le SGEC la répartition des moyens sur les territoires. L’atteinte à la laïcité est double puisque l’État négocie avec un réseau confessionnel et, puisqu’il privilégie le réseau catholique au détriment des autres réseaux : il applique des procédures distinctes selon les réseaux et selon les religions, et sans que cela ne soit permis par la loi.
Une fois les moyens négociés avec la DAF, le SGEC élabore une proposition de répartition des moyens entre académies pour le premier et le second degré confondus. Il peut ainsi privilégier une stratégie d’implantation dans certains territoires ou dans le second degré où il peut concentrer davantage de moyens afin de garantir de meilleures conditions d’études à un public aisé. Le partenariat privilégié entre l’État et le réseau d’enseignement catholique permet à l’enseignement catholique de choisir stratégiquement comment et où répartir les moyens pour attirer davantage d’élèves comme le montre l’enquête de France info de septembre 2024 sur les moyens des lycées privés.
Une fois que l’enseignement catholique s’est servi généreusement dans la répartition globale du privé, il reste une enveloppe gardée par le ministère pour les réseaux hors enseignement catholique pour ouvrir de nouvelles classes. On constate que le réseau catholique ouvre davantage de classes que tous les autres réseaux confondus.

Les affaires des lycées Averroès et Stanislas montrent bien la différence de traitement entre les établissements catholiques et musulmans.
Voici la déclaration commune Sud Éducation 59 et Sundep Solidaires académie de Lille au sujet du lycée Averroès :
Le 6 décembre 2024 le préfet de Région a décidé de procéder à la résiliation du contrat d’association du lycée Averroès à la rentrée 2024.
Les syndicats Sundep Solidaires Sud Enseignement privé 59 – 62 et Sud Éducation Nord s’associent pour réaffirmer l’une de leurs revendications fondamentales : un service public unique de l’Éducation incluant l’ensemble des personnels sous statut de la fonction publique.
Cependant, nos syndicats dénoncent la décision du préfet de procéder à la résiliation du contrat d’association du lycée Averroès. Cette décision intervient dans un contexte politique dans lequel les Français·es de confession musulmane sont accusé·s de communautarisme et rendu·es responsables de tous les dysfonctionnements de notre société. Cette islamophobie est instrumentalisée pour masquer les questions importantes : casse du service public, pauvreté croissante liée à la baisse des salaires et du pouvoir d’achat, urgence écologique…
Nos syndicats dénoncent le deux poids, deux mesures : la faiblesse voire l’absence de tout contrôle des établissements privés catholiques sous contrat contraste avec les nombreux contrôles et inspections réalisées au lycée Averroès. L’utilisation du forfait d’externat dans l’enseignement privé catholique sous contrat n’est jamais vérifiée, les subventions aux établissements privés de la région ou des départements ne répondent jamais à des décisions dont les priorités d’investissement seraient décidées démocratiquement, la bonne exécution du contrat n’est jamais évaluée (journées de travail payées aux enseignant·es sur des activités liées à l’aspect confessionnel, recrutement sur des bases confessionnelles…).
Les motifs invoqués par le préfet pour résilier le contrat du lycée Averroès relèvent plus de l’insinuation que de l’argumentation. Ils négligent le dernier rapport de l’inspection générale de 2020, qui fait l’éloge de l’engagement pédagogique des enseignant·es et de l’équipe éducative du lycée Averroès. Le rapport signale aussi qu’« aucun de ces jeunes n’a paru soumis à une quelconque contrainte ; au contraire beaucoup font preuve de maturité ».
Cette décision plonge les personnels de droit privé et enseignant·es dans une situation où leur avenir professionnel est remis en cause : l’arrêt des subventions liées au forfait d’externat pose la question de leur éventuel licenciement. Les enseignant·es ne sont pas assuré·es de retrouver un emploi à la rentrée prochaine, la garantie de l’emploi n’existant pas dans l’enseignement privé sous contrat.
Les syndicats Sundep Solidaires Sud Enseignement privé 59 – 62 et Sud Éducation Nord apportent leur soutien au collectif de défense des personnels d’Averroès et au CSE (comité social et économique) de l’établissement, qui ont présenté un recours en annulation en référé de la décision du préfet.
Ils estiment qu’en l’état le maintien du contrat d’association est la meilleure solution pour assurer un fonctionnement sous un contrôle normal du rectorat et des autres institutions compétentes.
SUD éducation est signataire avec la FSU, la CGT Educ’action, l’UNSA Education, l’Association des libres-penseurs de France, Céméa, le Comité nationale d’action laïque, la Coopérative des idées 93, la FCPE, la Fédération nationale des DDEN, la Fédération nationale de la libre-pensée, la Jeunesse en Plein Air, la Ligue des droits de l’homme, le Réseau français des villes éducatives, Solidarité laïque, la Ligue de l’Enseignement, le Mouvement national lycéen, l’Union étudiante, l’Union nationale des étudiants de France, l’ Union syndicale lycéenne, de la tribune ci-après.
École de toute la jeunesse, l’École publique, laïque, gratuite et obligatoire doit être LA priorité du pays.
Elle doit assurer l’égal accès de toutes et tous aux mêmes enseignements, dans les meilleures conditions sur l’ensemble du territoire. Cela passe par des politiques qui assurent la mixité sociale et cassent les phénomènes de ghettoïsation et de séparatisme social. Seule l’École publique laïque scolarise tous les jeunes. Il est plus que temps de cesser de les diviser. L’enseignement privé sous contrat, financé à 73 % par l’argent public, sépare les élèves. Ceux de familles très favorisées, en constituaient 26,4 % des effectifs en 2000, ils en représentent 40,2 % en 2021. Les élèves de milieux favorisés ou très favorisés y sont majoritaires (55,4 % en 2021 contre 32,3 % dans le public). Le public scolarise trois fois plus d’élèves boursiers (29,1%) que le privé (11,8%)1. La concurrence inégale et faussée de l’enseignement privé sous contrat participe à la ghettoïsation, notamment des quartiers populaires. Le financement collectif du séparatisme social et scolaire n’est pas acceptable, l’argent public doit aller à l’École publique. Cela permettra notamment une gratuité complète effective, particulièrement utile à la scolarisation des élèves des familles les plus défavorisées.
Redonner espoir et ambitions à toute la jeunesse, nécessite de concrétiser partout les visées émancipatrices de l’École publique laïque.
Elle ne se défie pas de ses élèves. La laïcité scolaire doit leur permettre d’entrer dans une dimension réflexive et critique dans laquelle, dans le cadre de la loi, leurs questionnements ou avis sont légitimes et mis en perspective par les programmes et les enseignements.
Laïque bien avant la République, l’École publique fait le choix des savoirs et de la raison pour participer à la construction de l’esprit critique et d’une pleine liberté de conscience. Elle promeut l’égalité de genre et combat toutes les formes de discriminations et de racismes. Des citoyens et citoyennes, formé·es, dans le cadre républicain du principe de laïcité peuvent ainsi faire obstacle à toutes les dominations.
Faute de moyens et d’ambition pour son développement, faute d’une défense véritable face aux attaques qu’elle subit de la part des réactionnaires de tous bords, l’École publique laïque est aujourd’hui abimée, y compris par des réformes et expressions gouvernementales.
L’École publique laïque n’incarne pas un idéal éthéré derrière lequel se réfugier à chaque drame pour mieux poursuivre ensuite les politiques de son affaiblissement. Les attentats islamistes comme les offensives réactionnaires (dans lesquelles fondamentalismes religieux et extrême droite sont très actifs) contre des enseignements, des établissements et des personnels, le relativisme scientifique galopant, la désinformation, rappellent les enjeux démocratiques inhérents au renforcement de l’école laïque. Les politiques publiques, y compris de l’institution scolaire, doivent cesser de l’affaiblir.
Pour une école pleinement utile à la jeunesse, il faut investir dans la formation initiale et continue de tous les personnels, dans une revalorisation sans condition de leur rémunération, leur garantir un cadre de travail respectueux de leurs hautes qualifications et de leur personne. Il faut des actes pour assurer la protection, le respect et la valorisation des personnels comme de leurs métiers.
L’École publique laïque doit recevoir les moyens humains et matériels lui permettant de faire vivre ses ambitions intellectuelles et civiques.
Elle crée les conditions de l’émancipation en protégeant de tout prosélytisme et en faisant cesser en son sein toutes les assignations. Cela doit être préservé et expliqué. Y faire venir, étudier, s’épanouir tous les jeunes doit être une exigence nationale. Ce n’est pas le projet de celles et ceux qui prétendent défendre la laïcité de l’école, soit pour stigmatiser les musulmans, soit pour y perpétuer leurs tutelles morales, religieuses, sociales, économiques. Face à ces défis, il faut que le principe de laïcité et les conditions de son application, permettent l’accueil de tous les élèves sans discriminations et sans concessions à l’égard de toutes les formes de pressions ou de prosélytisme.
L’incarnation quotidienne de la laïcité à l’école ne doit en aucun cas la dénaturer en la faisant passer pour ce qu’elle ne peut pas être, une règle disciplinaire ou une doxa parmi d’autres. L’école laïque doit faire percevoir l’utilité pour toutes et tous du principe de laïcité.
Il est urgent que la République soutienne pleinement son école, la seule école de toute la jeunesse vivant dans ce pays. Ensemble nous nous tenons debout, afin de construire le rapport de force nécessaire pour réaliser partout les ambitions de l’École publique laïque.
1·Cour des comptes, Rapport public thématique, L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT, Juin 2023.
Communiqué du 16 octobre 2024 de la FSU, UNSA, FO, CGT Educ’Action, SNALC, SUD éducation, FCPE, JPA
La loi « avenir pro » de 2018 a permis la promotion des écoles de production. Le gouvernement veut les développer en renforçant le financement public de ces établissements privés hors contrat et ainsi atteindre la centaine d’ici 2028.
Lors du Conseil supérieur de l’Éducation le 10 octobre, l’examen de leur reconnaissance par l’État était à nouveau à l’ordre du jour. Les représentant·es des organisations syndicales et des associations de parents d’élèves, ont une fois de plus dénoncé le développement important de ces écoles privées et le financement public dont elles bénéficient. Alors que dans le même temps, l’enseignement professionnel public voit diminuer ses moyens, que toute l’Éducation est soumise à une cure d’austérité, et que plus de 13 000 élèves dont 9 000 en lycée professionnel, sont resté·es dans l’attente d’une affectation en lycée à la rentrée faute de capacités d’accueil suffisantes dans le réseau public, ce financement du privé hors contrat est scandaleux.
Les écoles de production ne connaissent pas la crise !
Ces écoles bénéficient massivement de l’argent public, par l’usage gratuit d’équipements municipaux et surtout sous la forme de subventions. L’argent public semble couler à flot dans une totale opacité ! Les collectivités territoriales (régions, métropoles, communautés de communes, municipalités…), l’État, via les directions régionales de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DREETS), et tous les dispositifs de financement comme « France relance » ou le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire, sont mis à contribution. Alors qu’un·e élève en lycée professionnel public coûte en moyenne 13 760€, certaines écoles de production affichent 29 700€ par personne, soit plus du double, financés à 85% avec des fonds publics.
Les coûts de formation, astronomiques, peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d’euros par an et par élève, un montant nettement supérieur à ceux de la scolarisation d’un·e élève en LP, ce qui n’empêche pas un taux de décrochage très important.
Au-delà d’un modèle économique fondé sur la captation de fonds publics et la défiscalisation de fonds privés via le mécénat, il s’agit aussi de confier la formation de jeunes à des entreprises locales, sans autre ambition que de répondre à une demande locale. Il s’agit de promouvoir un modèle de formation éculé, la formation « sur le tas » d’une main d’œuvre qui travaille gratuitement pour des entreprises et sans la protection juridique que confèrent les statuts de stagiaires ou d’apprenti·es. Quid des enjeux de sécurité au travail, de lutte contre le harcèlement et contre les violences sexistes et sexuelles ? Quid de la qualité des contenus enseignés et de leur exhaustivité ? Tout cela apparaît visiblement comme secondaire à des ministres et des élu·es, qui promeuvent, chaque fois qu’ils et elles le peuvent, ces écoles avec force d’inaugurations en grande pompe et d’interviews dans la presse régionale.
Pour les organisations et associations FSU , UNSA, FO, CGT Educ’Action, SNALC, SUD, FCPE, JPA, il est urgent de mettre fin à ce système qui gaspille l’argent public et organise l’exploitation de jeunes, très souvent mineur·es, pour une formation sans aucune garantie de qualité et de réussite aux examens. Tout cela relève de la gabegie et de l’escroquerie ! Pour obtenir une première qualification professionnelle par un diplôme, gage d’une formation professionnelle et générale globale et émancipatrice, le financement alloué à ces écoles de productions doit cesser et revenir à l’École publique.
4 - Pour lutter contre les inégalités, relancer l’éducation prioritaire !
Sujet de vantardise pour les différents gouvernements Macron parce qu’unique preuve de sa politique « sociale » vis-à-vis de l’école, le dédoublement des CP-CE1 et depuis peu GS en REP+ n’est pourtant pas une franche réussite dans les faits. Réalisé à moyens constants, en supprimant au passage le dispositif « + de maitres·ses que de classes » qui laissait aux équipe une flexibilité d’adaptation à leurs réalités de terrain et sans vision de la scolarité globale des élèves en difficulté, elle sert plus d’outil de communication et permet au passage de faire l’impasse sur les problématiques sociales qui sous-tendent les difficultés des élèves en REP et au-delà.
Au delà du manque de résultats flagrants chiffrés, la mise en place d’une telle réforme avec la méthode autoritaire que l’on connaît au président actuel a eu pour conséquence une application sans aucune prise en compte de la réalité du terrain : absence dans de nombreuses écoles de locaux suffisants pour de réels dédoublements, avec pour conséquence la naissance sur le tas des classes en « co-animation », mise à mal de structures d’écoles impliquant des doubles/triples niveaux cycle 2/cycle 3 qui permettaient de lisser les effectifs sur toutes les classes, faisant mécaniquement augmenter les effectifs des classes de cycle 3 ou encore dernièrement avec le dédoublement en maternelle, arrêt soudain et forcé de structures d’école avec des classes en triples niveaux dont les avantages pédagogiques sont nombreux pour les enfants.
Toutes ces conséquences, qui n’ont absolument pas été anticipées et qui ne peuvent être chiffrées, génèrent continuellement des tensions dans les équipes, entre la disparité d’effectif entre les niveaux et la prise en charge forcée de classe en « co-animation » lors de la répartition des classes entre les collègues.
La réduction de la latitude qu’ont les équipes concernant la structure d’école au prétexte de la réforme constitue une énième attaque contre le fonctionnement collégial des équipes et vient plus désorganiser les écoles qu’elle n’apporte aux élèves. On peut d’ailleurs noter qu’à moyens humains égaux dans les écoles REP mais en laissant complètement la main aux équipes sur la structure d’école à adopter comme cela était le cas avant cette réforme, le lissage des effectifs via les doubles niveaux permettrait souvent d’atteindre l’effectif idéal de 18/19 élèves par classe, mais du CP au CM2 dans ce cas là…
4.2 - Les élèves des lycées de banlieues populaires : les grand·es oublié·es de l’éducation prioritaire
La France est régulièrement épinglée dans les enquêtes internationales PISA pour le caractère profondément inégalitaire de son système scolaire. D’une part, les écarts de performance entre élèves y sont particulièrement amples ; d’autre part et surtout, ces performances sont très étroitement liées à la profession de leurs parents. Loin d’ouvrir à chacun·e une destinée sociale déconnectée de son origine, l’école reproduit les inégalités de naissance. Ainsi, à la rentrée 2021, en première et terminale générale, les enfants de cadres représentaient 35 % des élèves contre 15 % pour les enfants d’ouvriers, alors même qu’à l’entrée en 6ème la part des élèves issu·es de ces deux catégories est identique.
La politique d’éducation prioritaire et son principe consistant à « donner plus à ceux qui ont le moins » présente certes des limites en termes de réduction des inégalités. D’une part, le manque de volontarisme fait que la réduction des effectifs par classe reste minime en collège comme le résume le slogan « REP+, rien en plus ! ». D’autre part, 3/4 des élèves issus de milieux populaires en primaire et au collège sont scolarisé·es dans des établissements qui ne sont pas situés en éducation prioritaire. Mais, malgré ces imperfections, l’éducation prioritaire est la seule politique explicitement pensée pour réduire l’inégalité des chances. Sans cette politique compensatrice, les inégalités auraient progressé davantage encore : ce sont les expert·es sollicité·es par le ministère elleux-mêmes qui l’affirment. Il faut donc non seulement défendre, mais étendre l’éducation prioritaire.

Or, depuis 2016, les lycées ont été sortis de l’éducation prioritaire, la nouvelle carte publiée sous Peillon, puis Vallaud-Belkacem, les en ayant exclus malgré la mobilisation portée par le collectif Touche pas ma ZEP. Pendant plusieurs mois, ce collectif d’une centaine de lycées, totalement auto-organisé et avec le soutien des fédérations CGT et SUD éducation et de certaines sections académiques du SNES, a mené la lutte pour obtenir la mise en place d’un statut et d’une carte élargie de l’éducation prioritaire pour les lycées avec la garantie d’effectifs limités significativement, des moyens supplémentaires pour dédoubler les classes et accompagner davantage les élèves, le maintien et l’élargissement à tous les personnels d’une indemnité et de compensations spécifiques pour stabiliser les équipes.
Les ministres – nombreux·ses – qui se sont succédé·es depuis n’ont bien entendu jamais rouvert ce dossier. Depuis, on fait comme si les difficultés économiques et sociales rencontrées par nos élèves dans leur environnement social et territorial disparaissaient comme par magie durant l’été entre la fin de la troisième et le début de la seconde. Les conséquences ont été rapidement visibles dans nos établissements situés dans les banlieues populaires.
Il y a 3 ans, suite aux nouvelles attaques du rectorat de Lyon qui avait décidé de diviser par deux l’APM (allocation progressive de moyens) des lycées avec un faible IPS (indice de position sociale), des militant·es SUD éducation ont décidé de constituer un collectif des lycées des quartiers populaires du Rhône. Depuis, nous organisons chaque année des mobilisations communes pour dénoncer le manque de moyens humains dans nos établissements. Ce collectif regroupe actuellement les lycées Brel et Sembat-Seguin à Vénissieux ; Doisneau à Vaulx-en-Velin ; Faÿs et Brossolette à Villeurbanne ; et Camus-Sermenaz à Rillieux-la-Pape.
Non seulement le rectorat ne reconnaît toujours pas la nécessité de nos établissements d’avoir des classes à effectifs allégés, mais depuis quelques années, nous constatons au contraire une hausse des effectifs avec des classes pouvant aller jusqu’à 37 élèves dans des classes de filières technologiques.
Par ailleurs, en cette rentrée, le Rectorat de Lyon a supprimé près de 4 500 HSE destinées à accompagner les élèves des quartiers populaires de nos 6 établissements, ce qui met en péril de nombreux dispositifs de soutien à nos élèves, d’entraînements aux oraux du bac, de projets d’ouverture culturelle et même les heures pourtant obligatoires d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Enfin, la suppression de toute bonification pour l’exercice dans les lycées des quartiers populaires (ni prime, ni bonification pour les mutations) et la dégradation des conditions de travail et d’enseignement entraînent un fort turn-over qui complique le travail en équipe pourtant essentiel à nos élèves.
Dans le même temps, une enquête de Franceinfo nous révèle que dans notre département comportant une proportion importante d’établissements privés catholiques, les lycées privés bénéficient d’un indicateur H/E (nombre d’heures de dotation divisé par le nombre d’élèves d’un établissement) plus élevé que celui des lycées publics. Nous avons par ailleurs récemment appris que l’APM qui était jusqu’alors attribuée uniquement aux lycées publics en fonction de leur IPS était désormais utilisée pour certains lycées privés. Le rectorat choisit donc de financer les établissements privés au détriment de nos élèves des quartiers populaires ! Ce manque de moyens et l’impossibilité de travailler en effectifs réduits pénalisent toujours les mêmes élèves : les filles qui ont moins d’espace de parole et ne peuvent pas prendre confiance en elles, les élèves les plus fragiles sur le plan méthodologique, les élèves en souffrance qu’on n’épaule pas comme on devrait pouvoir le faire. Ce sont donc toutes les inégalités sociales qui s’aggravent : sexisme, validisme, racisme… prospèrent d’autant plus que les élèves sont privé·es de leurs droits à une éducation de qualité.
Le 26 septembre dernier, nous étions à nouveau en grève avec des taux de grévistes allant de 40 à 60 % des enseignant·es et des vies scolaires fermées. Devant le succès de la mobilisation, le Rectorat nous a finalement reçu·es pour asséner sans sourciller qu’ “il n’y a aucune corrélation entre le nombre d’élèves par classe et les incidents dans vos établissements » et nous annoncer que la seule ouverture sur les moyens consistait à prendre davantage de Pactes !
Nous continuerons donc de nous battre pour le retour des lycées dans le giron de l’éducation prioritaire et pour des seuils d’effectif par classe de 25 élèves en seconde et en séries technologiques, 15 élèves en voie professionnelle et 30 élèves dans les séries générales.
Il est urgent de remettre la question de la réduction des inégalités scolaires liées à l’origine sociale au cœur de nos batailles syndicales. Notre fédération doit jouer un rôle moteur pour étendre ce combat bien au-delà des quelques établissements fortement mobilisés dans le Rhône.
5 - Le système scolaire français creuse les inégalités et contribue à perpétuer des déterminismes liés au colonialisme
L’État français a considéré l’éducation comme un instrument de francisation dans les territoires de son Empire colonial, sans prendre en compte les populations, ce qui a influencé la façon de concevoir les politiques éducatives aujourd’hui mises en place : “Éduquer mais soumettre, instruire mais subordonner”.
L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste
Avant les lois Ferry (de 1881 et 1892), l’instruction des indigènes ne figure pas au programme colonial. Jules Ferry considère que l’école pour les indigènes est le “moyen le plus efficace pour asseoir la domination territoriale de la France et pénétrer les âmes conquises”. Sa phrase du 28 juillet 1885, “les races supérieures ont un droit sur les races inférieures”, en sera le cadre.
De la fin du dix-neuvième siècle au début du vingtième, les politiques éducatives contribuent souvent à renforcer des hiérarchies raciales déjà anciennes entre colonies et métropole.
Les écoles, convaincues de la validité du modèle assimilationniste républicain, ont continué à adopter un modèle d’enseignement monolingue qui ne prend pas en considération les particularités sociolinguistiques des élèves. L’histoire euro-centrée refuse aux populations le rôle d’acteurs, niant ainsi leurs rapports au temps et aux connaissances.
L’idéologie d’une mission civilisatrice justifiait des pratiques brutales. Les enfants arrachés à leur environnement familial se retrouvaient en situation d’aliénation, d’acculturation
Une école élitiste et discriminatoire avec une histoire de la scolarisation des enfants non blancs marquée par une longue période de ségrégation dans des « écoles indigènes » missionnaires puis officielles : les petit·es « indigènes » sont exclu·es du système scolaire français réservé aux enfants des colons, et il leur est impossible de suivre les mêmes programmes ou de passer les mêmes examens.
La fin de l’indigénat et l’accession à la citoyenneté des différentes populations marquent la fin de cette époque au lendemain de la seconde guerre mondiale. Au nom de l’assimilation, l’école française telle qu’elle fonctionne en « métropole » est imposée à tou·tes.
Situation en Martinique, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte et Kanaky : échec de l’école coloniale
Malgré toutes les limites des institutions liées aux Nations Unies, l’écart dans la mise en œuvre des droits des enfants entre l’Hexagone et les dernières colonies françaises dénommées “collectivités territoires d’Outre mer” (CTOM) a fait l’objet d’une étude d’UNICEF France dont les conclusions mettent en évidence des inégalités endémiques.
En ce qui concerne l’accès à l’éducation, les CTOM accueillent 6 % de la population française adulte en âge scolaire.
Toutefois, beaucoup d’enfants restent « invisibles » aux yeux des statistiques et ne sont pas inscrits à l’école, notamment en raison de contraintes administratives, de pratiques discriminatoires, d’un éloignement géographique des écoles ou d’une prise en compte inadéquate du plurilinguisme des élèves. Bien qu’il n’y ait pas de données nationales sur le sujet, les estimations montrent que, en Guyane, environ 10 000 enfants sont hors de l’école et qu’ils seraient entre 5 379 et 9 575 dans cette situation à Mayotte.
De plus, le problème de la langue d’enseignement, qui ne convient pas aux élèves allophones, a des conséquences directes sur les aptitudes et le succès scolaire des jeunes. Près de 30 % des élèves en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique ont des problèmes de lecture, et plus de 50 % en Guyane et à Mayotte, contre seulement 12 % des garçons et 9,1 % des filles au niveau national.
Les enfants d’origine étrangère ou en situation de migration – et même s’ils devraient recevoir des mesures de protection spéciales – sont souvent victimes de discrimination et sont particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits dans les CTOM. De plus, même si la France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), elle fait toujours appel à l’enfermement administratif des familles avec enfants et des mineurs isolés dans la mise en place de sa politique migratoire. Le cas de cette exception à la loi est particulièrement fréquent à Mayotte : en 2021, parmi les 3 211 enfants détenus en France, 3 135 ont été détenus au centre de rétention de Mayotte.
« Ces inégalités au sein du territoire français sont alarmantes. Les pouvoirs publics se doivent de garantir un égal accès aux droits de tous les enfants sur le territoire, indépendamment de leur lieu de résidence. Agir pour l’effectivité des droits de l’enfant n’est pas seulement un moyen de construire une société plus juste aujourd’hui, mais un investissement pour construire nos sociétés de demain », déclare Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France.
En dépit de fortes disparités d’un territoire à l’autre, voici quelques chiffres :
• 680 000 élèves sont scolarisés dans les CTOM, soit 6 % de l’ensemble de la population scolaire française, au sein de 1 900 écoles, et 650 collèges et lycées.
• 93 % des élèves sont scolarisés dans l’enseignement public dans les DROM et 76 % dans les autres CTOM (contre 86,6 % dans l’Hexagone)
Ainsi, à Mayotte, 99,6 % des élèves sont scolarisés dans l’enseignement public alors qu’ils ne sont que 53,9 % à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’enseignement est exclusivement dans le privé hors contrat à Wallis-et-Futuna. Les Antilles et La Réunion connaissent une augmentation continue de la part de la population scolarisée dans l’enseignement privé (+7,5 % en Guadeloupe et +17,5 % en Martinique dans le premier degré entre 2009 et 2018) que le Sénat attribue à des « disparités culturelles », notamment à Saint-Martin, ou à une « méfiance envers le secteur public ». En Guyane, entre 5 900 enfants (Insee, 2019) et 10 000 enfants (Cour des comptes, 2020) sont en dehors de l’école. Il y a près de huit points de moins de scolarisation pour les enfants de 6 à 13 ans que pour la moyenne de l’ensemble du territoire national. Selon l’université Paris Nanterre, en 2023, il a été rapporté que la non-scolarisation des enfants âgés de 3 à 15 ans révolus concerne au moins 5 379 à 9 575 enfants à Mayotte. En Guyane et à Mayotte, l’accès à l’école des enfants et des jeunes est toujours limité par certains obstacles administratifs, et ce, malgré le décret n° 2020 – 811 du 29 juin 2020 qui simplifie les démarches d’inscription scolaire. Les refus d’inscription scolaire ont été dénoncés par le collectif Migrants Outre mer, la Défenseur des droits et constatés par UNICEF France. S’il y a 3 % de la population « nationale » dans les CTOM, 24 % des personnes en situation de grande pauvreté sont dans les CTOM. À La Réunion, la pauvreté touche près de la moitié des enfants (46 %). Il s’agit de 6 enfants sur 10 en Guyane et de 8 sur 10 à Mayotte, tandis que 2 sur 10 dans l’Hexagone…
Constat de l’Unesco
L’insuffisance des infrastructures scolaires et leur répartition inadéquate sur ces deux territoires est un second frein majeur à la scolarisation des enfants. Le principe de proximité des établissements scolaires du premier degré n’est pas respecté.
À Mayotte, les infrastructures font particulièrement défaut dans le premier degré.
En Guyane, les insuffisances en équipements scolaires et transports sont particulièrement criantes dans les communes de l’Intérieur, qui accueillent 20 % des enfants et jeunes. Ainsi, les enfants de ces communes sont contraints de quitter précocement leur environnement familial pour poursuivre dès le collège leur scolarité à Saint-Georges-de-l’Oyapock et à Maripasoula (Guyane), et de se rendre sur le littoral pour le lycée. Cela génère un risque important de décrochage scolaire, mais le déracinement renforce aussi la vulnérabilité des jeunes Amérindiens, avec des risques en matière de protection et de santé mentale.Des dispositifs dérogatoires visent à pallier les lacunes des systèmes actuels :
En Guyane, le dispositif des familles « hébergeantes » est présenté comme une alternative à l’internat. Le peu de contrôle dont il fait l’objet pose toutefois des questions en matière de protection.
À Mayotte, le système de rotations et le dispositif de « classes itinérantes » essaient de répondre à l’inadéquation entre l’offre et la demande en matière de scolarisation. Mais ces dispositifs peinent à relever le défi d’une éducation de qualité, en particulier considérant le manque d’offre périscolaire et de dispositifs d’éducation populaire. Enfin, la scolarisation de tous les enfants est également conditionnée par l’accès à l’hébergement, aux transports scolaires, et à la restauration scolaire. Ces services sont à la fois indispensables à la scolarisation, et un levier à fort potentiel de réduction des inégalités.
En Guyane, la question des transports est particulièrement sensible tant les distances sont grandes et les transports coûteux, dangereux, et faiblement développés. Pourtant, le manque d’infrastructures scolaires et leur répartition sur le territoire fait des transports un maillon indispensable de la scolarisation effective des enfants.
À Mayotte, dans le secondaire, seul 1 élève sur 5 bénéficie aujourd’hui d’un repas chaud. La plupart des établissements ne proposent qu’une simple collation qui constitue parfois l’unique repas de la journée.
Rentrée 2024 - 2025 de SUD éducation Guyane
Une rentrée scolaire, peu réjouissante pour le syndicat Sud-Education Guyane, qui dénonce, une situation explosive dans l’Ouest de la Guyane.
Des locaux scolaires délabrés, des salles de classe qui manquent cruellement de matériels informatiques. L’offre de formation est également remise en question, sans oublier la problématique des transports scolaires et de la restauration. La gestion des ressources humaines pose également problème.
Nous demandons que les promesses du rectorat de Guyane concernant la gestion des ressources humaines soient suivies. Trop d’agents restent encore sans réponse face à des situations administratives difficiles. Il y a une réelle souffrance d’un grand nombre de travailleurs, notamment dans les communes isolées.
Le syndicat Sud-Éducation Guyane veut également alerter sur le fait qu’il exige, une vraie revalorisation salariale pour tous, mais pas seulement :
Nous condamnons la non-scolarisation de trop nombreux enfants guyanais et exigeons le respect de la loi qui prévoit l’obligation de scolarisation, que l’on soit français ou étranger.

Petite histoire de la lutte des Écoles populaires Kanak
Épisode méconnu, l’appel au boycott de l’école coloniale et la création d’une éducation populaire kanak à l’occasion des « événements » qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie au milieu des années 1980, est l’une des rares expérimentations à grande échelle (entre 6 et 15% des enfants kanak concernés, selon les sources d’une « pédagogie sociale » par, à travers et pour le milieu).
Du boycott scolaire aux Écoles populaires kanak
En 1985, un siècle après l’instauration des lois scolaires de Jules Ferry, le vent de l’insurrection souffle sur la Nouvelle-Calédonie. Au cri de « indépendance et socialisme », le peuple Kanak, organisé au sein de FLNKS et de l’USTKE, défie le système colonial, dont l’école est un rouage essentiel, au point que « le système éducatif – le contenu des programmes, la composition du corps enseignant, etc. – est, avec la terre, le point focal des revendications et des pressions kanak. »
Pour le gouvernement indépendantiste issu des barricades, il y a « urgence [à] mettre en place une école populaire kanak » (Instruction du gouvernement de Kanaky aux Comités de lutte, 28 février 1985) pour partir à la conquête de l’indépendance éducative, culturelle, politique et économique.
Cette résolution, qui accompagne les occupations de terre et les barrages, appelle au « boycott scolaire » et invite les Comités de lutte à déserter les établissements coloniaux pour créer, investir et animer des écoles populaires kanak.
Doublement accusée de marginaliser les Kanak, en leur interdisant la réussite dans le monde des Blanc·hes et en les coupant de leurs racines, l’école, qualifiée de « difficile » par Jean-Marie Tjibaou est, avec la terre, au coeur du contentieux colonial qui éclate avec les « événements » (1984 – 1988). Au-delà de l’inadaptation des programmes, la question de la langue d’enseignement est l’objet de nombreuses crispations car le refus du monopole de la langue française comme langue de la scolarisation est perçu comme le refus de la présence française. Le déclenchement des « événements » en 1984 entraîne une politisation de la question de la place des langues et de la culture à l’école, et un durcissement des positions : alors que l’État français continue de faire la sourde oreille devant la demande réitérée d’introduire un enseignement en langues kanak, les militant·es s’organisent et décrètent un boycott de « l’école coloniale ».
Face aux blocages d’ordre politique auxquels se heurte la revendication nationaliste d’une égalité des chances à l’école et d’un respect de la culture kanak, le contexte des « événements » voit se développer une logique de rupture entraînant les militant·es indépendantistes dans une expérience d’écoles alternatives, les Écoles Populaires Kanak. L’EPK se présente comme une alternative, littéralement une « autre école », en rupture avec le système scolaire existant : il s’agit de faire l’école « autrement », en intégrant la langue d’origine des enfants, en faisant participer la communauté à l’éducation « pour que les parents se mêlent de ce qui les regarde », en respectant les savoirs autochtones et leurs modes de transmission. L’objectif est d’enraciner l’enfant dans la culture kanak et de préparer politiquement les futur·es citoyen·nes d’une Kanaky devenue indépendante. À son apogée, en mars 1985, l’EPK scolarise 1 500 à 2 000 enfants, grâce au travail bénévole de 230 animateur·rices : 12 à 15% des enfants kanak de brousse ne sont pas retourné·es à leur école habituelle à la rentrée. Mais le mouvement connaît rapidement des signes d’essoufflement : des quarante EPK qui voient le jour dans la foulée de la rentrée de 1985, il n’en reste que neuf trois ans plus tard, après la signature des accords de Matignon-Oudinot. Seules deux écoles (Canala et Ouvéa) survivront dans les années 1990.
6 - Le privé à l’assaut de l’enseignement supérieur
Depuis plusieurs années, contrairement à l’Enseignement supérieur public, les officines d’enseignement supérieur privé lucratif se portent bien : un quart des effectifs contre 14% il y a 20 ans, la moitié des effectifs étudiants supplémentaires depuis 10 ans. Sur cette période, le privé a crû de 65% contre 16% pour le public.
Une situation qui résulte de choix politiques depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir en 2017 :
• conséquence de la loi Pénicaud de 2018 qui octroie de généreux financements publics au privé et du développement sans précédent de l’apprentissage (multiplié par 5 en 7 ans)
• effet de la sélection par Parcoursup et de la prospection de groupes privés auprès des recalé·es ou de celles et ceux qui sont inquiet·es de l’être et préfèrent “sécuriser” leur possibilité de poursuivre des études supérieures ;
• désinvestissement de l’État dans le public : la dépense par étudiant a chuté de 16% entre 2012 et 2022.
Pourtant, tout le monde est parfaitement au courant des dysfonctionnements majeurs de ces formations privées : des appellations de diplômes mensongères, des formations tout en distanciel, des reconnaissances trompeuses, des frais d’inscriptions frauduleux…. La Direction des fraudes avait rendu un rapport qui estimait que 30% des écoles privées avaient des pratiques commerciales trompeuses/douteuses. Tout cela adossé à un marketing agressif à destination des recalé·es ou inquiet·es de l’être de Parcoursup.
Ce développement éclair dans un far-west réglementaire se fait par ailleurs dans un contexte de promotion de l’apprentissage par le gouvernement : en 7 ans, les aides publiques aux entreprises pour l’apprentissage sont passées de 5 à 25 milliards. Et les entreprises privées de l’enseignement supérieur en profitent aussi largement. Aujourd’hui, la seule inscription de ces entreprises privées au Répertoire national des certifications professionnelles les autorisent à être répertoriées sur Parcoursup. Ce développement rapide et bien peu réglementé de l’enseignement supérieur privé est un danger pour le service public de l’ESR, pour ses personnels (recrutements parallèles, débauchages…) et les étudiant·es (augmentation des frais d’inscription, formations non reconnues…).
En mai 2024, un rapport parlementaire établissait une série de recommandations afin d’encadrer ces formations et proposer un label ministériel. SUD éducation partage une série de recommandations de ce rapport tant à l’heure actuelle le flou et la tromperie généralisée ont des conséquences graves pour des étudiant·es qui vont s’endetter pour des formations non reconnues. Protéger l’appellation “master” pour les diplômes nationaux, limiter les appellation “mastères” et “bachelor” aux formations reconnues par l’Etat, distinguer diplômes et formation RNCP, contrôler la qualité pédagogique de ces formations privées, conditionner les fonds d’apprentissage… sont certainement des premières mesures à prendre rapidement.
Mais pour SUD éducation, le “label qualité” proposé par ce rapport et prochainement repris par le ministère va finalement venir renforcer l’enseignement supérieur privé lucratif qui se verra garantir ses formations tandis que le budget de l’ESR public continue lui de s’appauvrir. Pour SUD éducation l’État ne doit pas octroyer d’accréditations pour des formations qui existent dans le public. Depuis des années maintenant, notre ministère ouvre la porte à cette concurrence du privé : en 2021, F. Vidal autorisait (contre l’avis unanime du CNESER) l’intégration dans Parcoursup des formations dispensées par des établissements privés ni sous contrat avec l’État ni d’intérêt général ; pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, peu importe que les étudiant·es se tournent vers le public ou le privé.

Pour SUD éducation, l’heure n’est pas à la labellisation des formations d’enseignement supérieur privé lucratif appartenant à de grands groupes capitalistes (Galileo appartient à la famille Bettencourt) ou des fonds d’investissements, mais à la mise en place d’un plan d’urgence massif pour l’Enseignement supérieur et la Recherche publique et la fin de la sélection.
Avec une aide de l’État à hauteur de 8000€ par apprenti, le coût de l’apprentissage pourrait avoisiner les 25Md€ en 2024. Par comparaison celui de l’ESR est de… 25Md€. L’État dépense donc sans compter dans des formations qui ne sont ni garanties, ni contrôlées. Sur ces 8000€ ce ne sont parfois uniquement que 1600€ qui vont à la formation réelle. Le reste allant dans les poches de ces grands groupes capitalistes amis. Un comble : Murielle Pénicaud, ministre du travail ayant mis en place cette politique massive en faveur de l’apprentissage, travaille aujourd’hui pour Galileo. C’est à un transfert massif d’argent public vers le privé auquel nous assistons, orchestré par l’État et les gouvernements de Macron.
SUD éducation revendique la mise en place d’un grand service public d’enseignement supérieur. SUD éducation s’oppose à toute forme de labellisation des formations privées. Ces labellisations contribuent à la légitimation des ces formations au détriment des formations publiques. Une fois obtenue la labellisation, comment ces formations seront-elles contrôlées, quelle sera l’effectivité de ces contrôles ?
7 - Des moyens pour l’école publique, et vite !
SUD éducation présente ses revendications
L’école publique a besoin d’une politique véritablement volontariste pour soigner les maux des précédentes réformes de Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal : SUD éducation porte au sein de l’Intersyndicale l’abandon du Choc des Savoirs, mais cela ne suffit pas, il faut des moyens pour l’école publique. SUD éducation détaille ses mesures pour l’école.
Les personnels se sont massivement mobilisé·es contre le Choc des savoirs que voulait nous imposer Attal. Cette réforme s’opposait frontalement à la conception qu’ont les personnels de l’école publique : une école pour tou·tes, exigeante, qui lutte contre les inégalités et la reproduction sociale pour former de futur·es citoyen·nes.
Les attaques contre l’école sont de deux ordres : libérales car elles tendent à démanteler le service public d’éducation, à faire toujours plus de cadeaux à l’école privée et à reproduire les inégalités sociales, et réactionnaires à travers les discours sur les savoirs fondamentaux contre les disciplines, sur l’autorité, l’uniforme, le SNU …
Dans le premier comme dans le second degré, les moyens alloués sont insuffisants pour assurer l’accompagnement de tou·tes les élèves : l’inclusion des élèves en situation de handicap se fait sans moyens suffisants, les personnels AESH revendiquent toujours un statut de la fonction publique et un salaire digne de ce nom, les RASED et les établissements spécialisés sont réduits à peau de chagrin. De même, les classes d’accueil pour les élèves allophones ne bénéficient pas des moyens nécessaires. Enfin, l’éducation prioritaire, censée réduire les inégalités, n’existe quasi plus.
Pour faire face à ce constat alarmant, SUD éducation met à jour ses revendications pour l’éducation.
Plus que jamais, c’est le moment pour les personnels de se syndiquer en masse.
C’est au mouvement syndical d’aller arracher des mesures de progrès social !
Ce plan d’urgence comprend :
• un volet pour une école pour tou·tes • un volet éducation prioritaire
• un volet pédagogie et système éducatif
• un volet postes
• un volet médico-social
• un volet bâti scolaire
• un volet restauration.
Une école pour tou·tes
C’est l’ensemble de l’inclusion scolaire qui doit être repensée, en commençant par la satisfaction des revendications des personnels essentiels, les AESH :
• une baisse des effectifs par classe. À titre de repère, la revendication générale de SUD éducation pour la SEGPA est de 12 élèves maximum ;
• des dispositifs d’aide et de prévention complets : 1 RASED complet par groupe scolaire et 1 enseignant·e supplémentaire pour cinq classes (pour le 1er degré) et un recrutement massif de personnels médico-sociaux (assistance sociale, infirmerie, psychologue…) ;
• la satisfaction des revendications des AESH : la création d’un statut d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e avec un temps plein à 24 heures face élève, un salaire à 2000 euros bruts ;
• une formation en accord avec les besoins rencontrés par les collègues en poste dans l’ASH ;
• des ouvertures d’UPE2A et d’ULIS ainsi que l’augmentation du nombre d’heures allouées à ces dispositifs.
Postes
Pour SUD éducation, il existe plusieurs leviers pour créer dans l’urgence les postes nécessaires :
• la réaffectation des crédits non engagés par le ministère vers des créations de postes à compter de la rentrée ;
• la reconversion massive des heures supplémentaires dans le second degré vers des créations de postes, afin d’augmenter le nombre de personnels dans les établissements et améliorer les conditions de travail ;
• la titularisation à temps plein de l’ensemble des enseignant·es non titulaires, sans condition de concours ni de nationalité : les collègues en question sont déjà souvent en poste depuis longtemps, il n’y a aucune raison pour qu’ils et elles ne bénéficient pas du statut de fonctionnaire ;
• l’admission de l’ensemble des admissibles, aux concours internes comme externes : les recalé·es des oraux des concours constituent un nombre très important de potentiel·les futur·es collègues ; au vu de l’urgence de la situation, il est souhaitable qu’ils et elles soient stagiarisé·es dans leur totalité ;
• l’organisation de concours exceptionnels : il est arrivé, encore récemment, que des concours supplémentaires soient organisés en fonction des besoins pour le recrutement des professeur·es des écoles ; ce dispositif pourrait être généralisé, en fonction des besoins locaux, dans les départements ;
• l’embauche de personnels aidant à la direction pour le primaire, avec un réel statut ;
• l’embauche massive d’AESH et d’AED et la titularisation dans le cadre d’emplois statutaires d’éducateurs·trices scolaires ;
• le rétablissement des moyens en remplacement dans le 1er et le 2d degré.
Médico-social
SUD éducation revendique :
• des créations de postes de personnels médico-sociaux à hauteur des besoins, pour l’ensemble des actes professionnels ;
• l’abandon de tous les projets de transfert vers les collectivités des personnels médicaux ;
• la compensation dans son entièreté de la baisse des fonds sociaux qui est intervenue au cours des années précédentes ;
• l’augmentation des aides à la demi-pension et des bourses ;
• des transports gratuits pour les élèves.
Education prioritaire
SUD éducation porte des revendications pour l’éducation prioritaire : elles doivent être immédiatement mises en œuvre pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire :
• l’extension de la pondération de 1,1 heures à l’ensemble des personnels pour toute l’éducation prioritaire, REP inclus. Cette pondération correspond à une décharge pour reconnaître la charge de travail spécifique à l’éducation prioritaire, mais ne doit pas être conditionnée à des missions ou réunions supplémentaires ;
• une baisse des effectifs : pour l’éducation prioritaire, SUD éducation revendique 16 élèves par classe en école et collège, 12 en SEGPA, 20 en lycée ;
• des vies scolaires renforcées : 1 CPE pour 100 élèves et 1 AED pour 50 élèves dans toute l’éducation prioritaire ;
• des moyens médico-sociaux renforcés : 1 RASED complet par groupe scolaire et 1 enseignant·e supplémentaire pour cinq classes (pour le 1er degré) et un recrutement massif de personnels médico-sociaux (assistance sociale, infirmerie, psychologue) ;
• sur la carte de l’éducation prioritaire : SUD éducation revendique le maintien en REP des lycées dont les élèves sont majoritairement issus de collèges REP et REP+. L’intégration de nouvelles écoles et établissements dans la carte de l’éducation prioritaire, y compris des écoles ou établissements situés dans des espaces ruraux susceptibles d’intégrer la carte, doit se faire sur la base de critères sociaux, dans le cadre d’un classement transparent et renouvelé tous les quatre ans. L’intégration des écoles ou établissements ruraux à la carte ne doit pas se faire au détriment d’écoles ou établissements d’ores et déjà classés ;
• l’attribution du même montant de la prime REP à tous les personnels de l’ensemble de l’éducation prioritaire, et notamment aux AED et AESH.
Pédagogie et système éducatif
SUD éducation revendique plusieurs mesures :
• la limitation des effectifs pour favoriser la différenciation, le travail coopératif entre élèves pour niveler les écarts de niveaux. À titre de repère, la revendication générale de SUD éducation (hors éducation prioritaire) est de 20 élèves maximum en école élémentaire et en collège, et de 25 en lycée, mais les circonstances exceptionnelles impliquent de descendre encore en-deçà ;
• dans le second degré, des dédoublements systématiques sur la moitié des horaires disciplinaires par un cadrage national ;
• l’aménagement des programmes, afin que les enseignant·es puissent mettre en œuvre au mieux une pédagogie permettant de compenser les inégalités scolaires ;
• l’intégration dans les programmes d’une vraie éducation à la vie affective et à la sexualité mais aussi aux enjeux environnementaux ;
• la liberté pédagogique et de support notamment en CP dans le cadre de l’apprentissage de la lecture ;
• une formation initiale et continue sur temps de service qui tienne compte de ces problématiques et de ces enjeux, qui impliquent des pratiques pédagogiques particulières ; • un retour des PDMQDC, sans remise en cause des dédoublements là où ils existent, et un rétablissement des RASED dans leur totalité ;
• l’abandon de Parcoursup et de la sélection à l’entrée à l’université, qui dans cette période fonctionne encore davantage comme une machine de tri social ;
• l’abandon des contre-réformes du bac et des lycées qui accroissent les inégalités, cette année encore plus que d’habitude ;
• l’abandon du Choc des savoirs, de la politique éducative des Savoirs fondamentaux et du SNU.
Bâti scolaire
Pour SUD éducation, le ministère doit reprendre la main sur la gestion du bâti scolaire de la maternelle à l’université en injectant les moyens financiers à la hauteur des enjeux. Le parc immobilier scolaire a besoin d’un plan d’urgence afin de le rénover, de mieux l’isoler et d’appliquer sa mise aux normes, pour en finir avec les passoires thermiques que sont nos écoles et établissements scolaires et universitaires. Les établissements scolaires et d’enseignement supérieur sont très rarement dotés de thermostats. Vétustes, ils rendent le travail très pénible dès qu’il fait froid ou chaud. Les équipements de chauffage ne peuvent pas toujours être contrôlés par les utilisateurs et utilisatrices des salles, conduisant à ouvrir les fenêtres avec le chauffage en route.
Des revendications concrètes sur les bâtiments scolaires et l’énergie :
• Un plan de rénovation /reconstruction du bâti scolaire pour la réduction des consommations énergétiques (isolation des bâtiments, programme de réduction des consommations…) et en eau ;
• La maîtrise des consommations : isolation des bâtiments, éclairages à basse consommation et « intelligents », toits végétalisés, ventilation naturelle, récupération des eaux pluviales ;
• Le développement de la production d’énergie renouvelable sur site (panneaux solaires…) ;
• La transparence totale sur les risques environnementaux, leur prise en compte par les formations spécialisées et notamment une campagne de désamiantage des établissements scolaires dans le cadre de l’application du Plan amiante relancé en 2016 ; une prise en charge des personnels exposés ;
• La débitumisation /végétalisation des cours de récréation qui doivent être accessibles en dehors du temps scolaire à la population en cas de fortes chaleurs et la dépollution des sols ;
• L’instauration de températures minimales et maximales de travail ; le contrôle effectif des températures dans les bâtiments par les formations spécialisées (auparavant CHSCT).
Restauration
L’éducation à l’alimentation et le développement d’une alimentation issue des circuits courts est un enjeu primordial pour garantir notre santé et celle des élèves, et pour agir contre la crise environnementale. Il faut relocaliser l’agriculture. La plupart des produits servis dans les cantines sont issus de l’agriculture industrielle, qui entraîne la déforestation de nombreuses zones de la planète, détruisant des réserves de carbone, une pollution des sols et des nappes phréatiques à cause de l’utilisation de pesticides et impacte fortement la santé des agriculteurs·trices et de leurs familles.
Les revendications de SUD éducation pour des restaurations scolaires et universitaires agroécologiques :
• La réduction de la consommation de viande et de poisson, leur remplacement par des alternatives végétariennes et la mise en place, pour les personnels, de formations à la création de menus végétariens ;
• Le renforcement des filières locales et biologiques dans la restauration scolaire avec pour objectif le 100 % bio, sans hausse du prix du repas pour les familles ;
• La fin des cantines centrales et le retour à des cantines sur site, et la création d’une plateforme mettant en relation les producteur·trices en bio et local et les établissements et mairies ;
• La création de postes d’agent·es fonctionnaires pour mettre en œuvre la reconversion écologique dans les cantines.