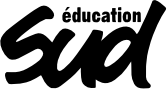- Pour commander la brochure (version papier), rendez-vous sur le site materiel.sudeducation.org (accès réservé aux syndicats)
- Téléchargez la version PDF gratuitement en cliquant ici.
Lors de l’année 2023 – 2024, Gabriel Attal a réussi à se mettre à dos l’ensemble de la communauté éducative en seulement quelques mois avec sa réforme de tri social, le Choc des savoirs. Alors que les personnels revendiquent de vrais moyens pour l’école publique afin d’assurer les remplacements, de garantir une vraie école inclusive et un vrai accompagnement médico-social des élèves mais aussi de baisser le nombre d’élèves par classe pour la réussite de tou·tes, Attal a choisi d’imposer des mesures qui trient les élèves, qui sanctionnent la difficulté scolaire et qui dépossèdent les enseignant·es et l’ensemble des personnels de leur métier. L’école est un sujet médiatique pour Gabriel Attal qui lui permet de parler à l’électorat d’extrême-droite. Pourtant, c’est avec le destin de millions d’élèves qu’a joué le premier ministre. Elles ont participé à conduire l’extrême droite aux portes du pouvoir.
Pourtant l’extrême droite porte un programme qui porte atteinte aux droits des enfants en démantelant la protection de l’enfance.
Déjà, les annonces de Gabriel Attal en avril 2024 étaient particulièrement alarmantes car elles mettent en danger notre démocratie : l’État, par la voix de son premier ministre, renonce à protéger les jeunes et à leur garantir l’égalité de traitement, il s’emploie à les criminaliser pour les rendre dociles, dans la continuité de la mise en place du SNU. Attal sait que la jeunesse est une force de transformation sociale, il est donc prêt à rompre avec les valeurs de notre démocratie pour la démoraliser, l’humilier, la briser. Pourtant la jeunesse n’est ni violente, ni incontrôlable, elle subit la violence sociale que le gouvernement fait régner aujourd’hui.
Dans cette brochure de SUD éducation, nous réaffirmons que les droits des jeunes et des enfants doivent être respectés : le droit à une scolarité sans violence et sans discrimination, le droit d’être protégé·es, le droit à la liberté d’information, d’expression et d’organisation, le droit au logement, le droit au soin. Les équipes de SUD éducation s’emploient sur le terrain à les faire respecter et défendent l’auto-organisation de la jeunesse contre les politiques qui visent à les criminaliser, à les réprimer.
Contre le rêve d’Attal d’une jeunesse docile soumise au SNU que nous combattons, contre les attaques de l’extrême droite contre les droits des enfants, SUD éducation appelle les personnels à défendre pied à pied les droits des élèves et des étudiant·es.
La jeunesse a droit à la démocratie, au respect, à être protégée à l’école et à l’université comme ailleurs !
Sommaire
- État des lieux des droits des enfants
- Le droit d’aller à l’école
- La place centrale de l’enfant dans les pédagogies émancipatrices
- Des classes surchargées, ça suffit !
- Le droit à la scolarité pour les enfants handicapé⋅es
- Le droit à la scolarité pour les enfants étranger.ères
- Les réformes d’Attal, le “Choc des savoirs” sont des attaques au droit des élèves d’accéder à un même enseignement !
- Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
- Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
- Le droit d’être protégé·e contre toutes les formes de discrimination
- Contre les assignations sexistes
- Le droit à l’éducation à la vie affective et sexuelle
- Circulaire relative à l’accueil des élèves trans : un texte nécessaire mais insuffisant !
- Stop aux injonctions vestimentaires
- Note de service interdisant les « tenues de type abaya ou qamis »
- Stop aux assignations de genre
- Pour les droits des enfants intersexes
- Contre la grossophobie
- Contre les discriminations racistes
- Le droit d’être soigné·e, protégé·e des maladies
- Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir : STOP au SNU !
- Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru·e, et d’avoir des conditions de vie décentes
- Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
1 - État des lieux des droits des enfants
Les droits des enfants ont été établis par plusieurs textes internationaux. Ces droits consacrent les garanties fondamentales à tous les êtres humains et notamment s’inscrit dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme ratifiée en 1953.
Définir les droits de l’enfant ?
Les droits de l’enfant s’appliquent à toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Ils ont trait autant aux droits civils et politiques qu’aux droits économiques sociaux et culturels, aux droits individuels et collectifs. Parmi eux, on peut citer le droit à une identité, à la santé, à l’éducation, à la vie en famille, à un niveau de vie suffisant, le droit d’être protégé de la violence, de s’exprimer, d’être protégé de la guerre et de l’exploitation ou encore de jouer et d’avoir des loisirs.
Quels sont les textes internationaux qui garantissent les droits des enfants ?
La déclaration des droits de l’enfant de 1959 énonce 10 principes pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfance. Les principes 8 et 9 évoquent notamment le droit « en toutes circonstances, d’être parmi les premiers à recevoir protection et secours » et « [d »]être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation, [de ne] pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit »
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et entrée en application en France le 6 septembre 1990, a pour mission de protéger les droits des enfants. Elle comprend 54 articles qui définissent les droits des enfants et les responsabilités des États pour les garantir. Tous ces droits sont inaliénables et interdépendants.
Qu’en est-il dans le droit français ?
De nombreuses sources déclinent ces mesures dans le droit français :
- le code de l’éducation : droits scolaires, éducation à la sexualité ;
- le code de la santé publique : accès à la santé et à la contraception ;
- le code civil : protection de l’enfance, autorité parentale, protection de la vie privée, droits juridiques ;
- le code pénal qui liste les délits et crimes commis sur les mineurs et les sanctions correspondantes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étranger⋅es relatif au droit des étranger⋅es mineur⋅es ;
- le code de l’action sociale et des familles : protection de l’enfance.
Ces articles sont complétés par des lois dont les dispositions concernent directement les droits des enfants et qui trouvent leur application dans des corpus réglementaires. Par exemple, on peut citer les lois des 5 mars 2007 et 14 mars 2016 relatives à la protection de l’enfance et la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.
Si la prise en compte des droits des enfants en France est une réalité juridique ceux-ci restent partiels : on pense par exemple au droit à l’éducation qui n’est pas totalement réalisé tant que tou⋅tes les enfants n’ont pas accès à l’école publique. D’autre part, elle n’échappe pas à la logique répressive et sécuritaire qui impacte l’ensemble de la société. On peut, entre-autres, citer le retour de l’enfermement des mineur⋅es avec la loi Perben de 2002 qui (re)crée les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) dont les premiers seront ouverts en 2007. Autre catégorie de mineur⋅es dont les droits sont bafoués, les mineur⋅es étranger⋅es isolé⋅es : refus de reconnaissance de minorité et donc de protection, pratique de tests osseux, fichage biométrique, etc.
2 - Le droit d’aller à l’école
Des pédagogies où tout s’imbrique
Le terme « pédagogies émancipatrices » recoupe une multitude de courants pédagogiques, la plupart ayant émergé dans la première moitié du XXe siècle. Des pédagogies critiques incarnées principalement par la figure du brésilien Paulo Freire, aux pédagogies institutionnelles développées dans les mouvements d’éducation populaires, en passant par les travaux d’Élise et Célestin Freinet, on retrouve plusieurs principes communs permettant de les regrouper sous l’expression « pédagogies émancipatrices ».
Ces pédagogies envisagent toujours l’apprenant non pas comme un « élève » dans ce que ce terme à de restrictif à l’univers de l’école, mais comme un individu complexe et multiple dont les compétences proviennent et s’expriment au-delà des savoirs dits « académiques ». C’est la raison pour laquelle chacun de ces mouvements pédagogiques a pour principe fondamental de mettre l’apprenant au centre, de le rendre acteur de ses apprentissages, décideur des contenus qu’il souhaite travailler, qu’il s’agisse d’un apprenant adulte ou d’un enfant. Toutefois, et à la différence de la direction prise par le travail de Maria Montessori – que l’on assimile parfois à ces mouvements pédagogiques – les pédagogies émancipatrices comportent une dimension politique et sociale très prégnante : il s’agit également de faire prendre conscience à l’apprenant de sa condition d’être social (et souvent opprimé). Par des processus de conscientisation des inégalités, des enjeux de lutte sociale et des enjeux de pouvoir autour de la maîtrise de savoirs et de connaissances, l’apprenant est accompagné vers sa propre émancipation. L’un des objectifs est de s’affranchir de toute domination et dépendance, tout en développant un sens aigu du collectif, de la responsabilité et du vivre-ensemble. « L’apprenant au centre » ne doit donc pas se lire comme l’expression d’une pédagogie de l’individualisme, mais au contraire comme une démarche de responsabilisation de l’apprenant comme être social.
C’est à travers ce prisme que sont pensées les différentes activités développées par les pédagogies émancipatrices : chaque moment d’apprentissage tend vers une plus grande liberté de l’apprenant, vers une « encapacitation » ainsi que vers un questionnement du monde qui l’entoure. Ces principes habitant chacune des propositions pédagogiques que nous présentons ici, il nous paraît important de rappeler qu’elles s’imbriquent donc dans une interdépendance constante : les activités d’expression libre font écho au questionnement sur la démocratie dans la classe, de même que les démarches d’investigation résonnent dans les activités de présentation orale et sont étroitement liées aux observations faites par les enfants lorsque la classe sort de l’école.
L’enfant, un être de droits
Les pédagogies émancipatrices à travers le mouvement de l’école moderne ont eu un rôle important dans la reconnaissance des droits de l’enfant qui a abouti à la convention des droits de l’enfant adoptée à l’unanimité par l’ONU le 20 novembre 1989. Celle-ci reconnaît le droit de l’enfant à l’ accès à la vie et à l’action citoyennes.
Aujourd’hui, les pédagogies émancipatrices s’évertuent à faire en sorte que les enfants puissent exercer leurs droits, leurs libertés, leur citoyenneté et par l’exercice de ces droits, construisent les compétences qui les feront devenir des citoyen·nes émancipé·es, qui participent à la démocratie.
Elles considèrent l’école comme un lieu où les enfants apprennent en exerçant leurs libertés, parfois seul·es (nul besoin de la permission de l’adulte pour aller chercher un mouchoir, du matériel ou un camarade pour travailler, pour aller aux toilettes même si les déplacements peuvent avoir besoin d’être signalés à l’adulte garant de la sécurité de l’enfant), parfois avec l’adulte, parfois après avoir montré qu’on est capable de respecter les devoirs inhérents à l’exercice d’un droit : c’est le principe des ceintures de comportement de la pédagogie institutionnelle qui permettent à l’enfant de justement construire ce rapport devoirs /droits.
Le droit à s’exprimer librement va s’exercer à travers toutes les pratiques de création et d’expressions libres, rendues possibles par un cadre qui a le souci que chacun et chacune s’exprime, et pas seulement les plus à l’aise qui exercent déjà ce droit dans la sphère familiale ou ailleurs. En conseil, les plus jeunes se font passer un bâton de parole, dans les classes plus âgées, un·e élève responsable note et fait respecter les tours de parole. La priorité est donnée à celui ou celle qui a le moins parlé.
Un autre droit mis en avant dans l’école des pédagogies émancipatrices est celui des enfants à participer aux décisions qui les concernent, droit garanti par l’article 12 de la convention mais qui peine à être appliqué dans nos institutions… Et pourtant, si l’on veut que tou·tes les enfants soient égaux·les devant ce droit, n’est-ce pas d’abord à l’école publique en premier qu’il conviendrait de l’exercer ? L’un des piliers de la pédagogie Freinet est justement une réelle participation des enfants aux décisions quant à leur travail et à l’organisation de la classe et de l’école. Cette participation est notamment rendue possible par les conseils coopératifs qui sont des moments d’organisation du travail, de la vie, de la classe et ou de l’école.
Ainsi, le vendredi lors du conseil bilan de la semaine, les président·es du conseil décrochent les 3 pochettes « J’ai un problème », « Je propose », « Je félicite » dans lesquels les camarades ont mis des papiers avec leur prénom, signifiant ainsi qu’ils et elles veulent s’exprimer dans l’un de ces moments. Le moment « Je propose » permet aux élèves d’exercer ce droit de participation. Il ne suffit souvent pas car il faut également prévoir des temps où les propositions faites et validées par la classe sont concrétisées. Ces propositions peuvent être simples et à mettre en place directement dans la classe. Par exemple, en début d’année, une élève de CP propose de décorer la classe avec des dessins d’élèves. Après discussion, les élèves décident de mettre une chemise cartonnée à disposition dans laquelle on met les dessins qu’on souhaite afficher en classe. Depuis, à chaque conseil, on ouvre la pochette, et la classe valide ou demande éventuellement de reprendre le dessin en donnant des conseils pour l’améliorer avant affichage. Pour que cette participation soit possible, il faut un « partage du pouvoir », une remise en question de la façon dont l’adulte exerce son autorité sur l’enfant.
Cela renvoie notamment au concept de « part du maître » proposé en pédagogie freinet : l’adulte est bien sûr responsable et garant de la sécurité physique, morale et émotionnelle des enfants dont il a la charge et doit en ce sens instaurer un cadre sécurisant, toutefois, les enseignant·es ne sont pas au-dessus, ni au service de, ils et elles font partie de la communauté scolaire régie par des droits et des devoirs dont les adultes aussi doivent répondre.
Il s’agit souvent de déconstruire l’autorité arbitraire de l’adulte (sous prétexte qu’il saurait ce qui est bon) sur l’enfant et la déconstruction de cette relation d’oppression n’a rien de simple, ni pour les adultes, ni pour les enfants.
Il faut alors parfois du temps pour que les enfants s’emparent de ce droit de participation, surtout lorsque la pratique du conseil n’est pas une habitude d’école, et que les enfants ont intégré qu’ils et elles doivent « écouter les adultes ». Mais, en fin d’année, on peut avoir droit à ces conseils pépites dans lesquels l’enseignant·e peut s’effacer presque complètement.
Cette relation d’autorité des adultes sur les enfants remise en question, les adultes n’en restent pas moins la garantie des droits des enfants dont ils et elles ont la responsabilité. La responsabilité de leur faire connaître et de leur donner la possibilité de se défendre, mais aussi une responsabilité directe des libertés fondamentales parmi lesquelles l’accès à des conditions de vie dignes : le droit à un logement décent, le droit à de la nourriture en quantité suffisante, le droit à des soins, etc. Ces mêmes droits qui sont actuellement en recul en France, où de plus en plus d’enfants vivent dans la précarité.
L’ouverture au monde extérieur à l’école des pédagogies émancipatrices, c’est donc aussi être attentif aux conditions de vie des élèves, de leurs familles, ne pas fermer les yeux sous prétexte qu’à l’école les enfants seraient égaux·les, ne pas cloisonner sa vie professionnelle et sa vie citoyenne et agir collectivement pour que l’état assume ses responsabilités face aux enfants, pour lutter contre les oppressions vécues aussi à l’extérieur de l’école.
Si la place de l’élève est centrale dans les pédagogies émancipatrices, ces dernières cherchent à lui montrer quelle position occuper au sein de la société. En effet, l’élève est aussi une personne sociale, occupant une position sociale au sein d’une structure sociale, c’est-à-dire au sein d’une organisation de la société. Il s’agira donc à la fois de prendre conscience des rapports sociaux (de classe, de genre, de race) mais aussi de les transformer, de chercher à s’en émanciper. Il n’y a pas d’un côté, l’adulte qui va enseigner, et de l’autre l’élève qui va apprendre. En effet, selon les mots de Paulo Freire « personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».
L’adulte va chercher à faire conscientiser les rapports sociaux inégalitaires aux élèves, et en le faisant, il va en apprendre lui-même davantage. Pour cela, il faudra enquêter sur son monde tel un sociologue. Toutefois, étudier les rapports sociaux seulement peut être source d’angoisse et démobilisant. Il faut donc également travailler avec les élèves à transformer le monde, individuellement et collectivement. On cherchera à créer ensemble une capacité d’action collective. Par exemple, travailler sur les inégalités de genre ne peut pas s’arrêter à une étude statistique de l’inégale répartition du travail domestique, il faudra réfléchir avec ses élèves à ce qu’il est possible de faire, dans nos classes, nos établissements, nos quartiers, nos villes et ainsi de suite. Pour cela, il est possible de partir d’un questionnement simple aux élèves : que faire pour lutter contre ? Les élèves ne manquent pas de propositions, même si parfois elles sont hésitantes : campagne de sensibilisation, formation du personnel et de leurs camarades, dénonciation du problème à l’éducation nationale…etc.
L’enfant dans le collectif
L’importance des moments de présentations collectives.
Ces pédagogies émancipatrices considérant l’enfant comme un être social qui n’apprend pas seulement à l’école des savoirs mais découvre aussi des savoirs-être et des savoirs-vivre, elles proposent systématiquement des temps collectifs dans l’emploi du temps de la semaine. Ainsi, l’élève peut présenter à l’oral son texte libre, son œuvre d’art, son exposé, son expérience scientifique… et le retour de la classe, sous forme de questions/remarques /suggestions, va à la fois rendre nécessaire et motivant le travail effectué en amont et en même temps susciter de nouvelles interrogations, recherches, de nouveaux travaux et aider à évoluer.
Le collectif est essentiel. Il est présent également dans les classes traditionnelles mais il ne s’agit pas de la même chose.
Du côté des classes traditionnelles, le collectif a pour but de faire assimiler aux élèves les mêmes règles et les mêmes contenus scolaires.
Du côté des pédagogies émancipatrices, le collectif veut que chaque personne soit reconnue dans sa singularité avec son apport au groupe. Là encore la différence va se faire au niveau de la place occupée par les adultes et donc par celle laissée aux élèves. Pour les pédagogies émancipatrices c’est le collectif qui permet d’apprendre. L’adulte n’apporte pas les connaissances et leur validation. L’adulte organise et crée un cadre qui permet à l’enfant d’apporter au groupe et d’être reconnu au sein du groupe, de savoir susciter les échanges et l’entraide au sein du groupe. Le collectif prend du recul et réfléchit sur des techniques pour améliorer leurs productions, mais aussi voir qu’il peut y avoir plusieurs façons de faire. Ces moments poussent à l’ouverture aux autres : dès la maternelle, l’enfant va réaliser que le collectif peut l’aider à progresser, et que lui ou elle – même – peu importe ses capacités – peut aider et trouver sa place dans le groupe.
Les dictées coopératives : un exemple d’activité qui développe l’entraide entre élèves
La dictée coopérative est facile à mettre en place : on part sur une dictée classique, non préparée. Sauf qu’à un moment donné, les enfants ont la possibilité de demander de l’aide à la classe. De cette manière, on pousse les enfants à se poser des questions sur l’orthographe des mots : par exemple, « est-ce que manger s’écrit [an] ou [en] ? » Les élèves de la classe vont alors essayer d’apporter une aide sans épeler le mot, mais en se référant à un mot que tous savent déjà écrire (travailler par analogie) : « le début de manger, ça s’écrit comme la fin de maman ».
Cette activité permet d’enlever le stress de la dictée classique : l’enfant sait qu’il ou elle peut compter sur le groupe classe pour l’aider, et qu’il a tout intérêt à vérifier l’orthographe des mots avant de les écrire. Ce qui est au final le but d’une dictée : apprendre à écrire en faisant le moins d’erreurs possibles et avoir le réflexe de vérifier l’orthographe si l’on a un doute.
Les marchés de connaissances : quand l’enfant-apprenant devient l’enfant-enseignant
Les marchés de connaissances sont des moments où un groupe d’élèves volontaires va organiser des stands pour enseigner aux autres élèves de la classe ou de l’école des choses sur lesquelles ils ou elles se considèrent comme experts : on y voit des ateliers scoubidous, pixels arts, origamis, pâte fimo, Minecraft… ou encore des marchés sportifs (hip hop, basket, football, cirque…).
Lors de cette activité, l’adulte est un régulateur – il ou elle peut aussi gérer un stand mais ce sont essentiellement les élèves qui enseignent. L’enfant réalise que lui aussi maîtrise des connaissances qu’il ou elle peut partager, et cela lui permet de se mettre à la place de l’adulte et d’appréhender les problèmes (et solutions) qu’il peut rencontrer lors de la transmission des savoirs. Au fur et à mesure des marchés, on met en place des techniques et du matériel pour faciliter cette transmission (préparer la trame de ce qu’on va dire, cibler les compétences travaillées, rédiger un tutoriel écrit, un questionnaire pour voir si tout est bien compris…) ; on fait le point sur les droits et les devoirs des groupes participants et des groupes experts (l’importance de respecter et d’écouter, de préparer son stand correctement).
Une condition indispensable pour garantir les bonnes conditions d’apprentissage et un climat scolaire propice aux apprentissages est d’avoir des conditions d’étude sereines pour les élèves. Mais au lieu d’investir dans l’Éducation nationale, le ministère ne cesse de réduire ses moyens. Le bien-être des élèves ne semble pas être une priorité pour le ministère qui ne cesse de supprimer des postes. Dans le second degré, dans un contexte de hausse démographique, on en est à 9 000 suppressions de postes en 6 ans. SUD éducation réclame un plan d’urgence pour l’éducation, prévoyant des recrutements importants afin de diminuer les effectifs en classe, un accent mis sur la formation continue des personnels, et des moyens matériels permettant une mise à niveau du bâti scolaire.
SUD éducation revendique :
Des moyens en personnels :Limiter les effectifs par classe avec au collège :
- 20 élèves maximum en collège ordinaire, 16 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA ;
- des dédoublements nationaux sur la moitié des horaires d’enseignement dans toutes les matières.
Des Vies scolaires renforcées :
- Au moins 1 CPE dans tous les collèges quel que soit le nombre d’élèves ;
- 1 CPE pour 120 élèves dans les collèges ordinaires et 1 pour 100 en éducation prioritaire ;
- En plus du CPE, 1 personnel de vie scolaire pour 50 élèves en collège ordinaire et 2 pour 50 en éducation prioritaire.
Un réseau de service public à taille humaine et égalitaire :
- Une taille des collèges limitée avec des collèges de 400 élèves maximum ; la fin des regroupements d’établissements dans des cités scolaires de taille trop importante pour assurer un suivi correct des élèves.
En 2006, seul·es 155 361 enfants en situation de handicap étaient scolarisé·es en milieu scolaire. Aujourd’hui, ils et elles sont plus de 470 000. Le nombre de personnels en charge de leur accompagnement est passé de 12 640 à plus de 130 000.
Pourtant, nous constatons une dégradation des conditions d’accueil des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire dont le nombre d’heures en accompagnement diminue. Les conditions d’une école réellement inclusive ne sont donc pas remplies. L’accompagnement ne se fait pas selon l’évaluation réelle des besoins des élèves, mais selon une logique de rentabilisation et d’économie des moyens qui n’a pas sa place à l’école. La mutualisation des moyens doit cesser et il faut des embauches massives de personnels accompagnant·es des élèves en situation de handicap.
SUD éducation dénonce les carences de l’État en matière de scolarisation des élèves handicapé·es. Combien faudra-t-il de rapports à charge pour que le ministère décide de donner à l’école les moyens de scolariser réellement les élèves handicapé·es et de leur garantir les mêmes droits que tou·tes les autres élèves ?
Validisme et politiques de l’Etat français sur le handicap
Le validisme désigne l’oppression dont sont victimes les personnes handicapées : discriminations, blagues, handiphobie…
C’est un système d’idées et de représentations que la société validiste dans laquelle nous vivons nous inculque et avec lesquelles nous appréhendons le monde social. Notre société se structure autour de l’idée que la norme, c’est la personne valide, renvoyant de fait les personnes handicapées dans les marges et l’anormalité. Cette idée nie tout continuum entre les personnes valides et les personnes handicapées et cette binarisation a deux conséquences immédiates :
- Elle objectifie les personnes handicapées, perçues par les valides comme des personnes ontologiquement vouées au malheur du fait de leur prétendue incomplétude et de leur prétendu écart à la norme (c’est le versant misérabiliste) ou au contraire, dans un point de vue faussement valorisant, comme des modèles d’inspiration en vertu d’une supposée supériorité d’âme et de courage (c’est le versant inspiration porn). Dans les deux cas, les personnes handicapées ne sont pas appréhendées comme des personnes mais sont réduites à leur handicap, essentialisées.
- Elle induit une hiérarchie des vies dans laquelle la vie des personnes handicapées a moins de valeur que celle des personnes valides. C’est en raison de cette hiérarchie des vies que la société pense – autrement dit que nous pensons collectivement – acceptable le fait que les personnes handicapées aient moins de droits que les personnes valides. Cette restriction de droits est un fait et concerne tous les aspects de la vie, depuis le logement, les transports, le travail, les loisirs, la vie sociale, la fête ou encore l’éducation.
Puisque le validisme fait système, puisqu’il est présent partout et tout le temps, puisqu’il structure nos imaginaires et nos représentations, il nous apparaît comme allant de soi, comme étant le résultat d’implacables lois naturelles. Il semble que les choses sont ainsi partout et depuis toujours, ce qui a pour effet de légitimer les discriminations, d’en amoindrir ou effacer l’injustice. Ainsi pense-t-on communément ces restrictions de libertés comme étant nécessaires et, tour de force rhétorique, pour le bien des personnes handicapées.
Ces discriminations et restrictions de liberté sont pourtant construites historiquement et sont le résultat de choix politiques et peuvent donc, de ce fait, être combattues. Les luttes antivalidistes sont menées – dans les mêmes perspectives d’émancipation et de justice sociale que l’antisexisme, l’antiracisme ou l’anticlassisme par exemple – depuis les années 68 en France et à l’internationale par des collectifs de personnes handicapées. Elles ont amené à la rédaction de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies ( Onu), ratifiée par la France en 2010. C’est le texte de référence. La convention a, dans le texte, « pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ». Elle est construite autour des principes fondateurs de la dignité, de l’égalité et de l’accessibilité. C’est notamment pour son application pleine et entière que se battent des collectifs antivalidistes comme le CLHEE, les Dévalideuses ou encore Handisocial aujourd’hui.
En août 2021, le Comité des droits des personnes handicapées de l’Onu auditionne la France afin d’évaluer sa politique relative au handicap. Les conclusions présentées dans le rapport rendu public le 14 septembre et disponible sur le site de l’ Onu sont sans appel.
Ce Comité constate « une législation et des politiques publiques fondées sur le modèle médical et des approches paternalistes du handicap » qui « met l’accent sur l’incapacité des personnes handicapées et fait de l’institutionnalisation la norme », qui « fait perdurer l’institutionnalisation systématique de personnes sur la base de leur handicap ». Il demande à « empêcher le placement en institutions fermées » et à en « finir avec l’institutionnalisation des adultes et des enfants en situation de handicap » en mettant en œuvre des méthodes « respectant les droits humains tels que la dignité, l’égalité, la liberté l’autonomie et l’accessibilité, qui comprend le soutien de ses pairs » ainsi que « le droit de vivre de manière indépendante et dans la communauté ».
La France est donc loin d’être en conformité avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées, en particulier parce qu’elle ne remet pas véritablement en cause le modèle de l’institutionnalisation et parce que les politiques qu’elle met en œuvre sur le handicap ne sont pas fondées sur les droits humains.
Ce rapport doit nous amener à nous positionner éthiquement, politiquement et syndicalement par rapport à l’institutionnalisation. Pour SUD éducation, il y a urgence à convaincre que tou·tes les élèves ont leur place à l’école et que c’est bien à l’école qu’il revient de garantir des compensations du handicap afin d’en finir avec le validisme et la ségrégation scolaire et sociale.
Des Pials aux Pas…
Il faut d’urgence abandonner cette machine à morceler l’accompagnement qu’est le PIAL, de donner des moyens pour l’accueil de tou·tes les élèves à l’école quelques soient leurs besoins et créer un vrai statut de la Fonction publique pour les AESH.
La mise en place des PIALS (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés), instaurée par la loi du 26 juillet 2019, en renforçant la mutualisation des moyens humains, a eu pour conséquence de réduire le temps et la qualité d’accompagnement des élèves handicapé·es en classe. La moyenne serait de 6 heures d’accompagnement par élève. Les moyens alloués ne permettent pas de mettre en place une véritable politique d’accompagnement qui tendrait vers une autonomie progressive en fonction des besoins de l’élève pendant les temps de cours. Et il n’a pas du tout été prévu de temps dédiés pour reprendre ces cours et apporter une aide spécifique aux devoirs. On est – sous prétexte d’autonomisation des élèves et d’inclusion– dans une logique de réduction budgétaire des moyens.
L’acte II de l’école inclusive et ses douze mesures, annoncées lors de la 6 ème conférence du handicap qui s’est tenue le 26 avril 2023 à l’Elysée, n’échappe pas à cette logique financière. Aucun texte ne cadre pour l’instant ces annonces. Mais on peut repérer plusieurs points inquiétants.
Les Pials seraient remplacés par des Pas (Pôles d’Appui à la Scolarisation). Un nouveau statut, parallèle à celui des AESH (Accompagnantes d’Elèves en Situation de Handicap) serait créé : ARE (Agent à la Réussite Éducative). Ces nouveaux acronymes font disparaître la notion de handicap, ils s’accompagnent également d’une volonté d’étendre les missions actuelles des AESH pour “régler” la question des temps de travail incomplets. On pourrait se réjouir que les élèves handicapé‧es, comme nous le revendiquons à SUD éducation, soient considérés comme des élèves à part entière. Mais la négation du handicap n’est en revanche pas forcément le signe d’une société véritablement inclusive. C’est ainsi que les missions de la MDPH seraient réduites : les équipes éducatives auraient à charge de définir les besoins des élèves handicapé‧es, sauf pour certaines situations lourdes. Le gouvernement annonce pour remplir cet objectif un plan de formation renforcée à destination des personnels. Si les moyens et la formation ne sont pas à la hauteur des enjeux, on peut imaginer que les personnels vont rapidement se retrouver à gérer la pénurie et à prendre des décisions, prises auparavant par une équipe pluridisciplinaire. On déspécialise la scolarisation des élèves handicapés. On le voit également à la création et l’augmentation de dispositifs comme les UEMA (Unités d’Enseignement Maternel Autisme), les UEEA (Unités d’Enseignement Elémentaire Autisme) et surtout les DAR (Dispositifs d’autorégulation) qui ne seraient plus coordonnés par des enseignant‧es spécialisé‧es,
De l’autre côté, le gouvernement annonce qu’une partie des moyens alloués aux établissements spécialisés serait transféré vers les écoles et établissements avec l’implantation d’unités d’enseignement d’Itep ou d’IME et de services médico-sociaux, comme les Sessad mais déspécialisés. On peut se réjouir en théorie que l’école soit rendue accessible à des élèves dont le parcours de scolarisation était ségrégué. On peut se réjouir également d’un renforcement des liens entre le médico-social et l’école. On s’étonnera que les personnels concernés des établissements spécialisés ne soient pas du tout tenus au courant de ces transformations de leurs métiers. Et on peut craindre fortement d’aboutir à un saupoudrage des moyens en lieu et place du suivi spécifique et personnalisé que ces structures offraient jusqu’à présent. Les élèves risquent d’en être insécurisé·es, de subir une forme de maltraitance institutionnelle et les personnels d’être confrontés à des situations compliquées, comme on le voit souvent déjà par manque de moyens, d’accompagnement et d’encadrement spécifiques, pour lesquelles la création d’équipes mobiles apporte une réponse limitée. Sans parler du problème de place dans les écoles, on peut se demander également si la confusion des lieux dédiés au médico-social et à l’apprentissage scolaire est un élément structurant pour les élèves.
Les droits des enfants, c’est aussi ceux des élèves handicapé‧es et notamment de l’accessibilité à l’école. Pour favoriser cette accessibilité, le handicap ne saurait être nié. Si la scolarisation des élèves handicapés doit devenir l’affaire de toutes, on prendrait des risques pour les enfants à la déspécialiser.
Enfin, une autre question fondamentale est celle de la formation. Si on regarde du côté des AESH, le droit à la formation, pourtant inscrit dans les textes, est entravé : défaut d’offre de formation, contenu inadapté, problèmes d’accès à l’information, etc. Ces entraves au droit à la formation des AESH pèsent lourdement sur les pratiques professionnelles des collègues. L’absence de formation initiale en amont de la prise de poste oblige les collègues nouvellement recruté·es à s’auto-former et les place dans une situation professionnelle compliquée. Accompagner des élèves en situation de handicap dans leur parcours et leur vie scolaire ne peut pas s’improviser. De même, les pratiques professionnelles des AESH, tant elles sont diverses, nécessitent une formation tout au long de la carrière, pour les ré-interroger et les approfondir. Elles nécessitent par ailleurs, une co-construction et des échanges entre pair·es.
Rentrée 2023 : Toujours pas de respect des droits des élèves handicapé-es
Depuis la rentrée 2023, le Ministère de l’Education Nationale se targue de la mise en place de moyens inédits pour la scolarisation de ces élèves (source education‧gouv.fr) :
- + de 436 000 élèves en situation de handicap accueilli·es dans les établissements scolaires ;
- 3,6 % des élèves en situation de handicap dans les écoles et établissements scolaires ;
- + de 132 000 accompagnant-es d’élèves en situation de handicap ;
- + de 164 000 livrets de parcours inclusif ;
- Pour les accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH) : 6 500 postes supplémentaires et des mesures de revalorisation ;
- L’ouverture de 37 unités d’enseignement maternelle autisme (UEMA), de 44 unités ;d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et de 29 dispositifs d’auto-régulation (DAR) ;
- La création de 25 postes de professeurs ressources troubles du neurodéveloppement (TND) ;
- Une nouvelle mission proposée aux professeurs dans le cadre du Pacte enseignant : l’appui à la prise en charge d’élèves à besoins particuliers dans le premier et le second degrés ;
- La mise en œuvre des mesures de la Conférence nationale du handicap 2023.
Pour SUD éducation, les effets d’annonce du ministère cachent les réalités de terrain des collègues, des élèves et de leurs familles pour qui l’inclusion et le droit à la scolarisation restent un combat quotidien.
De l’aveu même de la Défenseure des droits, les moyens ne sont pas à la hauteur pour la mise en œuvre d’une école réellement inclusive :
« Le comité des droits de l’enfant de l’ONU a par ailleurs demandé expressément en juin dernier à la France de prendre toutes mesures permettant d’améliorer significativement l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. »
« La Défenseure des droits constate que les établissements scolaires, faisant face à un nombre d’élèves par classe souvent très élevé, et très sollicités pour la mise en œuvre de l’école inclusive, ne se voient pas allouer les moyens nécessaires pour permettre une inclusion respectueuse des droits et de l’intérêt supérieur des enfants concernés. Elle réitère ainsi ses recommandations et appelle urgemment les pouvoirs publics à mobiliser les moyens indispensables pour garantir l’école inclusive. »
Depuis la rentrée scolaire, les constats remontés par les équipes pédagogiques sont sans appel : manque de personnels AESH, manque de places dans les dispositifs existants (écoles, médico-social…), difficultés/refus d’accès au temps périscolaires (cantine, centres de loisirs…), manque de formation des personnels (enseignant-es et non enseignant-es), difficultés de mise en place d’aménagements pédagogiques dans des classes déjà surchargées, manque de matériel adapté, inaccessibilité de certains bâtis scolaires…
Du côté des familles, des centaines de témoignages ont été publiés dans la presse, révélant un nombre considérable d’élèves sans scolarisation aucune ou avec des scolarisations partielles, les obligeant à rester chez elles ou eux ce qui accentue la charge parentale, que l’on sait majoritairement reposer sur les épaules des femmes.
SUD éducation dénonce cette situation depuis des années. La mise en application du droit pour tou·tes les élèves de nos territoires reste une lutte essentielle à mener au sein de notre système éducatif.
SUD éducation revendique :
- Des moyens pour accueillir et répondre aux besoins de tou·tes les élèves qu’importe leur situation scolaire, sociale, administrative, leur origine ou leur handicap… sur tout le territoire,
- La création massive de postes d’AESH, de RASED, de personnels médico-sociaux, d’enseignant·es, de CPE et de personnels de Vie scolaire et d’interprètes ;
- La création d’un vrai statut de la Fonction publique d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e pour les AESH, de réelles augmentations de salaire et la reconnaissance d’un temps plein correspondant à 24h d’accompagnement ;
- La baisse des effectifs par classe ;
- Une véritable formation initiale et continue à l’inclusion scolaire adaptée aux besoins des élèves et des personnels avec des temps de co-formation et de concertation pour toutes les personnels ;
- L’adaptation des bâtiments et du matériel scolaire ;
- Du temps de concertation hebdomadaire institutionnalisé et consacré à l’inclusion des élèves à besoins spécifiques à accueillir.
Nous avons de plus en plus d’enfants de familles dit·es sans papier et à la rue, mais aussi de Jeunes isolé·es étranger·ères, dans nos classes. Par ailleurs, les élèves français⋅es allophones rencontrent les mêmes problématiques et ne bénéficient trop souvent d’aucun dispositif spécifique ou d’aucune mesure adaptée au fait qu’ils et elles relèvent des élèves à besoin particulier.
Pendant très longtemps la scolarisation des élèves dit·es étranger.ères n’est pas mentionnée dans les textes officiels français. La loi d’obligation scolaire du 28 mars 1882 dite lois Jules Ferry, n’instaure ni ne précise aucune condition de nationalité. La première circulaire qui officialise la possible présence d’élèves qui ne soient pas français·es date de 1936 : « L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de 6 à 14 ans révolus. » Si grâce à cette circulaire est inscrit le droit à être scolarisé‧e quelle que soit la nationalité, pendant plus de trente ans, c’est le principe d’égalité républicaine qui régit la façon d’envisager la scolarisation des enfants des étranger·ères qui viennent s’installer en France. Dans un contexte où le français n’est pas encore la langue maternelle de la totalité de la population et où l’une des missions des enseignant·es est de rayer les langues régionales de la carte de France, ce texte n’évoque pas la possibilité que ces élèves puissent avoir des besoins langagiers spécifiques. Au début des années 60, les chercheur·es en sciences sociales commencent à s’intéresser à la question de l’instruction des enfants d’immigré·es par le prisme des inégalités.
Après l’ouverture
A l’école aussi, les Clin (classe d’INitiation ), les Cla (cLasse d’accueil) et les Cla-ENSA (Élèves Non Scolarisé⋅es Antérieurement) ont été remplacées par des dispositifs UPE2A et UPE2A-NSA avec la circulaire d’octobre 2012 signée Jean Michel Blanquer. L’idée principale était d’inclure davantage les élèves dans leur classe d’affectation. En réalité, l’Éducation nationale a fait des économies en supprimant des heures pour récupérer des postes. En effet, dans les classes d’accueil les élèves bénéficiaient de 23 à 26 heures de cours par semaine. Aujourd’hui dans les dispositifs les élèves n’ont plus que 9 à 18 heures de cours hebdomadaires. Dans le 1er degré la notion de dispositif a permis à l’administration de ne fixer aucune limite au nombre d’élèves accueilli·es. S’ajoute à cela un parcours des familles très difficile pour intégrer un dispositif, un racisme institutionnel et une orientation déterminée. Sans compter la problématique du logement et des démarches administratives qui ne facilitent pas des apprentissages dans de bonnes conditions. Une seule année en dispositif UPE2A est insuffisante pour une inclusion totale dans une classe. Ces élèves ont besoin de temps, ils et elles ont vu et vécu parfois des événements très lourds et marquants dans leur pays d’origine.
SUD éducation dénonce l’hypocrisie de l’Éducation nationale : dans les textes il y a bien obligation de scolarisation des enfants étranger·ères sur le territoire français, en réalité les moyens alloués pour ces élèves se réduisent à peau de chagrin depuis 2012 et sont insuffisants au vu de leurs conditions de vie.
SUD éducation revendique :
Pour la liberté de circulation et d’installation :
- la régularisation de tou⋅tes les sans-papiers ;
- la fermeture des centres de rétention administrative et l’arrêt des expulsions ;
- l’abrogation de tous les textes qui entravent la liberté de circulation et d’installation (circulaire Valls, règlement Schengen, loi Immigration…) ;
- le respect du droit d’asile inconditionnel.
Pour le respect des droits :
- l’abolition réelle de la double-peine et la libération de toutes les personnes emprisonnées pour défaut de papiers ;
- l’accès à un logement, à l’école, aux soins et à la santé pour tou⋅tes.
Pour les élèves allophones arrivant⋅es :
- la scolarisation inconditionnelle des jeunes étranger·ères allophones au sein du service public d’éducation indépendamment de l’âge, la nationalité et du statut administratif ;
- l’ouverture de dispositifs UPE2A partout où cela est nécessaire, notamment à côté des structures d’hébergement de personnes exilé⋅es ;
- des effectifs de 15 élèves maximum en UPE2A et 12 élèves maximum en UPE2A-NSA et leur prise en compte dans les effectifs des classes ;
- une durée d’accueil des élèves dans les dispositifs adaptée aux besoins de chaque élève pour une orientation choisie et non subie ;
- la formation des personnels aux besoins spécifiques des élèves allophones, le développement de l’enseignement du français langue seconde au moyen de décharges horaires ;
- la création de postes d’interprètes dans l’Éducation nationale ;
- l’enseignement des langues d’origine des élèves dans les établissements ;
- la traduction des documents officiels dans une langue comprise par les responsables légaux de l’élève ou par l’élève.
La scolarisation des élèves dit·es migrant·es
Officiellement, la scolarisation des enfants, quel que soit leur âge, ne peut être soumise à la possession d’un titre de séjour. Celui-ci ne peut donc pas être exigé lors de l’inscription ou de l’admission de l’élève à l’école.
De même, les mineur·es ne sont pas en « situation irrégulière », puisqu’ils et elles n’ont pas besoin de titre de séjour et sont protégé·es contre les mesures d’éloignement du territoire (contrairement à leurs parents).
Il faut distinguer la scolarisation dans le 1er et dans le 2nd degré pour plusieurs raisons :
- En termes d’appareil juridique, nous le verrons, les outils sont différents ;
- En termes de lutte, il n’existe pas de Mineur·e Non Accompagné·e dans le 1er degré contrairement au second degré. Les élèves des écoles maternelles et primaires sont généralement présent·es avec leurs parents. On pourra donc les associer à la lutte. La minorité des élèves dans les écoles ne peut pas être contestée contrairement aux élèves du second degré.
Accès à l’école dans le 1er degré :
Outre les conventions internationales, signées par la France, l’article L111‑2 du Code de l’Éducation est très clair : “Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.”
Dans la circulaire 2014 – 88, définissant le règlement départemental type des écoles maternelles et primaires, le texte rappelle : “En application de l’article L. 111 – 1 du Code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.”
L’inscription est-elle soumise à la situation administrative des parents ? NON
“aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation” (Circulaire 2003 – 63).
Instruction et scolarisation, est-ce différent ? OUI
La loi prévoit que tout·e enfant doit être instruit·e de 3 à 16 ans. Cependant, le passage par l’école n’est pas obligatoire. Les parents peuvent instruire leur enfant par eux et elles-mêmes. Par contre, si les parents d’enfants, âgé·es de 3 à 16 ans, souhaitent que l’instruction passe par l’école, alors l’accès à la scolarisation doit être mis en œuvre par l’Etat. Elle est soumise à condition pour les enfants de moins de 3 ans. Refuser l’accès à l’école pour les enfants de familles étrangères conduirait à mettre ces mêmes familles dans une situation illégale au regard de l’obligation d’instruction de leur enfant.
L’inscription se fait-elle uniquement par les parents ou représentant·es légaux‧les ? NON
Nul besoin d’être dépositaire d’une autorité légale pour inscrire un enfant. En effet : “ Les dispositions législatives relatives à l’obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d’assurer son instruction (article L.131 – 4 du code de l’éducation) : “ Dans ce cas, la preuve que l’enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique…). L’inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être subordonnée à la présentation par la personne qui inscrit l’enfant d’un acte de délégation de l’autorité parentale. “.
La justification de domicile est-elle obligatoire pour l’inscription ? OUI
Les parents cèdent l’instruction de leur enfant à l’école, il ou elle doit être alors inscrit·e dans leur commune de résidence. Pour prouver sa domiciliation, la famille peut fournir une attestation sur l’honneur ou une attestation délivrée par une association agréée. Le CCAS de la commune peut également délivrer un attestation de domicile mais sous certaines conditions. En effet des restrictions sont apparues en 2021, dans l’article 264 – 2, du Code de l’Action Sociale et des Familles. Si l’un·edes parents est d’origine extra-Européenne, qu’il ou elle n’a pas de titre de séjour, il ou elle peut alors bénéficier d’une attestation SI il ou elle sollicite l’AME, l’aide juridictionnelle ou une aide juridique. Certaines associations comme la Croixouge permettent aussi d’avoir une adresse postale. Il ne faut pas hésiter à aider les parents à se rapprocher d’elles.
En cas de déménagement, l’enfant peut-il ou elle terminer son année scolaire dans dans son école ? OUI
Article Code de l’Éducation L212‑8 : “La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.”
La stratégie des autorités reposera sur l’envoi des familles loin de l’école, si possible avec des transports scolaires compliqués voire inexistants, obligeant de fait la désinscription de l’enfant d’une part et de reprendre à zéro la scolarisation. Cependant le déménagement ne doit pas être une raison de désinscription automatique.
Le ou la Maire a‑t-il ou elle le dernier mot lors de l’inscription de l’enfant ? NON
En effet, considérant parfois que le ou la maire ayant le dernier mot en termes d’inscription, les directeurs et directrices d’école pensent que ceci empêche l’accès à l’école. Or si les parents décident de déléguer l’instruction de leur enfant à l’Education nationale. Celle-ci doit obligatoirement la prendre en charge ce qui peut l’amener à contredire un·e maire récalcitrant·e. Comment ?
Le règlement départemental type (circulaire 2014-088) des écoles maternelles et primaires répond très clairement à cette situation :
“Le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera ;
- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111 – 2 et L. 3111 – 3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).
Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article article L. 131 – 1‑1 du code de l’éducation à une admission provisoire de l’enfant.”
Le directeur ou la directrice de l’école peut procéder à une admission provisoire.
Des recours existent :
Le Dasen peut interpeller le Préfet sur cette question Article L131‑5 du Code de l’Éducation.
“En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122 – 34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.”
En effet, le ou la Préfet·e peut procéder à l’inscription si le ou la Maire refuse. Article L2122-34 du code générale des collectivités territoriales.
“Dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’Etat dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial.”
Si ces autorités défaillent, on peut saisir le-la Défenseur·e des droits ou déposer un recours en urgence au Tribunal Administratif. Des juges ont déjà condamné des Maires et des Préfet·es.
Le cas des élèves allophones
Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012
L’obligation d’accueil dans les écoles et les établissements s’applique de la même façon pour les élèves allophones nouvellement arrivés en France que pour les autres élèves.
L’espace d’accueil est le lieu unique d’accueil pour la scolarisation des enfants allophones de 6 à 17 ans.
Les familles ont un entretien et les élèves sont testé·es dans la langue première. Suite à ce test, la famille reçoit une proposition d’affectation. Cette proposition d’affectation passe par un service du rectorat qui envoie une notification à la famille et à l’établissement retenu.
À l’école élémentaire, tout élève allophone arrivant bénéficie d’une évaluation menée par la personne nommée par l’inspecteur de l’éducation nationale, avec le concours des formateurs du Casnav.
Dans le second degré, en fonction du nombre d’élèves à accueillir, les centres d’orientation et d’information, de manière déconcentrée ou au sein des cellules d’accueil mises en place dans les services départementaux de l’Education nationale apportent leur contribution à l’établissement d’accueil, dans cette procédure d’évaluation.
L’inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation.
Les élèves allophones arrivants sont inscrit·es obligatoirement dans les classes ordinaires de l’école maternelle ou élémentaire. À partir du cours préparatoire, les élèves peuvent être regroupé·es dans des Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) pour un enseignement de français comme langue de scolarisation, quotidien et pour un temps variable.
Un·e élève peut bénéficier des structures UPE2A un an, exceptionnellement 2.
Les groupes pris en charge en UPE2A ne doivent pas dépasser 15 élèves.
Le cas particulier des élèves NSA (Non Scolarisés Antérieurement) ou PSA (Pas Scolarisés Antérieurement) relèvent dans le premier degré des UPE2A, dans le second degré d’UPE2A spécifiques : UPE2A-NSA.
Accès à l’école dans le second degré :
La circulaire n° 2002-063 du 20 – 3‑2002 régit très clairement les conditions d’inscription de scolarisation des élèves du second degré.
Concernant l’inscription :
L’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans, si les parents le désirent, ils et elles peuvent inscrire leur enfant dans le collège ou le lycée de secteur auprès des services de la DSDEN. A savoir qu’il peut aussi s’agir de personnes disposant d’une délégation de l’autorité parentale, ou exerçant sur l’enfant une « autorité de fait » établie par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique…).
En aucun cas, l’inscription ne peut être refusée au motif que la personne qui accompagne l’enfant ne dispose pas de titre de séjour
Pour les Mineur·es non accompagné·es, ce sont les Conseils Départementaux qui doivent procéder à l’inscription.
De 16 ans à 18 ans, “même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire” comme indiqué dans la circulaire. Le refus de scolarisation doit être motivé ((arrêt de section du Conseil d’État du 23 octobre 1987 consorts Métrat).
Attention, les services de protection à l’enfance de certains conseils départementaux considèrent qu’ils sont libérés des obligations scolaires des mineur·es non accompagné·es dès que les 16 ans sont atteints. Or comme le rappelle l’ordonnance du 12 juillet 2016, du Tribunal Administratif de Poitiers, le refus par les services du département d’inscrire en formation un·e mineur·e isolé·e –quel que soit son âge– confié par décision judiciaire constitue une atteinte au droit à l’instruction.
Le certificat de scolarité peut être établi dès l’inscription effectuée.
Voyages scolaires :
Vraiment pas simple à organiser selon les destinations et l’origine des élèves à emmener. Toutes les conditions sont décrites dans cette circulaire : Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
A savoir que le ou chef·fe d’établissement peut faire la demande d’un passeport collectif permettant des prises en charges moins complexes.
Stages en entreprise :
S’il s’agit d’un stage sous statut scolaire, il n’y a aucun problème, en lycée général comme en lycée pro. Pour les élèves majeur·es, certain·es patron·es vérifient malheureusement le titre de séjour. Il faut le savoir
En ce qui concerne les apprenti·es, ils et elles dépendent du ministère du travail et doivent être autorisé‧es à travailler, surtout au passage de la majorité. Ni Patron, ni CFA ne pourront rien faire si le ou la jeune majeure n’a pas de titre de séjour travail.
Les bourses :
Aucune condition de régularité du séjour ne peut empêcher l’accès aux bourses. Seules les ressources financières de la famille ou de la personne ayant “la charge effective et permanente” sont considérées. Un·e élève majeur·e peut déposer une demande de bourse en son nom.
Les bourses peuvent être complétées par une prime à l’internat et aux trousseaux pour les élèves des lycées pros (code de l’Éducation articles D 531 – 27 , 29 et 42 ).
La justification des ressources se fait sur présentation de l’avis d’impôt. Si l’élève et/ou sa famille viennent d’arriver, cela ne peut les empêcher d’accéder aux demandes de bourses. En effet, les circulaires d’applications prévoient l’examen de la demande “à la lumière de toute justification de ressources” telles que avis d’imposition du pays d’origine de l’année précédente si possible ou présentation de bulletins de salaire.
La non présentation d’un RIB ne doit pas empêcher l’accès à la demande de bourses. Aucun moyen de paiement n’est stipulé dans les circulaires.
Enfin des bourses multiples existent : bourses aux mérites, bourses dans les lycées agricoles, bourses départementales ou régionales aux critères multiples et variées.
La cantine :
Les enfants de familles migrantes ont aussi le droit à l’accès au service de restauration s’il existe dans le premier degré et obligatoire dans le second degré. Ils et elles ont aussi le droit d’accéder aux tarifs correspondants aux ressources familiales. Si la famille est sans ressource, elle peut présenter une attestation sur l’honneur. En cas de refus, un avis d’imposition.
Examens :
Comme rappelé dans la circulaire n° 2002-063 du 20 – 3‑2002, l’élève doit prouver que c’est bien lui pour elle qui compose ou expose. Un document tel que passeport, même périmé, ou certificat de scolarité récent avec une photographie et certifié, suffira. L’élève ne doit pas fournir un titre de séjour.
2.5 - Les réformes d’Attal, le “Choc des savoirs” sont des attaques au droit des élèves d’accéder à un même enseignement !
Pendant longtemps, le système scolaire témoignait d’une forte ségrégation : ségrégation de genre et ségrégation sociale. L’enseignement secondaire ne succédait pas à l’enseignement primaire : il s’agissait de deux voies différentes pour deux publics différents. Selon leur milieu d’origine, les élèves allaient, à la sortie de l’école élémentaire, soit vers l’enseignement primaire supérieur (4 ans après le certificat d’étude), soit vers l’enseignement secondaire long (7 ans d’étude jusqu’à la terminale), soit vers les centres d’apprentissage.
Néanmoins, ce modèle en trois voies socialement ségréguées ne permet pas de répondre aux besoins économiques et à la nécessité d’élever le niveau scolaire moyen de la population. En 1959, la scolarité obligatoire passe de 14 à 16 ans : les cours complémentaires de l’enseignement primaire supérieur deviennent des collèges d’enseignement général (CEG). Les centres d’apprentissage deviennent des collèges d’enseignement technique (CET). Les élèves suivent un cycle d’observation de deux ans (6e et 5e) avant d’être orientés vers les CET ou les CEG. Ce modèle d’orientation précoce montre que, dans un système éducatif, plus l’orientation a lieu tôt, plus elle est le fruit de déterminismes sociaux.
En 1963, des collèges d’enseignement secondaire (CES) sont instaurés, mais il faut attendre la loi Haby du 11 juillet 1975 pour supprimer la distinction entre CES et CEG qui deviennent tous des collèges. Les élèves ont ainsi tou·tes accès à un même enseignement jusqu’à la fin du collège, filles comme garçons, élèves des classes populaires comme des classes aisées. Les élèves en situation de handicap restent exclu·es de l’école et relégué·es à des structures spécialisées.
Depuis sa mise en oeuvre en septembre 1977, le collège unique est confronté à la difficulté de garantir un même enseignement à des élèves au niveau hétérogène : le collège unique est un projet émancipateur mais, pour fonctionner, il faut lui donner les moyens de compenser les difficultés scolaires et sociales des élèves, le collège unique est indissociable d’une politique de lutte contre les inégalités. Or, on observe que la politique d’éducation prioritaire est en panne : les collèges de REP n’ont pas les moyens de fonctionner : classe trop chargée, bâti délabré, turn-over des personnels en raison des conditions de travail dégradées… De même, la politique de scolarisation de tou·tes les élèves nécessite d’engager des moyens supplémentaires pour baisser le nombre d’élèves par classe, pour former les personnels et pour recruter des personnels spécialisés.
SUD éducation dénonce les suppressions de postes opérées depuis l’élection de Macron en 2017. Le collège unique subit une asphyxie de moyens qui a conduit à une dégradation des conditions de travail et d’étude et à des résultats insuffisants. Or, aujourd’hui, plutôt que de donner au collège les moyens de garantir la réussite de tou·tes les élèves, Attal et Belloubet reviennent sur le projet même du collège unique. Deux mesures sont particulièrement inquiétantes : les groupes de niveau et la nécessité d’avoir le Diplôme National du Brevet (DNB) pour accéder au lycée.
Malgré le recul du gouvernement sur la manière de qualifier les groupes, la réforme imposée par Gabriel Attal et mise en oeuvre par Nicole Belloubet reste bien une réforme de tri social.
L’organisation en groupes concerne l’ensemble du volume horaire disciplinaire de français et de mathématiques : les élèves seront donc répartis sur 1/3 du temps scolaire selon leur niveau. Pourtant l’ensemble de la recherche en sciences de l’éducation montre que, si les groupes de besoin ponctuels peuvent avoir un effet positif sur les résultats des élèves, les groupes de niveau sur l’ensemble du volume disciplinaire ont pour effet de niveler le niveau des élèves en difficulté vers le bas.
Si le ministre parvient à mettre en oeuvre cette organisation scolaire, on peut craindre de voir les élèves allophones ou les élèves en situation de handicap relégués dans les groupes de niveau d’élèves les plus faibles alors que c’est l’hétérogénéité du groupe-classe qui permet aux élèves de progresser. De même, on peut craindre que les filles soient sur-représentées parmi les élèves en difficulté en mathématiques. Les groupes de niveau enferment les élèves dans leurs difficultés. Enfin, on peut douter de la manière dont ces groupes seront constitués et de la possibilité pour des élèves d’aller d’un groupe à l’autre : cela forcerait les enseignant·es à suivre la même progression trimestrielle, au mépris de la liberté pédagogique, et pour des élèves de 6eme et de 5eme de changer de groupe et d’enseignant·es plusieurs fois dans l’année.
Les annonces au sujet du Brevet sont tout aussi inquiétantes. Attal veut faire du Brevet un examen d’entrée au lycée. Le Brevet sera plus difficile à obtenir pour les élèves les plus en difficulté et des académies les plus défavorisées avec le rééquilibrage entre épreuves ponctuelles et moyennes disciplinaires annuelles à 50 – 50 et l’abandon des correctifs académiques. On peut craindre une fuite massive vers les collèges privés. Les élèves qui échoueront au Brevet devraient aller en “prépa-lycée”, véritable classe de relégation qui risque de démoraliser les élèves en attente d’une affectation en seconde.
Avec ces annonces, Attal et Belloubet instaurent une véritable politique de tri social qui se nourrit du renoncement à la garantie d’un même enseignement pour tou·tes les élèves. Ils recréent des classes et des groupes de relégation pour les élèves aux difficultés scolaires et sociales or l’histoire de l’école a montré à de nombreuses reprises le lien fort entre ségrégation scolaire et ségrégation sociale.
Mais le Choc des savoirs ne se résume pas aux groupes en français et en mathématiques et à la sélection à l’entrée du lycées, il y a aussi la labellisation des manuels et des annonces de généralisation des évaluations nationales du CP à la 4eme. Nous devrions garantir aux enfants le droit à une école qui prépare la société de demain : une société plus juste, plus inclusive, prête à affronter le défi de la bifurcation écologique, or le Choc des savoirs dessine une école qui évalue, qui sélectionne et qui trie, c’est le prolongement de la réforme du lycée dont on a vu les effets dévastateurs sur les lycéen·nes : avec la pression du contrôle continu les élèves n’ont plus le temps d’apprendre et sont soumis.es à un stress permanent. SUD éducation appelle les personnels à refuser toutes les réformes de tri social.
Après l’annonce du Choc des Savoirs, Attal a annoncé une série de mesures affectant l’école et sanctionnant les élèves, parmi lesquelles le retrait de points sur le brevet ou sur le bac avec une mention dans Parcoursup en cas d’événements disciplinaires survenus pendant la scolarité de l’élève et l’introduction de la réalisation d’activités d’intérêt général au sein de l’établissement scolaire pour effacer la mention et regagner les points. Ces dispositions sont de véritables ruptures du principe d’égalité des candidat·es à un examen national : Attal va plus loin que la très controversée note de vie scolaire puisque les élèves seront doublement sanctionnés : d’abord par la voie disciplinaire puis dans leur accès aux diplômes et à une orientation choisie. Cette sanction n’a aucune portée éducative et contrevient au rôle du service public d’éducation, qui doit aider les élèves à sortir de leurs difficultés, non les y enfoncer.
Ces mesures visant les examens et Parcoursup s’ancrent dans le renforcement d’un arsenal judiciaire qui tranche avec les dispositions de la Cour Internationale des Droits des Enfants qui disposent que leur intérêt supérieur est une considération primordiale pour chacun·e. L’État leur doit la protection, qu’importe les actes commis. SUD éducation dénonce toutes les mesures qui bafouent les droits des personnes mineures : la remise en cause de l’excuse de minorité, l’abaissement de 18 à 16 ans pour la mise en place d’une comparution immédiate devant le tribunal, les mesures de composition pénale qui permettrait la mise en œuvre d’une sanction sans procès contre un·e mineur·e de plus 13 ans, les comparutions immédiates pour les jeunes identifié·es dans les écoles comme « commençant à partir à la dérive ». La place des personnes mineures est à l’école et non sur les bancs des accusé·es dans les tribunaux.
Pour habiller ses mesures iniques et dangereuses, Attal livre un ensemble de dispositions qui n’ont de républicaine que l’apparence. Il entend par exemple renforcer les équipes « valeurs de la République » dans les établissements scolaires et créer un contrat d’engagement à respecter l’autorité et les valeurs de la République entre les parents, les établissements et les élèves : Gabriel Attal réinvente donc le règlement intérieur qui existe pourtant déjà. La politique menée par le premier ministre tend à faire croire que l’école serait menacée par des élèves qui ne respecteraient pas la laïcité et les valeurs de la République. Pourtant en janvier 2024, on recensait uniquement 280 faits d’atteinte au principe de laïcité, alors que l’école accueille tous les jours 12 millions d’élèves. Gabriel Attal fait d’événements rares une priorité politique de premier ordre dans l’unique dessein de séduire l’électorat d’extrême droite et de créer un sentiment de peur dans la société. Sans avoir besoin de les nommer, le premier ministre pointe du doigt dans son discours les personnes pauvres, les personnes immigrées, les personnes racisées et les personnes musulmanes ou supposées comme telles. SUD éducation dénonce le racisme et l’islamophobie qui sous-tendent ces annonces.
Il faut pourtant rappeler que l’État est le premier responsable de l’insécurité dans les écoles et les établissements scolaires puisqu’il ne met pas les moyens en oeuvre pour assurer la sécurité des élèves et des personnels : l’école manque de personnels de Vie scolaire, de personnels médico-sociaux, d’enseignant·es… les élèves ne sont pas suffisamment accompagné·es et protégé·es dans leur scolarité. 3000 enfants dorment à la rue, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, 10% des élèves sont victimes de harcèlement scolaire, les jeunes placé·es en famille d’accueil ont deux fois moins de chances que le reste de la population d’obtenir le baccalauréat : les réponses ne doivent pas être répressives mais éducatives et sociales. Le ministère de l’Éducation nationale refuse toujours aux Assistant·es de Service Social les revalorisations salariales indispensables pour recréer de l’attractivité et recruter ces personnels dont l’école manque cruellement.
3 - Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
L’affaire Duhamel et la vague de témoignages sur les réseaux #Metooinceste a mis en lumière les violences sexuelles sur les enfants et l’omerta qui les accompagne. En France, un·e enfant sur 10 est victime d’inceste selon une enquête d’Ipsos sur l’inceste. Au primaire, c’est en moyenne 1 enfant par classe, au secondaire 2 ou 3. Face à ces chiffres alarmants, l’Éducation nationale ne donne toujours pas les moyens nécessaires pour mener des programmes de prévention qui favorisent l’accueil de la parole et abordent la question du consentement, pour assurer la protection et l’accompagnement des victimes, pour recruter des personnels médico-sociaux. Il y a urgence à recruter des personnels comme des infirmier·es scolaires, médecins scolaires, assistant·es de services sociaux et psyEN.
Quelle réalité ?
Les violences sexuelles, ce sont 130 000 filles et 30 000 garçons victimes chaque année. Une fille sur cinq et un garçon sur treize en sont victimes au cours de leur vie.
- L’âge moyen des premières violences sexuelles est 10 ans. Ce sont des filles dans 83% des cas.
- 1 fois sur 5, ces violences sexuelles sont un viol.
- 44% des violences sont incestueuses.
- 96% des cas d’inceste commis par des hommes.
- 5% des victimes sont en situation de handicap au moment des faits.
- 50% des victimes de violences sexuelles durant l’enfance font par la suite une tentative de suicide.
- Avoir subi des violences durant l’enfance est le premier facteur de décès précoce et peut faire perdre jusqu’à 20 ans d’espérance de vie.
A l’instar des violences sexuelles sur les femmes et les minorités sexuelles, la majorité des enfants victimes de violences connaît son agresseur. C’est un membre de la famille, de la communauté éducative, du centre de loisirs, un adulte de confiance. Il s’agit d’événements quotidiens qu’invisibilise leur banalité.
Comment la loi caractérise les violences sexuelles sur mineur·es ?
Le cadre légal qui définit les violences sexuelles est renforcé si la victime est mineure.
Harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel est un délit.
Article 222 – 33 du code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Le code pénal définit comme circonstance aggravante le harcèlement sexuel sur un·e mineur·e quand :
- Un mineur assiste à un harcèlement sexuel ;
- Quand le harcèlement sexuel est réalisé par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime ;
- Si le harcèlement sexuel a lieu en ligne ou par un service de communication public.
L’agression sexuelle :
L’agression sexuelle est un délit.
222 – 22 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Article 222 – 22‑2 du code pénal : « Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. »
Le code pénal définit que cinq parties du corps entrent dans le cadre de l’atteinte sexuelle : les seins, la bouche, le sexe, les fesses et l’entrecuisse.
En dessous de 15 ans ou en cas d’inceste sur mineur, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne sont plus à démontrer pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans en général et de 18 ans dans les affaires d’inceste.
L’ Article 222 – 22‑3 définit la qualification d’incestueux des viols et des agressions sexuelles lorsque l’agresseur est un ascendant (parents, grand-parents, etc) ou toute autre personne ayant autorité de droit ou de fait (frère, sœur, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante, neveu ou une nièce ainsi que leurs conjoints ou concubins).
Le viol :
Le viol est un crime.
Article 222 – 23 du code pénal : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, (ou tout acte buco-génital) commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Le code pénal étend le crime de viol :
- Article 222 – 22‑1 : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale […] ou la surprise […] peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. »
- Article 222 – 22‑1 : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
Comment détecter des violences ?
Être vigilant·e : Les signaux de souffrance chez le OU la jeune enfant
Comportement de l’enfant :
- changement récent et massif du comportement (taciturne, très excité·e, triste, isolé·e, agressivité, disparition des conduites ludiques, pleurs…)
- attitudes craintives ou peureuses surtout vis-à-vis des hommes
- avidité affective
- dessins très sexualisés
- désinvestissement scolaire brutal, retard psychomoteur, difficultés scolaires non justifiées
- refus de rentrer à la maison
- refus de se coucher, de se déshabiller la nuit
- tendance à se barricader la nuit dans sa chambre
- troubles du sommeil avec terreurs nocturnes
- préoccupations sexuelles excessives pour l’âge de l’enfant, masturbation excessive et en public, comportement séducteur et sexualisé avec les adultes
Manifestations psychosomatiques :
- énurésie secondaire (incontinence), encoprésie (incontinence des matières fécales)
- constipation
- anorexie
- gêne de la déglutition
- vomissements
- douleurs abdominales
- douleurs diffuses
Pour l’adolescent·e, se surajoutent
Manifestations psychiatriques :
- dépression avec parfois tentative de suicide
- mutisme, repli
- scarification
- excitation, sautes d’humeur importante, réactions émotionnelles intenses
- comportement exagérément sexualisé
Conduites antisociales :
- fugue
- toxicomanie
- prostitution
- absentéisme scolaire inhabituel et injustifié
Manifestations psychosomatiques :
- troubles alimentaires (anorexie, boulimie)
- évanouissement, malaise
- mutisme, isolement,
- cynisme, provocation, agressivité
- rituels de lavage obsessionnels ou au contraire peur de la toilette des organes génitaux
La souffrance manifestée par un·e enfant ou un·e adolescent·e ne signifie pas forcément qu’il ou elle subit des agressions sexuelles, mais, quelle que soit la cause de ce mal-être, il faut lui venir en aide. On sait aujourd’hui que l’ensemble des conséquences des violences sexuelles est considérablement aggravé quand la réalité des faits n’a pas été prise en considération et que l’auteur n’a pas été sanctionné.
Que faire ?

Comment prévenir les violences sexuelles ?
Former les personnels :
- à la réalité des violences sexuelles, leurs typologies, les auteurs potentiels
- à percevoir les manœuvres d’approche développées par les pédocriminels
- à identifier les signaux faibles
- à repérer les interlocuteurs·trices institutionnels qui peuvent intervenir
- à maîtriser les aspects juridiques de base (droits fondamentaux des enfants)
- identifier les personnes ressources dans l’école /dans l’établissement /dans l’administration
- organiser l’échange de savoirs entre pairs
Sensibiliser les élèves, libérer la parole :
- être capable de parler de son corps, de ses sentiments
- repérer les situations à risques, les éviter
- apprendre à dire non
- savoir où trouver de l’aide
- travailler l’estime de soi
- travailler l’égalité fille-garçons
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation porte des revendications pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur mineur·es :
- l’application des circulaires et lois qui assurent la protection des mineur·es victimes de violences sexuelles ;
- la formation de tous les personnels de l’Éducation nationale à l’accueil de la parole des mineur·es victimes de violences sexistes et sexuelles, et à la question du consentement ;
- dans l’Éducation nationale, la suspension immédiate à titre préventif de l’agresseur dès lors qu’un·e enfant témoigne de violences ;
- des créations de postes suffisantes pour que chaque circonscription et chaque établissement soit doté de postes de médecins et/ou d’infirmier·es à temps plein et/ou d’assistant·es de services sociaux ;
- des moyens, du temps, de la formation et des personnels pour une éducation à la vie sexuelle et affective au-delà des 3 séances annuelles ;
- que l’administration procède à des signalements aux services de police sans aucune pression à l’encontre des élèves ou des personnels qui relatent des violences sexuelles dont ils ou elles ont recueilli le témoignage.
Des ressources
Associations :
- 119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger
- Face à l’inceste
- SOS Inceste & violences sexuelles
- Association AREVI (Action/Recherche et Echange entre les Victimes d’Inceste)
- Mémoire traumatique et victimologie
- Women Safe – Femmes et enfants victimes de violences
- Lamevi : l’association mille et une victimes d’inceste
- Collectif féministe contre le viol
Études :
- Le Berceau des dominations, Dorothée Dussy
- Le Livre noir des violences sexuelles, Muriel Salmona
- Penser les rapports de pouvoir adulte-enfant, Tal Piterbraut-Merx
- Enfance et vulnérabilité. Ce que la politisation de l’enfance fait au concept de vulnérabilité, Tal Piterbraut-Merx
Podcasts :
- Inceste et pédocriminalité, Un Podcast à soi, Charlotte Bienaimé – Arte radio
- Ou peut-être une nuit, Charlotte Pudlowski – Louie Media
- La Fille sur le canapé, Axelle Jah Njiké – Nouvelles écoutes
- L’Inceste, LSD, Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet
Expo :
- https://archives.lamaisonrouge.org/documents/mrjournalEspritFrancais9153.pdf
- https://archives.lamaisonrouge.org/fr/expositions-archives-detail/activites/l‑esprit-francais-contre-cultures-1969 – 1989/
Récits pour adulte :
- Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage, Maya Angelou
- L’Oeil le plus bleu, Toni Morrison
- Peau, Dorothy Allison
- Outrages, Tal Piterbraut-Merx
- La Familia grande, Camille Kouchner
- Le Consentement, Valérie Springora
- La Consolation, Flavie Flament
- La petite Fille sur la banquise, Adélaïde Bon
- Le Voyage dans l’Est, Christine Angot
- Un Amour impossible, Christine Angot
- Une Mélancolie arabe, Abdhellah Taïa
- Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine de Vigan
- Summer of love, Debbie Drechsler
- Daddy’s girl, Debbie Drechsler
Récits pour enfant :
- Le loup, Mai Lan Chapiron
Derrière la communication, le ministère oublie ses responsabilités
Dans une lettre aux professeurs d’octobre dernier, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse met en avant la campagne contre les violences sexuelles faites aux enfants. Si l’initiative d’une telle campagne est louable et affiche la volonté de protéger les enfants, une fois de plus le ministère se focalise uniquement sur les violences intrafamiliales et oublie d’y associer des moyens humains et matériels.
Le ministère communique mais n’augmente pas les moyens :
Comme le dit l’article du ministère « les enfants qui subissent des violences sexuelles ne savent pas quoi faire, ni à qui en parler ». Pour mettre fin à ce silence, tou·tes les personnels doivent être formé·es à l’accueil de la parole, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Trop souvent, la parole des enfants est minimisée voire remise en question, par manque de formation et d’information des personnels. Il est en effet très difficile d’entendre ces violences et d’en accepter la réalité, c’est pourquoi nous revendiquons que l’accueil de la parole soit enseigné lors de la formation initiale des enseignant·es et des CPE, puis que des formations soient proposées/imposées tout au long de la carrière. Les AED et AESH doivent aussi accéder à ces formations.
De plus, le manque de personnel social et de santé dans les établissements ne permet pas d’orienter correctement les enfants victimes ou témoins de telles violences. L’équipe pédagogique ne doit pas rester seule face aux enfants victimes de violences et doit pouvoir s’appuyer sur le travail du personnel médico-social (assistant·es sociales, infirmièr·es scolaires, médecins scolaires, psychologue de l’éducation nationale, etc) pour accompagner correctement ces élèves. La présence d’un·e assistant·e social·e et d’un·e infirmier·re scolaire à temps plein, et formé·e·s sur l’accueil de la parole des victimes, dans chaque établissement est indispensable pour répondre aux besoins des élèves.
Mettre fin à l’omerta : les violences n’ont pas lieu uniquement dans les familles :
L’école, premier lieu de sociabilisation et de parole après la famille, doit être un espace protecteur. C’est ce que le ministère précise dans son article « Agir contre les violences sexuelles faites aux enfants ». Mais comment afficher une telle volonté sans lever l’omerta quant aux violences sexuelles exercées par certains membres du personnel ?
Si la majorité des violences sexuelles subies par les enfants a lieu dans la famille ou l’entourage proche, il ne faut pas occulter l’existence de violences au sein même de l’école. Pourtant, les témoignages d’élèves victimes au sein de l’École sont trop souvent mis sous le tapis par les collègues, les chef·fes d’établissement ou les rectorats, sous prétexte de protéger la réputation d’un établissement ou de l’Éducation nationale. Et dans les rares cas où les rectorats essaient de prendre en compte la parole des élèves, ils s’en remettent souvent aux décisions de justice. Or on sait que le temps de la justice est long, et que les cas de judiciarisation de violences sexuelles sont rares et complexes. On sait que 50% des victimes de violences sexuelles durant l’enfance font par la suite une tentative de suicide. Les sanctions (ou absences de sanctions) judiciaires ne sont pas toujours adaptées à la protection des élèves. On a par exemple vu un professeur accusé de viol par des élèves autorisé à revenir devant des classes après un non lieu, alors même que l’enseignant a admis avoir eu un rapport sexuel avec une élève, mais a basé sa défense sur la supposition d’un consentement de celle-ci.
Apprendre ne doit jamais faire l’objet de relations ou pression sexiste, sexuelle ou pédocriminelle. Le silence des personnels et de l’institution apprend à nos élèves que dans notre société face aux violences sexistes et sexuelles les agresseurs sont protégés et les victimes ignorées.
Il est urgent qu’une réelle politique de prise en compte de la parole des enfants soit menée, afficher de beaux discours ne suffira pas à repérer ou éviter des violences si les actes ne suivent pas.
SUD éducation revendique :
- Le recrutement de personnels socio-médicaux pour prendre en charge correctement les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les élèves dans les établissements ;
- La formation de tous les personnels aux violences sexistes, sexuelles et pédocriminelles ;
- La suspension systématique des personnels agresseurs présumés, le temps des enquêtes administratives et judiciaires ;
- La radiation des personnels agresseurs condamnés par la justice ;
- La mise en place d’enquête et de mesures par l’administration parallèlement au travail de la justice ;
- L’accompagnement des élèves victimes par l’Education nationale dans leurs démarches médicales et juridique ;
- La mise en place de cellules d’écoute pour les élèves victimes de violences sexuelles dans l’Éducation nationale ;
- La mise en place d’une étude ministérielle sur l’ampleur des violences sexuelles à l’École.
Constat d’une infraction que faire juridiquement ?
En plus du signalement au procureur de la république vous pouvez :
Saisir Le·la défenseur·e des droits
En France, le·la Défenseur·e des droits est l’organisation désignée pour veiller au respect de ces droits. Elle s’assure du respect de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Elle peut être saisie par l’enfant lui-même, ou un adulte. Elle peut proposer la réforme de textes législatifs et/ou réglementaires. Elle peut également rédiger des recommandations à l’attention de l’administration.
Proposer une assistance juridique
Lorsqu’un·e enfant est victime d’un préjudice, iel bénéficie d’une protection spécifique par la loi. Iel peut se rendre seul·e dans les locaux de la police et ou de la gendarmerie. Au cours de la procédure, iel peut être représenté·e par ses parents, un adulte de son choix, une personne désignée par le tribunal, et iel a également le droit d’être assisté par un avocat gratuitement. Pour certaines infractions, l’avocat est obligatoire.
2023, c’est aussi 3 suicides, 3 victimes du harcèlement scolaire : Lucas, en janvier, Lindsay en mai et Nicolas en septembre. Chaque suicide affecte et touche toute la profession. La prise en compte par l’institution de la situation vécue par Nicolas, qui a mis fin à ses jours, conduit à s’interroger sur les réponses institutionnelles mais, au-delà de ces drames, il y a trop de situations qui ne sont pas bien prises en charge, pas prises en charge du tout voire pas du tout identifiées. Rien ne semble vraiment avoir changé ou presque 10 ans après le suicide de Marion, âgée de 13 ans. Les dysfonctionnements constatés dans l’académie de Versailles l’attestent. Le plan de lutte contre le harcèlement qui a été présenté, même s’il a le mérite de remettre ce sujet majeur sur le devant de la scène, ne permet pas une lutte efficace sur du long terme et manque cruellement d’ambition au niveau éducation.
Le Code de l’éducation prévoit le droit à une scolarité sans harcèlement. Le site du ministère propose différents outils pour lutter contre le harcèlement, mais sans moyens financiers et humains, cela reste du bricolage et de la communication.
Nommer les violences et le harcèlement LGBTIphobes, racistes, sexistes, validistes
De plus, il faut être en mesure de nommer les violences et le harcèlement LGBTIphobes, racistes, sexistes, validistes que subissent certain·es élèves, comme Dinah, jeune fille racisée et lesbienne, qui s’est suicidée en 2022. En France, 10% des élèves (soit environ 700 000 élèves) sont victimes de harcèlement. Les tentatives de suicide et les pensées suicidaires sont plus élevées chez les victimes de harcèlement scolaire (12 % et 36 %). 25% de l’absentéisme concerne des élèves victimes de harcèlement. Les LGBTIphobies en milieu scolaire et universitaire tuent. Les jeunes victimes d’homophobie et de transphobie sont 2 à 7 fois plus touché·es par le suicide que les autres jeunes.
Il faut de la concertation, de la formation, de la prévention
Les arrestations spectaculaires en milieu scolaire ne permettent pas de lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. Le déplacement des élèves harceleurs est une réponse uniquement répressive alors que la solution réside dans la prévention et donc dans la formation des équipes éducatives et dans la formation des élèves mais aussi dans la mise en place de dispositifs appropriés par tou·tes.
La lutte contre le harcèlement doit relever de dynamiques professionnelles collectives au sein des établissements. À ce titre, il faut du temps et de la concertation pour échanger entre collègues, construire des projets et améliorer le climat scolaire. La banalisation de demi-journées pour permettre aux équipes de construire de tels projets, à l’occasion notamment de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire qui a lieu le premier jeudi après les vacances d’automne est à ce titre un levier pertinent.
Pour lutter contre le harcèlement scolaire, SUD éducation demande la réduction des effectifs dans les classes et des établissements à taille humaine.
SUD éducation revendique davantage de personnels médico-sociaux avec notamment une infirmière et une assistante sociale par établissement et l’accès aux visites médicales auxquelles ont droit tous les élèves. Avec un médecin pour 12 000 élèves, l’accompagnement médical des élèves est très insuffisant. Actuellement les élèves peuvent bénéficier de 8 séances gratuites. Les familles cessent le suivi après les 8 séances, faute de moyens. SUD éducation revendique la gratuité des séances chez le·la psychologue pour les élèves qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement.
Pour lutter contre le cyberharcèlement, il faut former les élèves, les parents et les personnels à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. Il est inutile d’ajouter des sanctions supplémentaires du type confiscation du téléphone dans la mesure où l’élève aura toujours accès à un autre téléphone. Pour les réseaux sociaux, tant que les règles ne seront pas claires et les mêmes pour les adultes et les enfants, il sera bien inutile de prendre des mesures sur l’accès aux réseaux sociaux par les élèves qui trouveront toujours des moyens pour contourner les interdictions. Il faut donner accès sur la prévention, l’éducation de tous et toutes.
SUD éducation revendique :
la création de postes dans la médecine scolaire et l’assistance sociale :
- 1 infirmerie ouverte sur tout le temps scolaire dans chaque établissement ;
- 1 assistant·e de service social à temps plein dans chaque établissement et leur déploiement dans le premier degré ;
- le renforcement de la médecine scolaire avec des visites obligatoires pour tous·tes les élèves.
des créations de postes pour réduire les effectifs par classe et renforcer les vies scolaires :
- limiter les effectifs par classe avec au collège : 20 élèves maximum en collège ordinaire, 16 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA ;
- des dédoublements nationaux sur la moitié des horaires d’enseignement dans toutes les matières ;
- au moins 1 CPE dans tous les collèges quel que soit le nombre d’élèves ;
- 1 CPE pour 120 élèves dans les collèges ordinaires et 1 pour 100 en éducation prioritaire ;
- en plus du ou de la CPE, 1 personnel de vie scolaire pour 50 élèves en collège ordinaire et 2 pour 50 en éducation prioritaire.
la formation initiale et continue sur le harcèlement scolaire :
- des vraies formations à l’identification et la prise en charge des situations de harcèlement dans les écoles et les établissements scolaires avec des intervenant·es extérieur·es et non pas du saupoudrage avec des kits ou des formations à distance ;
- les formations qui doivent prendre en compte de manière spécifique les oppressions sexistes, racistes, LGBTIphobes, validistes.
Pour lutter contre le harcèlement scolaire, il faut des moyens humains et matériels . SUD éducation porte des propositions pour transformer en profondeur le service public d’éducation. Le harcèlement scolaire tue. La violence n’a sa place dans aucune école et aucun établissement scolaire
4 - Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
Fiche basée sur une pratique en cours de français dans le secondaire, adaptable à toutes les disciplines et tous les niveaux.
Le conseil de coop : qu’est-ce que c’est, d’où ça vient ?
Le conseil de coopération est un dispositif pédagogique qui s’inspire de la pédagogie Freinet et de la pédagogie institutionnelle. C’est une institution autogérée par les élèves : à la fois un lieu de parole, un lieu de réflexion et d’analyse mais aussi un lieu de prises de décisions, il vise à organiser à la fois le travail et la vie de la classe, comme celle de l’établissement.
« Le conseil de coopération : lieu d’apprentissage de la démocratie. C’est sans conteste l’institution de base de la classe, le lieu où les enfants établissent leurs lois, règlent leurs conflits, examinent les propositions concernant les activités et les relations au sein du groupe, mettent au point leur plan de travail, discutent de leurs réalisations. C’est un lieu d’échange, un lieu de parole où se trouvent confrontées paroles du groupe et parole de l’individu. C’est un lieu de conflits où s’expriment la lutte entre les dominant·es, les conflits dominant·e·s/dominé·e·s et les conflits entre groupe et individu. » (La pédagogie Freinet au collège et au lycée, publication de l’Icem secteur 2nd degré, 1997)
« Le conseil est une institution centrale de la classe de pédagogie institutionnelle. C’est un moment structuré et solennel où le groupe est confronté à son quotidien et à ses aspirations. Nous réglons des conflits et félicitons des camarades, […] nous votons des projets qui engageront toute la classe dans des apprentissages et de nouvelles organisations du groupe. Tous ces débats et décisions potentielles créent une énorme attente, réamorçant du désir, car il y a là des enjeux importants pour chacun·e. » (Andrès Monteret, Les chemins du collectif, Libertalia 2020).
Comment mettre en place un conseil de coopération ?
À chacun·e de s’approprier cette pratique selon les élèves, les classes, les besoins et visées
Comment préparer le premier conseil de coopération ?
- présenter en quelques mots le conseil de coopération et annoncer aux élèves la date du premier conseil ;
- préparer un questionnaire à faire remplir en amont avec des questions qui font un bilan du travail et de l’atmosphère en classe (voire dans l’établissement), tout en ouvrant vers la possibilité, pour les élèves, de s’emparer des espaces, des programmes, des modalités de travail… et d’en proposer d’autres.
Quelques exemples : que penses-tu du travail en classe ? Ce qui te satisfait le plus ? Ce qui te pose problème ? Les changements que tu souhaiterais ? Qu’est-ce qu’il faudrait ajouter dans la salle, ou retirer ? Sur quoi tu as besoin d’être aidé·e ? Sur quoi tu aimerais travailler ? De quelles manières tu aimes travailler ?
- à partir de ce questionnaire, la/le prof prépare l’ordre du jour du premier conseil, en rassemblant par thématiques, par exemple. On peut choisir de le détailler ou non. L’ordre du jour des conseils suivants, dans l’idéal, sera préparé par les élèves.
Ce questionnaire et ce “bilan-ordre du jour” peuvent précéder chaque conseil de coopération. Il existe des pratiques où les bilans sont faits au moyen de boîtes recueillant les idées des élèves, de tableaux où les élèves notent leurs propositions…
D’autres pratiques vont plus loin dans l’autogestion par les élèves en mettant en place des équipes tournantes pour gérer la constitution de l’ordre du jour. - préparer une présentation sommaire des rôles dans le conseil : présidence, secrétariat, gestion du temps, gestion de la parole, ainsi que les règles et le déroulement type du conseil.
Les rôles
Pour chaque conseil, les rôles sont distribués.
Président·e : l’élève ouvre et ferme le conseil et fait respecter l’ordre du jour et les règles du conseil. La ou le président·e doit rester neutre, veiller à ce qu’il n’y ait pas de hors-sujet.
Secrétaire : l’élève prend des notes sur les débats et, surtout, consigne les décisions prises.
Maître·sse de la parole : l’élève distribue la parole. Pour cela, elle ou il note le prénom des élèves qui souhaitent prendre la parole (et qui lèvent la main pour être noté·es) et distribue la parole dans l’ordre des inscrit·es. Mais si un·e élève n’a jamais parlé encore, il est possible de la ou le faire passer en priorité.
Maître·sse du temps : l’élève veille à ce que le temps accordé à chaque point soit respecté. Elle ou il peut rappeler le temps restant lorsque cela lui semble nécessaire.
Les règles
L’ensemble du groupe doit écouter et respecter la parole de la personne qui s’exprime, élève ou adulte. Chacun·e attend son tour pour pouvoir s’exprimer. Un·e élève est chargé de la distribution de la parole pour cela. Les problèmes à gérer doivent être clairement expliqués par les personnes qui en ont fait part. Une discussion a lieu ensuite pour trouver des solutions et faire des propositions concrètes. S’il n’y a pas de consensus sur une proposition, celle-ci est soumise au vote. À partir du moment où une décision est votée, tout le monde s’engage à la respecter.
Pendant le conseil
On peut imaginer plusieurs dispositions dans la salle pour favoriser la participation :
- une grand rectangle avec les tables
- un grand U
- pas de table, mais des chaises en cercle
L’essentiel est que tou·tes les élèves se voient et que personne ne soit exclue.
Le déroulement s’appuie sur le bilan préparé en amont. On peut ajouter à ce déroulé un temps dédié à chaque point :
- Ouverture par la ou le président·e : « je déclare le conseil ouvert » ;
- Présentation des élèves qui assument les différents rôles du conseil ;
- Rappel des règles de fonctionnement du conseil : « on ne se moque pas, on est bienveillant et en confiance, on écoute la personne qui parle, on demande la parole ; on ne discute pas en aparté ; les élèves qui gênent trois fois ne pourront plus participer » ;
- Lecture des décisions du conseil précédent ;
- Lecture de l’ordre du jour à l’issue de laquelle on demande s’il y a un point à ajouter ;
- Lecture des points positifs, appréciés dans la période écoulée ;
- Déroulement des points à discuter et à régler si possible ;
- Les projets en cours ;
- Les propositions ;
- Les responsables et la date du conseil suivant ;
- Relecture des décisions prises ;
- Remarques sur l’animation du conseil ;
- Fermeture du conseil : « je déclare le conseil fermé ».
L’adulte participe au conseil au même titre que les élèves et vote mais sa voix ne compte pas davantage et n’oriente pas le vote. L’adulte conserve un droit de veto si les propositions ne respectent pas les règles de la classe.
Après le conseil
Les décisions sont conservées dans le cahier des élèves et dans le cahier de la classe, s’il en existe un. Chacun·e veille au respect des décisions car elles servent de points de repère pour la vie de la classe et les questions qui se posent. Au fil des conseils, la mémoire de la classe se construit ainsi : les décisions sont reprises, remises en question ou complétées. Les projets s’affinent, s’ajoutent les uns aux autres.
Quelle puissance pédagogique et émancipatrice dans le conseil de coopération ?
Comme pour toutes les pratiques pédagogiques, le risque est de ne faire du conseil de coopération qu’un outil d’organisation technique du temps et du travail, de réduire le conseil à un lieu de planification des éléments proposés par l’enseignant·e seul·e, en oubliant le potentiel de transformation de la classe et de l’école par les élèves, sans en faire un levier d’analyse critique et d’émancipation pour les jeunes.
La puissance pédagogique du conseil de coopération réside dans le fait que les élèves s’emparent de l’espace, des savoirs, du travail, y injectent les notions qui les intéressent, les questionnements (sur l’école, sur le monde) qui les préoccupent, les réalités qui les laissent perplexes ou qui les révoltent. Par cette prise de pouvoir sur ce qu’elles et ils font en classe, leur engagement dans le travail prend du sens et devient authentique. Par le conseil de coopération, les jeunes font l’apprentissage du débat et de l’analyse, réfléchissent aux situations problématiques de la classe et de l’établissement, qu’elles soient interpersonnelles ou organisationnelles, et y construisent des réponses ; elles et ils y apprennent la démocratie et l’autogestion et prennent confiance en leur pouvoir d’agir. L’émancipation ici, se traduit par l’exercice d’un esprit critique face au fonctionnement traditionnel de la classe et de l’école, et par une dynamique de transformation de ce fonctionnement.
Pour les personnels qui impulsent le conseil, cela demande un changement de posture pas toujours facile : ne plus être la personne qui domine, qui décide seul·e du déroulement des cours, des points à aborder, des modalités de travail ; mais également accepter la parole critique des élèves et s’ouvrir à leurs propositions. Cette pratique permet aussi aux personnels de s’émanciper des postures héritées de leurs propres études, descendantes et dominatrices.
Quelques ressources pour aller plus loin
- https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-conseil-cle-de-voute-de-l-organisation-cooperative
- https://www.icem-pedagogie-freinet.org/pratiques-et-recherches-56-le-conseil-dans-la-classe
- Andrès Monteret, Les chemins du collectif, Libertalia 2020
- La pédagogie institutionnelle au fil des jours, Cgé, Couleur livres, 2017.
- Cornet Jacques, de Smet Noëlle, Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre : une autre conception du groupe classe, ESF, 2013.
Pourquoi s’auto-organiser au lycée ?
Pourquoi les lycéen·nes ont besoin d’organisation syndicale spécifique où iels décident pour elleux de leurs propres revendications et de leurs modalités d’action ?
C’est en 1987 qu’est créé le premier syndicat lycéen suite à la victoire face au projet de loi Devaquet. Ce projet de loi visait à réformer les universités et notamment le passage du lycée à l’université en créant de la concurrence entre les élèves, ce qui nous rappelle Parcoursup aujourd’hui. Contre cette loi, la mobilisation lycéenne est extrêmement forte, ce qui conduit à l’abandon du projet de loi. Ce premier syndicat est créé par des cadres du PS et de SOS Racisme, et sera le seul pendant très longtemps. En 1993 est fondée l’Union Nationale Lycéenne, lui aussi à la suite d’une forte mobilisation lycéenne, et lui aussi très proche du PS à ses débuts. A l’origine, les syndicats lycéens n’étaient donc pas totalement autonomes et indépendants. Ils étaient même gangrenés par le carriérisme et étaient un moyen pour les partis de former leurs successeurs politiques. C’est ainsi que nombre de syndicalistes lycéen·nes ont par la suite continué leur carrière dans le syndicalisme étudiant puis dans les assemblées, les mairies, les ministères…
Pour comprendre d’où vient ce manque d’autonomie il est nécessaire de rappeler que pour se financer, les organisations lycéennes n’ont pas beaucoup de choix. Les cotisations venant de lycéen·nes ne suffisent pas à faire fonctionner une organisation entière. Autre possibilité, les subventions publiques, très variables d’une année à l’autre en fonction de l’évolution du syndicat et de la politique du ministère de l’Éducation nationale. Il reste donc les dons faits par d’autres organisations, ce qui pousse les syndicats à se rapprocher de partis politiques, qui voient d’un bon œil de se mettre les lycéen·nes dans la poche.
Pourtant, il est indispensable de s’auto-organiser et de faire naître les initiatives et les propositions directement des lycées et ne pas être orienté par un organe extérieur. Nous faisons les frais d’un système scolaire oppressif qui voudrait nous formater et nous mettre au pas. En tant que lycéen·nes, nous avons les clés pour le comprendre de l’intérieur et lutter contre. Certaines problématiques lycéennes sont les mêmes depuis toujours, comme la revendication d’une gratuité totale de l’éducation par exemple. Les lycéen·nes ne peuvent pas se permettre de passer une année en écartant une ou des revendications à cause de l’omniprésence d’une autre cause choisie par une organisation extérieure (l’année dernière pendant les mouvements contre la réforme des retraites, le micro était tendu au lycéen·nes seulement pour parler de la réforme des retraites). Parmi les organisations lycéennes gérées et contrôlées en partie par des associations non lycéennes nous avons vu des représentant·es départementaux être obligé·es d’assister aux formations de cette association non lycéenne, leur prenant du temps sur un événement national, les obligeant à abandonner des discussions à propos de revendications lycéennes.
Dans les instances, dans la vie et même dans la rue où nous devrions être écouté·es, notre parole de lycéen·nes est en permanence discréditée. Parfois par des propos paternalistes, souvent à coup de matraques. Les sphères considérées comme représentant l’engagement lycéen ne sont que des fausses instances où rien ne se décide, en tous cas nous ne sommes jamais écouté·es. Les programmes censés développer notre esprit critique sont pensés pour nous formater. A l’intérieur des instances lycéennes, nous ne sommes pas écouté·es et à l’extérieur nous sommes matraqué·es. Nous sommes vu·es comme des flemmard·es sans revendication dont le seul but est de ne pas travailler en séchant les cours. En tant que mineur·es, il leur est facile de balayer d’un revers de main toutes nos revendications. Notre jeunesse nous rend aveugles diront-ils, nous n’y comprenons rien… Nous, lycéen·nes, savons à quel point ces revendications sont primordiales. Comment ne pas avoir la flemme justement ? Comment avoir hâte de travailler, quand nous nous rendons compte que le système scolaire reproduit les structures oppressives de la société ? Qu’il nous divise en nous mettant en compétition, nous formate tout en voulant justifier les inégalités futures auxquelles nous serons confronté·es sur le marché du travail ?
Les parents d’élèves ainsi que les profs se rendent en partie compte de ces problèmes spécifiques, mais se rendent mieux compte des leurs car iels les vivent. Leur capacité d’initiative en matière de luttes lycéennes est donc limitée. De même que nous ne pourrions pas mener à leur place les luttes contre les problèmes que les profs rencontrent ( manque de postes, de moyens, surcharge de travail.. ) car nous ne les vivons pas, des adultes non-lycén·nes ne peuvent pas comprendre comme nous notre position de lycéen·ne… Le rôle qui nous incombe est d’être là pour soutenir et construire des ponts entre nos luttes lorsque celles-ci sont proches. Il nous faudra néanmoins mener notre lutte par nous-même loin de l’entrisme ou du carriérisme qui ne ferait que nous discréditer.
Au-delà des revendications, les modalités d’action dans les lycées sont spécifiques car nos droits et conditions d’études sont spécifiques : nous n’avons pas de droit de grève, les syndicats lycéens ne sont pas reconnus, nos absences sont un motif de pression, la plupart d’entre nous vit encore chez ses parents… Un nombre important de particularités à prendre en compte si l’on veut comprendre nos capacités et modes d’actions. Il nous faut donc redéfinir notre grève lycéenne, la combiner à des blocus pour nous permettre de ne pas se présenter en cours sans forcément être considéré·es comme absent·es et développer une solidarité nécessaire dans nos lieux d’étude. La répression administrative ne saurait être minimisée et est un facteur important de la peur ressentie par les lycéen·nes qui s’engagent ( fichage pendant les blocus, conseils de discipline, intimidations…).
Un des grands moteurs d’une mobilisation lycéenne, c’est l’image qu’elle renvoie.
Seul un mouvement initié par des lycéen·nes, dans les lycées, avec des méthodes lycéen·nes peuvent espérer faire sortir de leur classe des non-militant·es et les faire manifester, ou bloquer leur lycée. Plus dynamique, les lycéen·nes ne se mobilisent pas selon les méthodes militantes classiques la plupart du temps, car les enjeux de leurs luttes sont souvent perçus différemment et abordés différemment. Personne ne peut dire aux jeunes comment iels doivent se mobiliser. Qui aurait pu prévoir que le plus gros mouvement lycéen de ces trois dernières années soit contre la réforme des lycées professionnels ? Initié par le MNL, ce mouvement a pris une ampleur inattendue, avec des centaines de lycées bloqués le premier jour, mais aussi le suivant, et on a observé des lycées généraux bloqués pendant une semaine entière. S » il a pris de l’ampleur, c’est par le travail de motivation réalisé sur les réseaux sociaux par des lycéen·nes autonomes.
Pour conclure, il est impératif que les lycéen·nes s’auto-organisent au sein des lycées, mais aussi au sein de leurs organisations, et dans la planification de leurs actions. Il en va de la massification des mouvements lycéens.
Présentation du MNL
Le MNL est un syndicat lycéen autogestionnaire, donc par et pour les lycéen·nes, démocratique, syndical, indépendant et combatif. Le MNL se pose en alternative aux politiques éducationnelles destructrices, aux coupes budgétaires incessantes et à la précarité grandissante. Le MNL est un syndicat antifasciste, écologiste, féministe et anticapitaliste qui se bat pour une école plus juste, solidaire et inclusive, émancipatrice pour toutes et tous.
Nous faisons vivre toutes ces valeurs et tous ces combats au sein d’une organisation lycéenne grâce au fait que ce soit un syndicat autogestionnaire, qui permet aux lycéen·nes de s’engager comme iels le veulent et quand iels le veulent ce qui est primordiale pour les lycéen·nes. Nous voyons le syndicat comme un outil au service des luttes lycéen·nes qui doit donner à tous.tes les armes pour se mobiliser.
5 - Le droit d’être protégé·e contre toutes les formes de discrimination
Face à l’offensive réactionnaire et au comportement rétrograde de l’institution scolaire, il nous faut réaffirmer nos revendications : une école qui garantisse l’épanouissement des élèves, qui leur permette de se construire en dehors des stéréotypes et des hiérarchisations aliénantes, qui promeuve l’égalité entre tou·tes, filles, garçons, qu’elles ou ils soient hétéros, lesbiennes, gays, bi·e·s, trans, cis, intersexué·es, qui permette à tout·e élève de penser sa vie comme un possible et son identité comme son bien propre.
Pour cela, SUD éducation revendique :
- la ré-intégration du concept de genre dans les textes officiels et sa prise en compte dans des programmes élaborés par la communauté éducative ;
- la prise en compte de ces questions dans les enseignements ;
- la production de manuels qui fassent sa place entière à l’histoire des femmes, non pas sur un strapontin dans des dossiers documentaires annexes, mais dans le corps du texte et le fil de l’histoire (documents-sources d’auteures, féminisation des textes, évocation systématique de la place des femmes, vision genrée des événements et des concepts) ;
- la mise en œuvre de pratiques de classe favorisant la circulation égalitaire de la parole, les pratiques collaboratives, l’apprentissage de toutes les disciplines pour toutes et tous dans une école polytechnique ;
- l’effectivité des séances d’éducation à la sexualité prévues dans les textes officiels et la prise en compte dans ces séances d’une perspective non hétérocentrée, qui mette sur un pied d’égalité toutes les orientations sexuelles et toutes les identités de genre ;
- la mise en place de dispositifs dédiés (comme l’étaient les ABCD de l’égalité) permettant aux élèves de réfléchir spécifiquement aux discriminations et stéréotypes de genre, et de les déconstruire ;
- la promotion de projets par exemple via les CESC (Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté), et d’interventions d’associations ou organisations laïques (Planning Familial, SOS Homophobie par exemple) pour compléter les actions et pratiques pédagogiques mises en œuvre dans les établissements.
Attaque contre l’éducation affective et sexuelle : beaucoup de bruit pour presque rien !
Ces derniers mois, les attaques contre les projets d’éducation à la vie affective et sexuelle mis en place dans les établissements scolaires se sont multipliées. Cette campagne est nourrie par des mensonges et la diffusion de fake news qui déforment complètement la réalité du terrain des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle mises en place dans les écoles, collèges et lycées, quand elle est mise en place !
En Belgique, la mobilisation des intégristes religieux et de l’extrême droite contre un projet de décret relatif à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (« Evras ») a conduit à l’incendie de plusieurs écoles.
En France, sous l’impulsion des groupes de « Parents vigilants », portés par les partisan·es d’Eric Zemmour ou les “mamans louves”, c’est une véritable campagne de désinformation à destination de l’opinion publique, et de pression sur la communauté éducative qui s’intensifie depuis la rentrée, avec en ligne de mire les élections des représentant·es de parents d’élèves du mois d’octobre.
Pourtant, institutions et organisations cèdent à ces sirènes réactionnaires :
- en ne soutenant pas systématiquement les équipes éducatives voire en entravant leur travail, comme cela a été par exemple le cas en Ariège où le DASEN a interdit l’intervention du Planning familial dans les écoles, malgré son agrément par le Ministère et son expertise reconnue pour produire des contenus adaptés à chaque public ;
- en relayant cette campagne nauséabonde sur nos boîtes professionnelles comme l’a fait Action & Démocratie ;
- en mettant en doute la pertinence d’une éducation à la vie affective et sexuelle abordant toutes les orientations sexuelles et identités de genre, comme l’a fait le Président Macron lors d’une interview s’agissant des écoles et du collège.
C’est pourtant bien en abordant dès le plus jeune âge la question du consentement, du respect de l’intégrité physique, de la diversité des orientations amoureuses et des identités de genre que l’on œuvre à un véritable épanouissement personnel, débarrassé de rapports oppressifs et de normes étouffantes. C’est aussi pendant les séances d’éducation à la vie affective et sexuelle que l’école peut identifier et prévenir les violences sexistes et sexuelles qui menacent les élèves, notamment l’inceste.
Derrière ces attaques en règle contre l’éducation à la vie affective et sexuelle, sous couvert d’intérêt de l’enfant, il y a le refus de lutter contre les stéréotypes sexistes et les oppressions qu’ils produisent, la volonté d’imposer la norme hétérosexuelle et cisgenre comme seul horizon « naturel ».
Derrière la mise en cause de sites dédiés comme « onsexprime » de Santé publique France, il y a le déni de la nécessité d’une politique d’information et de prévention sur les questions de sexualité, alors même qu’à l’âge de 12 ans, selon un récent rapport de l’ARCOM, plus de la moitié des garçons consulte régulièrement des sites pornographiques.
Assurer une éducation à la sexualité est une des missions de l’école, inscrites dans le Code de l’Éducation (articles L 121 – 1 et L 312 – 16) et au lieu de céder à des « paniques morales » infondées et réactionnaires, notre institution et toute la communauté éducative doit plutôt se préoccuper de l’effectivité de ces séances, qui ne sont le plus souvent pas mises en place faute de moyens et de politique volontariste.
À ces attaques contre l’éducation à la vie affective et sexuelle, s’est également ajouté en cette rentrée un appel du collectif « Parents vigilants » à intégrer les listes de parents élu·es. Les militant·es d’extrême droite sont encouragé·es par ce collectif à intervenir en conseil d’école ou en conseil d’administration des établissements scolaires et auprès des autres parents d’élèves.
SUD éducation dénonce cette intrusion réactionnaire au sein de l’école, apporte son soutien aux équipes éducatives qui mettent en place ces séances avec le souci de les adapter au mieux à chaque public, et défend avec force la nécessité d’une éducation à la vie affective et sexuelle de l’école à l’université. SUD éducation dénonce également l’entrisme de l’extrême droite au sein des instances scolaires.
SUD éducation a interpellé le Ministre de l’Éducation nationale afin qu’il se tienne aux côtés des personnels contre cette offensive réactionnaire.
SUD éducation revendique :
- l’effectivité des séances d’éducation à la sexualité prévues dans les textes officiels et la prise en compte dans ces séances d’une perspective non hétérocentrée et cisgenre, qui mette sur un pied d’égalité toutes les orientations sexuelles et toutes les identités de genre ;
- la réintégration du concept de genre dans les textes officiels et sa prise en compte dans des programmes élaborés par la communauté éducative ;
- la mise en place de dispositifs permettant aux élèves de réfléchir aux discriminations et de déconstruire les stéréotypes.
Le ministère de l’Éducation nationale a publié le 29 septembre 2021 une circulaire “pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire”. Ce texte s’inscrit dans le “Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020 – 2023” et fait suite au suicide d’une élève trans à Lille en décembre 2020 qui mettait au jour le manque d’accompagnement et de soutien par l’institution scolaire des jeunes trans. Pour SUD éducation, ce texte est un appui pour réclamer dans les départements des campagnes de prévention, néanmoins ces objectifs ne pourront être atteints sans moyens humains et financiers. Par ailleurs, SUD éducation regrette que le ministère ne fasse pas du choix et du bien-être des élèves l’élément central de sa politique : en effet le changement de prénom est toujours conditionné à l’accord des parents.
Un rappel salutaire du cadre législatif
La circulaire du ministère rappelle que la transidentité n’est ni un trouble psychiatrique, ni une pathologie. Alors que, dans les établissements scolaires, les élèves trans subissent trop souvent des discriminations et un harcèlement inacceptables, il est nécessaire de rappeler le droit au respect des éléments comme l’identité de genre qui constituent la vie privée des individus (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les actes et les discriminations transphobes sont sanctionnés par le code pénal. De même, le changement d’état civil, indépendamment de toute transition physique ou de démarche médicale, est un droit acquis pour les personnes trans.
Cette circulaire permet de rendre visible les élèves trans et de réaffirmer leurs droits dans le cadre scolaire.
Un manque de moyens qui met en danger la mise en œuvre de la circulaire
Le manque de personnels médico-sociaux ne permet pas de mener les actions de protection nécessaires lorsque les élèves trans sont victimes de violence dans le cadre scolaire ou familial. Pourtant, les élèves trans subissent davantage ces violences que les autres enfants et adolescent·es. Il y a urgence à accompagner les familles pour permettre aux jeunes de vivre leur transition ou leur questionnement quant à leur genre dans un cadre bienveillant et serein. La préconisation de transmettre une information préoccupante n’est pas suffisante puisque les délais de traitement par la Crip (la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes) sont très longs en raison d’un manque de moyens criants. Il faut accompagner les familles afin de prévenir les situations de violence.
La politique de prévention portée par la circulaire repose sur des dispositifs qui existent déjà et dont l’efficacité reste limitée. La lutte contre les discriminations transphobes ne peut se borner au PAF (Plan Académique de Formation) car seuls les personnels intéressés par ces questions s’y inscrivent. De même, la formation à l’accompagnement des élèves transgenres ne doit pas être en concurrence avec d’autres formations pédagogiques dans le contexte d’un droit à la formation fortement restreint. La formation doit se déployer pour tous les personnels dans les établissements scolaires avec la participation des associations qui défendent les droits des personnes LGBTI+.
De plus, les actions de prévention reposent dans les académies sur des personnes chargées de mission, référent·es pour l’éducation à la sexualité, les équipes référentes harcèlement. Ces missions sont aujourd’hui prises en charge par des personnels qui ne sont pas forcément formés et dont la charge de travail ne permet pas de remplir ces missions.
Prénom et expression de genre : les élèves doivent décider !
La circulaire rappelle l’importance d’accompagner les élèves dans leur questionnement ou dans leur transition afin de garantir leur bien-être et leur sécurité dans le cadre scolaire. Pourtant en subordonnant le changement de prénom à l’accord de la famille de l’élève, le texte ministériel donne le dernier mot à la famille lorsque celui-ci est en désaccord avec le choix de l’élève. L’ école doit être un espace sécurisant pour les élèves, et les protéger des pressions familiales de tous ordres. Cette disposition doit être modifiée.
Au contraire, pour SUD éducation, il faut placer le bien-être de l’élève au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi l’école doit accompagner les familles dans l’acceptation de la démarche de leurs enfants. Il n’est pas acceptable que l’école cautionne la négation par certaines familles du droit des jeunes trans à choisir leur prénom et à exprimer librement leur genre.
SUD éducation revendique une politique ambitieuse de prévention et d’accompagnement des jeunes trans ou en questionnement quant à leur genre et leur orientation sexuelle, appuyée par la mise à disposition de véritables moyens et par l’ouverture de postes spécifiques de référent⋅es.
SUD éducation revendique le respect par les personnels du prénom choisi par les jeunes trans dans le cadre scolaire.
Régulièrement, dans beaucoup de collèges et lycées de France, de nombreuses élèves reçoivent des avertissements ou se voient refuser l’accès de leur établissement parce que leur tenue est jugée « provocante » ou « indécente ». Les coupables : jupes courtes, shorts, hauts qui laissent apparaître les épaules ou le nombril, soutiens-gorge qui dépassent, absence de soutien-gorge… Même lorsque les températures sont très élevées, on demande à ces jeunes filles de mettre un gilet ou un pantalon. Les garçons subissent beaucoup moins d’injonctions quant à leur tenue et ne sont pas accusés d’y mettre une intention sexuelle.
L’argument principal qui justifie ces injonctions est malheureusement connu : ces tenues, dit-on, « exciteraient les garçons » et « les empêcheraient de se concentrer en classe » – sous-entendant que la « concentration » des garçons prime sur l’accès aux cours des filles. Illustration parfaite d’une culture du viol qui considère que ce sont aux femmes et aux jeunes filles de faire attention à leur manière de s’habiller, qui prétend que les garçons et les hommes ne seraient pas capables de se contenir à la vue d’une épaule, d’un sein, d’une cuisse. Faut-il le rappeler ? Une agression sexuelle ou un viol n’a qu’un seul responsable : l’agresseur.
D’autres diront qu’il s’agit simplement d’avoir une tenue « correcte », « normale » ou « républicaine » dans les mots de Blanquer. Mais en quoi une jupe courte ne serait ni « correcte », ni « normale » ou « républicaine » ? La notion de décence est le règne de la subjectivité et du moralisme.
Ne nous méprenons pas, quelle que soit l’argumentation proposée, l’enjeu est toujours le même : contrôler l’habillement des jeunes filles, considérer qu’il n’est pas acceptable que leur corps soit visible, alors même que ce sont elles qui le choisissent. Ces commentaires dévoilent, par ailleurs, le système de double contrainte auquel sont soumis les femmes et jeunes filles : trop court, c’est intolérable ; trop long, c’est intolérable aussi. En France, des policiers peuvent à la fois demander à une femme, seins nus sur la plage, de remettre son haut de maillot de bain et à une autre qui porte un voile sur la plage de l’enlever. Une femme doit montrer son corps, mais pas trop. Il n’y a aucune façon de gagner : être une jeune fille ou une femme, c’est se voir sans cesse scrutée, jugée, être sommée de trouver le juste milieu. Une société qui n’a de cesse de contrôler la manière dont s’habillent les femmes est une société profondément sexiste et patriarcale. Cette société discrimine particulièrement les jeunes femmes trans, mais aussi toute personne non-binaire, agenre ou ayant une expression de genre fluide.
En tant que personnels de l’éducation, notre rôle est de former la jeunesse pour l’avènement d’une société respectueuse des libertés de chacun·e. Ce sont les garçons qu’il faut éduquer, en leur disant qu’aucune tenue vestimentaire n’est jamais une invitation à quoi que ce soit, (ni à commenter, ni à toucher), et qu’il leur faudra bien apprendre à se concentrer en classe quelques soient les circonstances.
• Nous soutenons les jeunes collégien·ne·s et lycéen·ne·s dans leur combat pour le droit de s’habiller comme ils et elles l’entendent, et contre les remarques sexistes des adultes.
• Nous condamnons toutes les démarches qui visent à interdire l’accès à l’établissement scolaire à des élèves sous prétexte d’une tenue inadaptée.
• Nous condamnons les règlements intérieurs qui se transforment en police vestimentaire et restreignent de manière injustifiable la liberté des élèves et exigeons la réécriture de ces derniers.
• Nous revendiquons une réelle éducation pour tou·te·s les élèves sur les questions de sexisme, de genre et de consentement.
Alors que le nouveau ministre de l’Éducation nationale a fait du bien-être des élèves à l’école un objectif prioritaire, l’une de ses premières notes de service pointe directement du doigt les élèves musulman·es ou supposé·es musulman·es et proscrit les « tenues de type abaya ou qamis », considérant que ces vêtements « manifeste[nt] ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse ».
Ces tenues n’étant nullement définies, c’est l’arbitraire qui va prévaloir et, tandis que ce sont les chef·fes d’établissement qui statueront pour savoir si telle ou telle robe longue doit ou non être considérée comme une abaya, ce sont bien les AED qui seront en première ligne pour mener cette tâche impossible.
On imagine déjà les situations ubuesques que cette note de service va générer et les humiliations islamophobes et sexistes quotidiennes qu’elle va permettre de cautionner. Une nouvelle fois, ce sont les élèves musulman·es ou supposé·es musulman·es qui vont en faire les frais et, en premier lieu, les jeunes filles musulmanes ou supposées musulmanes qui auront à se justifier des vêtements qu’elles portent, tandis que leurs camarades ne seront jamais questionnées à ce sujet.
Faire du port d’un certain type de vêtement une marque de prosélytisme est un dangereux dévoiement de la laïcité et SUD éducation dénonce cette note de service qui stigmatise une partie de la population en raison de sa confession réelle ou supposée.
Dès la naissance, les enfants sont assigné·es à un genre, féminin ou masculin, au regard des attributs de leur corps biologique. Les études de genre ont pourtant bien montré la nécessité de dissocier sexe d’une part, et genre d’autre part (c’est-à-dire la construction sociale des identités). De fait, la question des identités trans met en lumière les problèmes que pose l’assignation de genre. Les personnes trans sont obligé·e·s de se battre quotidiennement pour faire valoir leur identité face aux discriminations et violences transphobes systémiques.
Ils et elles subissent des injonctions contradictoires quant à leur apparence physique. L’injonction au « passing » (c’est-à-dire répondre aux normes de genre correspondant à son identité) s’abat de façon contradictoire sur les personnes trans : à la fois on les accuse d’être fausses si elles ne s’y conforment pas, et, dans le même temps, on les accuse de reproduire et de véhiculer des stéréotypes lorsqu’elles le font. Souvent, elles ont également à subir des questions intrusives sur leur corps (à savoir s’ils et elles sont opéré·es, s’ils et elles suivent un traitement hormonal) qui violent leur intimité.
L’autodétermination, le respect des parcours de chacun·e et des prénoms et pronoms d’usage doivent s’imposer dans l’ensemble de la société à commencer par l’école (changements de prénom sur les listes d’appel, sur le carnet de correspondance, sur l’ENT, etc.)
Selon la définition de l’Onu, les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels (génitaux, gonadiques ou chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins.
C’est d’abord avec l’accord des parents – parfois extorqué sous la pression par les médecins – parfois à leur demande, que les enfants et adolescent·es intersexes sont le plus souvent mutilé·es, opéré·es et soumis·es à des « traitements » hormonaux lourds. Les opérations et mutilations ne sont pas une intervention ponctuelle, à la naissance, comme on le croit souvent. Elles sont répétées, multipliées, durant toute l’enfance et l’adolescence – certains enfants sont opérés plusieurs dizaines de fois. Les opérations comme les traitements hormonaux peuvent également générer d’autres problèmes de santé. Outre ces mutilations, les personnes intersexes ont à subir stigmatisation et violences, en particulier à l’adolescence : les adolescent·es sont, en effet, obsédé·es – et socialement encouragé·es à l’être – par la transformation de leur corps et sa conformité aux normes de genre dominantes. Des personnes assignées filles qui n’ont pas de seins, pas leurs règles, une pilosité importante, ou des personnes assignées garçons qui ne développent pas de pilosité, dont le sexe ne correspond pas aux critères de masculinité… seront harcelées par les autres élèves, soucieux·ses de conformité aux normes de la féminité ou de la masculinité hégémoniques et voulant se démarquer de ces « déviant·es ».
• Les mutilations, stérilisations, traitements hormonaux non consentis sur des personnes intersexes, quel que soit leur âge, doivent cesser.
• Le droit à l’autodétermination des personnes intersexes doit être reconnu : respect du prénom et des pronoms d’usage des élèves dans l’Éducation nationale, possibilité de changement d’état civil libre et gratuit par simple déclaration devant un officier d’état civil en mairie, sans intervention des pouvoirs médicaux et judiciaires.
• La formation des personnels éducatifs sur les questions intersexes doit être effective.
• Une prise en compte, non pathologisante, des variations intersexes dans les supports pédagogiques doit prévaloir.
En 2019, le terme grossophobie entre dans le dictionnaire : « attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids ». Cette entrée est une première victoire symbolique pour les personnes et collectifs qui se mobilisent pour faire entendre la réalité des discriminations systémiques que subissent les personnes grosses ou perçues comme telles. La stigmatisation, les discriminations et le dénigrement que subissent ces personnes sont étroitement liées aux injonctions normatives sur les corps, qui pèsent avec d’autant plus de force sur les femmes. Aujourd’hui, dans les représentations (publicité, médias, films) et l’opinion commune, la minceur, voire la maigreur, est valorisée. Tout signe de surpoids fait l’objet d’une forte culpabilisation et s’accompagne de stéréotypes : paresse, manque de volonté, négligence, stigmate social.
Cette dynamique de culpabilisation est marquée par l’amalgame entre surpoids et obésité et par l’argument des enjeux de santé. Pour les associations concernées, il s’agit, d’une part, de « décorréler le surpoids de l’obésité » (compte-rendu des États généraux de la lutte contre la grossophobie, janvier 2017) ; et, d’autre part, dans les politiques de santé publique, de prendre en compte non seulement la santé physique, mais aussi psychique des personnes concernées.
La difficulté à assumer socialement un corps gros ou perçu comme tel se répercute dans de nombreux champs de la vie quotidienne :
discrimination à l’emploi
une enquête menée par le Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale du Travail en 2016 sur les discriminations à l’embauche liées au physique souligne « l’ampleur de la contrainte sociale qui pèse sur l’apparence des femmes est l’impact du surpoids dans les discriminations liées à l’apparence physique. En effet, le surpoids n’a pas d’effet spécifique chez les hommes, alors que les femmes en surpoids rapportent 4 fois plus souvent avoir été discriminées à cause de leur apparence que les femmes ayant un IMC normal »
discriminations médicales
personnels médicaux grossophobes, matériel inadapté (par exemple les tunnels de scanner ou IRM), pharmacologie également inadaptée (par exemple la pilule du lendemain impropre pour les plus de 80 kg)
sociabilité
remarques d’inconnu·es, de collègues ou de parents d’élèves sur une prétendue grossesse dès lors qu’un ventre apparaît ; difficulté d’accès aux transports en commun, aux infrastructures accueillant du public, etc.
Face à la grossophobie, ce sont toutes les représentations sur les normes de beauté et sur ce qui serait « acceptable » ou pas dans l’apparence physique qu’il faut déconstruire. Il est urgent que les autorités de santé publique prennent en compte, sans jugement, les variations morphologiques qui existent et qui sont le résultat bien plus de notre responsabilité collective (précarité) que de responsabilités individuelles.
La loi de 1905
Conformément à l’esprit de la loi de 1905, la laïcité est un principe d’impartialité, d’indépendance et de neutralité des institutions publiques face à la religion. Cette loi de séparation de l’Église et de l’État garantit également la liberté de conscience de toutes et de tous. Dans le champ de l’éducation, c’est cette loi qui garantit que les enseignements soient menés hors de toute contrainte religieuse.
Pour SUD éducation, c’est ce principe de laïcité et d’égalité qui doit sous-tendre toutes les réformes et décrets concernant la religion dans l’éducation nationale et ailleurs.
Or, force est de constater que depuis plusieurs années, toutes les religions ne sont pas logées à la même enseigne. Alors que la stricte séparation entre le christianisme et les institutions publiques est loin d’être respectée, l’islam est aujourd’hui stigmatisé par l’institution scolaire dans un contexte montée en puissance du racisme.
Alors que les cultes et les églises ne sont plus financés par des fonds publics depuis le début du XXe siècle, les établissements scolaires confessionnels sous contrat continuent de recevoir les subventions de l’État pour 73% de leur budget. Les lois Debré (1959) et Carle (2009) trahissent la loi de 1905 en faisant assumer à l’État et aux collectivités territoriales les salaires des enseignant·es du privé et de multiples financements. Pourtant, les établissements privés sont très largement responsables de la ségrégation sociale.
Par ailleurs, dans les établissements scolaires publics de la maternelle au lycée, les entorses à cette loi de séparation des églises et de l’état sont manifestes :
- une persistance des rituels d’inspiration et de tradition chrétienne au sein même des établissements
- des examens nationaux tenus dans des établissements confessionnels, dans des salles où apparaissent des signes religieux
- une année scolaire calquée sur le calendrier religieux chrétien (dates, certains noms)
La loi de 2004 fait suite à l’arrivée pour la première fois d’un candidat de l’extrême droite au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2002. Cette loi est un tournant dans la législation : tout à coup, la laïcité s’applique aux usagers et usagères du service public . Cette loi de 2004 met en œuvre une idéologie néolaïque qui est en rupture avec l’esprit de la loi de 1905 et le principe de laïcité. Elle ouvre la porte à une extension sans borne de la restriction de la liberté de culte. Elle discrimine les élèves musulman·es ou supposé·es musulman·es et déroge au principe d’impartialité et de neutralité des fonctionnaires vis à vis des élèves par rapport à leurs religions.
À l’heure où les idées racistes et islamophobes sont largement répandues, il est important de rappeler nos ambitions d’une école émancipatrice et égalitaire, ouverte à tou·tes sans distinctions de genre, d’origine, de religion et de milieu social.
Laïcité, islamophobie, racisme d’État : définitions
Laïcité : séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses reposant sur l’articulation de plusieurs principes : la liberté de conscience et la liberté de culte dans le respect de l’ordre public, ; l’égalité des citoyen·nes devant la loi sans considération de religion et de conviction ; la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses .
Racisme d’État : le racisme n’est pas seulement un phénomène individuel : c’est un système de domination, d’oppression et d’exploitation dans lequel l’État et ses différentes institutions jouent un rôle structurant, en mettant en place des politiques discriminatoires, en cautionnant des pratiques ou en s’abstenant d’agir pour lutter contre les discriminations. La lutte contre le racisme ne doit donc pas être un combat purement moral, c’est une lutte politique.
Islamophobie : l’islamophobie désigne l’oppression et la discrimination systémiques des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane.
C’est une forme de racisme structurel et culturel, qui débouche sur des peurs, des représentations dégradantes, des discriminations et des violences verbales ou physiques. L’islamophobie est aujourd’hui une composante majeure du racisme d’État. L’islamophobie est reconnue par les organisations internationales dont l’ONU.
Les origines de l’islamophobie
L’époque coloniale est l’une des matrices fondamentales de l’islamophobie française. À la fois jugé comme principal obstacle à la colonisation, mais aussi perçu comme le rappel des conquêtes et de la vision belliciste des croisades, l’islam est rapidement essentialisé comme une religion ennemie, rétrograde, violente et dangereuse.
Les institutions coloniales françaises structurent la nécessité de contrôler l’islam, envisagé comme un système idéologique plutôt qu’une religion, pour assurer le succès du système colonial et l’expansion de l’Empire, notamment en Algérie. L’islam est depuis cette époque considéré comme une menace pour les institutions françaises et comme un ennemi de l’intérieur.
À l’instar de beaucoup de conquêtes coloniales, la conquête du Maghreb et plus particulièrement celle de l’Algérie par les colons français fonde sa légitimité par la mission civilisatrice des « indigènes ».
À la fin du XIXe siècle émerge une littérature savante qui justifie la soumission des « indigènes« au pouvoir colonial, et en particulier des femmes musulmanes instrumentalisées pour atteindre les hommes et pour asseoir la domination coloniale,. Ainsi, Ernest Renan, académicien considéré comme un homme de science et un grand politique, défend dans ses écrits l’infériorité des musulmanes, la dangerosité essentielle de l’islam et son hostilité à la raison et au savoir.
Cette littérature dite élitiste va infuser longtemps dans la société française et être vulgarisée pour être étendue à un lectorat plus large. Elle est institutionnalisée comme un savoir dans les manuels scolaires de la IIIe République. Cette rhétorique savante est encore bien vivante aujourd’hui à travers des hommes et des femmes politiques ou des éditorialistes politiques qui l’utilisent comme une référence académique acceptable pour justifier leur islamophobie.
Plus tard, durant la guerre d’Algérie, des militaires spécialistes de la guerre psychologique incitaient les femmes musulmanes à rejeter le voile en organisant des cérémonies de dévoilement sur place publique. L’obsession française pour le voile est largement issue de son histoire coloniale.
Il existe une continuité entre le sexisme et le racisme des colons français et les discriminations qui frappent actuellement les femmes et les hommes issu·es de l’immigration postcoloniale.
Instrumentalisation sexiste et raciste du féminisme
La loi de 2004 est également une loi sexiste, défendue par des figures politiques et intellectuelles qui ont instrumentalisé la lutte pour les droits des femmes à des fins racistes.
Si la loi de 2004 étend en principe l’interdiction des signes religieux à l’ensemble des élèves sans distinction de genre ou de religion, son objectif principal était de déterminer la manière dont les filles, spécifiquement musulmanes, pouvaient s’habiller à l’école. En décrétant comment les filles peuvent s’habiller, l’État s’inscrit dans la tradition patriarcale du contrôle du corps des femmes et des filles. La loi de 2004 est l’une des multiples injonctions vestimentaires que fait peser le ministère de l’Éducation nationale sur les filles.
En septembre 2023, la circulaire Attal impose une nouvelle interdiction, celle de la robe longue. Comment déterminer la signification religieuse d’un voile ? Comment faire la différence entre une robe longue autorisée et une robe longue interdite si ce n’est en fonction de celle ou de celui qui la porte ? Jugées trop couvertes pour la loi de 2004, les filles seront considérées comme trop dévêtues quand elles décideront de porter d’autres vêtements. Ces injonctions sont des violences de genre qui pointent du doigt nos élèves et les stigmatisent en reproduisant des stéréotypes sexistes, racistes et coloniaux. Il faut apprendre aux filles que leur corps leur appartient et que leurs choix vestimentaires ne doivent faire l’objet d’aucune contrainte : ce ne sont ni des menaces ni des invitations.
Par cette loi, les élèves portant le foulard ou le voile sont des victimes permanentes d’une suspicion. Elles sont soit considérées comme des victimes soumises aux injonctions religieuses, soit déclarées coupables et complices d’une idéologie religieuse radicale. Cette loi constitue une instrumentalisation à des fins nationalistes et islamophobes de la lutte pour les droits des femmes . C’est ce qu’on appelle le fémonationalisme, qui accompagne la montée du racisme et du fascisme et impose sa lecture identitaire. La lutte des femmes contre toutes les formes d’oppression patriarcale ne peut être brandie pour en opprimer d’autres. La loi de 2004 témoigne du succès d’une partie du féminisme universaliste, qui invisibilise les différences entre les femmes, oubliant notamment les femmes racisées.
Des enfants nié·es dans leur capacité de réflexion
L’article L 141 – 2du Code de l’éducation stipule que « l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances ».
Tout enfant a droit à l’éducation quelle que soit sa religion. Tout enfant a le droit d’être et de sentir pleinement inclus dans le système éducatif sans qu’un regard suspicieux ou non neutre soit posé sur lui. Des lois qui visent à marginaliser certain·es élèves musulman·es ou supposé·es musulman·es vont à l’encontre de ce droit fondamental sous prétexte de lutter pour l’émancipation des élèves et contre l’obscurantisme religieux. La loi de 2004, et les décrets qui en découlent, transforment la laïcité en un principe qui exclut les élèves musulman·es ou supposé·es tel·les. Elle interdit l’accès aux établissements scolaires et à tous établissements publics dans le cadre scolaire (remise de diplômes, cérémonies officielles) à des élèves. Elle vise principalement les élèves musulmanes ou supposées telles. Comment peuvent-elles se sentir pleinement incluses si la suspicion qui pèse sur elles amènent les adultes à scruter même la taille, la forme et la couleur de leurs habits, à mesurer la taille d’un bandeau sur les cheveux ?
Tout enfant a le droit à la liberté d’expression, y compris sur le sujet des valeurs républicaines. La laïcité, en particulier, ne peut être un catéchisme républicain : elle doit se vivre en classe, être inclusive et questionnée, discutée, appropriée par les élèves. Cela ne peut que passer par l’acceptation des désaccords, sans stigmatisation, et en faisant confiance au professionnalisme des enseignant·es pour expliciter les notions. Les signalements abusifs et répressifs de paroles d’élèves vont à l’encontre de ce droit et participent à une criminalisation de leur discours qui les amène à se censurer, ce qui empêche un véritable enseignement de ces notions.
Les élèves sont ainsi nié·es dans leur capacité de réflexion. Or la liberté d’expression est une nécessité pédagogique en plus d’être un droit fondamental.
La loi de 2004 : un cadre abusif de légitimation des violences islamophobes dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur
Imposer l’interdiction du port du foulard ou de la robe longue revient à réduire les élèves au silence, ce qui est contradictoire avec leur liberté de conscience et d’expression, voire à les invisibiliser.
A l’école, les mères d’élèves portant le foulard sont exposées à de nombreuses offensives islamophobes. Quant aux enfants de familles musulmanes ou supposées l’être, leurs actes sont systématiquement passés au crible de la laïcité et entachés de soupçon. On a ainsi vu la mairie de Nice et les médias locaux s’émouvoir en 2023 de la radicalisation d’élèves de 8 ans, signalé·es pour s’être amusé·es à faire des prières dans la cour ! On imagine le traumatisme et la violence symbolique que représente cet acharnement sur ces enfants, et la perte de confiance en l’école publique qu’il peut engendrer. La question des repas à la cantine constitue elle aussi un véritable enjeu.
Dans les lycées et les collèges, les assistant·es d’éducation sont en première ligne de la mise en application de cette politique répressive. On leur demande de contrôler que les élèves musulmanes ou supposées telles enlèvent bien leur abaya et robe longue, de vérifier qu’elles ne mettent pas leur capuche, de refuser l’entrée à des élèves qui portent le foulard ou une tenue supposée religieuse, parfois même de contrôler la taille des bandeaux et des jupes des élèves. Ces pratiques, impulsées par des chef·fes d’établissement, sont légitimées par les circulaires des ministres Ndiaye et Attal. Et lorsque les AED protestent contre les dérives racistes et islamophobes, en se mettant en grève ou en affichant leur désaccord, ils et elles sont sanctionné·es, licencié·es ou a minima non-renouvelé·es, comme ce fut le cas au lycée Victor Hugo à Marseille.
Dans le supérieur, l’enquête nationale Acadiscri de 2022 sur les questions de discriminations, racisme et sexisme à l’université, montre que, parmi le faible taux de participant·es,12,3 % des étudiant·es qui se disent perçu·es comme musulman·es affirment avoir subi des faits racistes, notamment en raison du port du foulard, en cours comme face à l’administration. L’enquête « islamophobie et discrimination à l’université », menée par l’association des étudiants musulmans de France en 2022, établit que les discriminations à caractère racial ou islamophobe ont eu une conséquence directe sur la scolarité de 35% des répondant·es et des répercussions sur le plan psychologique et mental pour 38%, sans pouvoir les porter devant une cellule de veille et d’écoute puisque la moitié des universités n’en disposent pas.
Face aux appels récurrents de la droite et de l’extrême droite françaises à interdire le port du voile à l’université, il convient de rappeler que celle-ci ne vit que par les échanges internationaux, l’accueil de chercheur·es étranger·es, la confrontation libre des idées. Une des conditions en est le respect strict de la laïcité au sens de la loi de 1905. La liberté qu’ont aujourd’hui les femmes de porter ou ne pas porter le voile à l’université, en France comme dans la majorité des universités dans le monde, doit être défendue sans réserve. Les accusations qu’ont fait porter Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal sur les prétendus « ravages à l’université » de l’« islamo-gauchisme » témoignent d’une volonté inédite de contrôler la production de savoirs et de pensée.
SUD éducation revendique :
- une école publique réellement émancipatrice et ouverte à tou·tes qui ne discrimine pas, ne domine pas et ne stigmatise pas ;
- l’abrogation de la loi 2004 ;
- l’abrogation de toutes les lois et circulaires islamophobes ;
- la fin de l’interdiction des robes longues dans les établissements scolaires ;
- la fin des convocations et des sanctions abusives d’élèves accusé·es d’enfreindre la laïcité ;
- la réintégration des personnels mis·es à pied ou licencié·es abusivement pour avoir protesté contre l’islamophobie dans l’Éducation nationale ;
- la fin du financement de l’école privée par l’État et le transfert des personnels dans le public
6 - Le droit d’être soigné·e, protégé·e des maladies
On ne compte en moyenne qu’un médecin pour 12 000 élèves. Les personnels infirmiers sont très rarement affectés à temps plein dans un établissement scolaire dans le second degré, et couvrent un nombre important d’écoles dans le premier degré. Alors que la santé, y compris mentale, des élèves s’est fortement dégradée depuis le début de la crise sanitaire, le ministère refuse de donner les moyens au service public de l’éducation pour veiller à la santé des élèves scolarisé·es
SUD éducation revendique :
- Des personnels médicaux-sociaux en nombre suffisant ;
- 1 infirmerie ouverte sur tout le temps scolaire dans chaque établissement avec la présence d’au moins un personnel infirmier titulaire. Cela permet aussi du temps pour des interventions en classe, des concertations et de la co-animation avec des professeur·es et les CPE ;
- 1 Assistant·e de Services Sociaux à temps plein dans chaque établissement et leur déploiement dans le premier degré ;
- Le renforcement de la médecine scolaire avec des visites obligatoires pour tous·tes les élèves ;
- Le renforcement des CMP et de l’équipe paramédicale de prévention et de dépistage (orthophonie, psychomotricité, psychologie, ophtalmologie…);
- Des PsyÉN en nombre suffisant ;
- 1 PsyÉN pour 400 élèves au maximum.
7 - Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir : STOP au SNU !
La mise en place du SNU sur le temps scolaire est encore un coup porté aux heures dévolues aux apprentissages, déjà mis à mal par la réforme Blanquer du bac. C’est une militarisation et un renforcement de la soumission qui éloignent encore plus l’école d’un projet émancipateur.
Le déploiement du SNU sur temps scolaire nous renforce dans nos revendications : abrogation pure et simple du dispositif, reversement des fonds alloués dans le service public d’éducation. Il s’agit en effet d’une entreprise de militarisation de la jeunesse, d’un déploiement des idées nationalistes, qui met en danger les jeunes accueilli·es. De nombreux cas de maltraitances et de violences sont relevés à chaque séjour sans exception, dont des agressions sexuelles et viols, des propos racistes et homophobes.
A rebours de ce projet militariste et réactionnaire, SUD éducation revendique une école émancipatrice. Celle-ci ne peut passer que par la liberté d’expression des élèves, y compris sur le sujet des valeurs républicaines. La laïcité, en particulier, ne peut être un catéchisme républicain, mais doit se vivre en classe, être questionnée, discutée, appropriée par les élèves. Cela ne peut que passer par l’acceptation des désaccords, sans stigmatisation, et en faisant confiance à la professionnalité des enseignant·es pour expliciter les notions. Il en va de même pour les questions géopolitiques. La situation actuelle en Palestine suscite de manière légitime des interrogations et des indignations de la part des élèves : il appartient pleinement aux enseignant·es de favoriser, dans une logique de citoyenneté et d’esprit critique, les échanges sur les sujets d’actualité. Dans ces situations, le principe qui doit prévaloir est la liberté d’expression des élèves, qui est à la fois un droit fondamental et une nécessité pédagogique.
8 - Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru·e, et d’avoir des conditions de vie décentes
Destruction d’habitats de fortune à coups de pelleteuse lors de l’opération Wuambushu à Mayotte, matraquage des jeunes migrant·es lors du démontage du campement qui s’était établi devant le Conseil d’État : les autorités françaises ont une manière bien particulière de gérer la question du mal-logement, qui frappe de plein fouet les enfants.
D’après le baromètre des enfants à la rue de l’Unicef, dans la nuit du 21 au 22 août, près de 2 000 enfants “sont resté·es sans solution d’hébergement” et “29 780 enfants ont été hébergés en hôtel”. 20% d’enfants en plus dorment dehors. La place d’un·e enfant, en pleine nuit, n’est pas dans la rue. Un·e enfant ne peut, sur du long terme, vivre dans un hôtel avec sa famille. Des hébergements dignes doivent être proposés à ces familles et les enfants ne devraient pas être amené·es à changer de logement plusieurs fois par mois sans prise en compte du suivi de leur scolarité ou de leur besoin de stabilité, d’autant que, selon une étude de l’Insee de 2021, il existe près de 3,1 million de logements vacants en France,
Plus de 42 000 enfants vivaient dans des hébergements d’urgence, des abris de fortune ou dans la rue d’après l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. SUD éducation revendique un toit pour tous et toutes et la fin des expulsions des immigré·es. L’accès à l’éducation est un droit fondamental et doit pouvoir être accessible à tous et toutes dans des conditions décentes. Des élèves sans toit ou menacé·es d’expulsion ne bénéficient pas d’une scolarité comme les autres enfants alors qu’il s’agit d’un droit. Afin de permettre à ces élèves de suivre dans de meilleures conditions, leur scolarité, SUD éducation se mobilise aux côtés d’associations et de collectifs afin de faire respecter les droits de tous les enfants en particulier les enfants immigré·es et leur obtenir un toit pour vivre décemment en France. SUD éducation apporte son soutien à tou·tes les militant·es, à toutes celles et ceux qui luttent au quotidien en faveur des droits des élèves immigré·es à être scolarisé·es comme les autres élèves.
L’absence de domicile a un impact sur la santé mentale de l’élève (mal-être, sommeil, estime de soi, alimentation, stress). Cela peut provoquer des troubles de l’anxiété, de la dépression et des troubles de l’humeur.
L’augmentation de la précarité, renforcée par le contexte d’inflation actuel, jette à la rue des familles de plus en plus nombreuses, et notamment des familles de personnes sans-papiers. De plus en plus de personnes sont touchées par la précarité et sont de plus en plus concernées par les problèmes de logement. Pour rappel, le rapport de la fondation Abbé Pierre indique que 4 millions de personnes sont non ou mal logées, dont 300 000 personnes privées de domicile fixe. Ce rapport précise que 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement. De plus en plus de personnes rencontrent de nombreuses difficultés à payer leur loyer, leurs factures de gaz et d’électricité dans des logements insalubres et mal-isolés. 12 millions de personnes vivent dans une situation de précarité énergétique. 500 000 locataires sont en impayé de loyer et risquent une procédure d’expulsion.
Dans les établissements scolaires et les écoles, des collègues se mobilisent avec les familles, en lien avec les associations de soutien aux personnes sans papiers et les associations de défense du droit au logement. L’accès à l’éducation est un droit fondamental et doit pouvoir être accessible à tous et toutes dans des conditions décentes. Des élèves sans toit ou menacé·es d’expulsion ne bénéficient pas d’une scolarité comme les autres enfants. L’absence de domicile fixe a un impact sur la santé mentale de l’élève (mal-être, sommeil, estime de soi, alimentation, stress). Cela peut provoquer des troubles de l’anxiété, de la dépression et des troubles de l’humeur. Afin de permettre à ces élèves de suivre dans de meilleures conditions, leur scolarité, SUD éducation se mobilise aux côtés d’associations et de collectifs afin de faire respecter les droits de tous les enfants en particulier les enfants immigré·es et leur obtenir un toit pour vivre décemment en France. Des occupations d’écoles ont d’ores et déjà permis de débloquer des moyens d’hébergement qui, si ils sont provisoires, représentent néanmoins de premières victoires. SUD éducation encourage et soutient les mobilisations des personnels de l’éducation nationale aux côtés de leurs élèves et leur famille, et revendique un toit pour toutes et tous.
La véritable urgence n’est pas de débattre de l’uniforme à l’école comme le fait la secrétaire d’État à la ville mais de permettre à l’ensemble des élèves d’avoir un logement digne pour commencer cette rentrée scolaire. Aucun·e élève ne devrait dormir dans la rue en 2023.
Les revendications de SUD éducation :
- SUD éducation dénonce le sort réservé aux élèves sans toit et/ou menacé·es d’expulsion ;
- SUD éducation exige l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et la délivrance d’un titre de séjour pour toutes les familles concernées ;
- SUD éducation revendique la régularisation de toutes et tous les sans papiers et l’accès à une scolarité publique, gratuite et émancipatrice pour toutes et tous, sans condition aucune ;
- SUD éducation revendique la réquisition de logements, notamment les logements de fonction vides dans l’éducation nationale ;
- SUD éducation appelle à rejoindre toutes les mobilisations et tous les collectifs, à proposer des actions visibles de mise à l’abri comme les occupations d’école, à signer des pétitions, à participer aux goûters pour que ces élèves poursuivent leurs études en France.
9 - Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Plus de 4 millions d’élèves utilisent les transports en commun pour se rendre dans leurs établissements scolaires. La gratuité des transports est effective dans certaines villes. Des villes comme Dunkerque ou Calais proposent des transports totalement gratuits. D’autres villes comme Paris ont choisi une gratuité partielle des transports. Paris propose également la gratuité des transports aux élèves depuis 2021. 376 communes proposent la gratuité totale des transports sur leurs communes. Dans certaines métropoles comme celle de Lyon proposent la gratuité des transports pour les sorties scolaires.
Les premiers résultats des “Bilans Bas-Carbone” dans l’Éducation nationale montrent que les plus grosses émissions de gaz à effet de serre des établissements scolaires qui ne se trouvent pas dans des centres urbains résultent des déplacements des personnels et des élèves pour se rendre dans leur établissement scolaire.
La gratuité des transports est une mesure écologique mais aussi une mesure sociale
- Elle assure l’accès aux transports à tous et toutes ;
- Elle favorise la mobilité de tous et toutes.
La gratuité des transports en commun est déjà mise en place dans certaines villes comme Lyon. Cela favorise la réduction des inégalités sociales et territoriales tout en familiarisant personnels et élèves aux transports en commun. Il existe plusieurs lieux comme les musées et les parcs qui sont gratuits mais les budgets des établissements scolaires pour les sorties scolaires sont tellement insuffisants qu’ils ne permettent pas d’effectuer certaines sorties pourtant gratuites. La gratuité des transports en commun rendrait la culture en particulier plus accessible à tous et toutes.