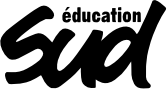Dans cette brochure « scolarisation et handicap : l’école pour touTEs pour une société antivalidiste », SUD éducation propose une série d’articles autour des enjeux actuels de la nécessaire transformation de l’école. 20 ans après la célèbre loi de 2005, il est grand temps de faire un bilan des politiques passées et présentes qui mettent à mal le respect des droits des personnes handicapées, à l’école comme partout, en France comme ailleurs. À travers des analyses critiques historiques, actuelles, internationales, des témoignages de professionnelLEs engagéEs sur le terrain, ou encore des militantEs antivalidistes, SUD éducation souhaite donner la parole à ceux et celles qui font l’école aujourd’hui, qui la pensent, et qui luttent pour une école publique accueillant chacunE, partout sur le territoire, sans aucune forme de discrimination, sans aucun tri, une école pour touTEs !
Pour cette brochure, nous dérogeons à nos règles typographiques habituelles en matière d'écriture inclusive, en préférant l'utilisation de majuscules à celle des points médians, pour faciliter la lecture par les logiciels "text to speach" utilisés par les personnes malvoyantes.
Sommaire
- Repolitiser la question du handicap
- Une autre place sociale, une autre école
- L’école française est validiste
- Le Covid-19 et l’inclusion scolaire, la fin de l’histoire ?
- Le tri social c’est dégueulasse… tout le temps !
- La parole aux travailleur·ses
- Ecole et handicap : comparaisons internationales…
- École inclusive : le modèle italien
- Associations gestionnaires : kesako ?
- Tribune du collectif une seule école (CUSE) : La loi 2005, 20 ans après
- Premières pistes de réflexions pour un syndicalisme accessible…
- Bibliographie
1 - Repolitiser la question du handicap
12 millions de personnes en France sont concernées par le handicap, soit 1 personne sur 5. Si leurs déficiences et réalités sont diverses, ces personnes sont toutes victimes du même système oppressif – le validisme – qui impacte très fortement leurs quotidiens : précarité, marginalisation, institutionnalisation, inaccessibilité du transport et du bâti…
Comment expliquer que, alors que le handicap constitue le premier motif de discrimination d’après le Défenseur des Droits parmi les cas dont il est saisi, cette question ne soit que très rarement abordée sous un angle politique ? Comment expliquer que le validisme soit un système oppressif encore si peu connu ? Comment expliquer que nous nous accommodions tous et toutes d’une injustice aussi criante ?
La réponse à ces questions réside peut-être dans la naturalisation de la domination des personnes handicapées. Cette domination est encore trop souvent envisagée comme étant naturelle, comme allant de soi.
L’objectif de cet article est donc de dénaturaliser la question du handicap afin de la repolitiser.
Dans beaucoup d’esprits, le handicap serait propre aux limitations fonctionnelles de la personne. Ce seraient les déficiences des personnes, leurs différences, qui les handicapent. C’est ce qu’on appelle le modèle médical du handicap.
Ce modèle implique que la norme, c’est l’homme ou la femme valide. Dans cette approche médicale, les personnes handicapées sont en conséquence exclues de la normalité, appréhendées dans leur écart à cette norme. De ce point de vue, les personnes handicapées sont des êtres incomplets, fragiles, à protéger ; ce sont des objets de soins, des êtres à réparer.
Elles sont renvoyées dans une altérité qui nie tout continuum. On est soit valide, soit handicapéE. Comme dans tous les systèmes de domination, c’est dans cette binarisation que les rapports de domination trouvent leur origine. C’est en raison de cette binarisation que les vies sont hiérarchisées.
Le modèle médical est donc la base du système validiste. Il naturalise les rapports de domination en renvoyant le handicap du côté du biologique, de la santé, en les présentant comme relevant du naturel et de l’invariant historique. Il présente comme étant évident, comme étant vrai partout et de tous temps, le fait que les personnes handicapées ne puissent pas faire autant de choses que les personnes valides. Cet écart dans les pratiques entre les personnes valides et les personnes handicapées se justifie alors de cette manière : ce sont leurs corps ou leurs esprits qui les limitent. Les personnes handicapées sont essentialisées à leur handicap. Ce sont leurs déficiences qui les déterminent.
Le modèle médical, en se posant comme un discours d’expertise, légitimise cette situation d’incapacité et en fait une prophétie autoréalisatrice : la catégorisation devient ainsi une réalité qui s’inscrit dans l’identité même des personnes handicapées, qui s’approprient alors une identité d’elles-mêmes dégradée et de marginaux.
Il s’agit à présent de l’affirmer : comme pour le classisme, le racisme ou le sexisme, les dominations ne sont pas la conséquence d’une infériorité naturelle d’un groupe social mais bien celles d’une organisation sociale. Le modèle médical masque le fait que les différences de traitement entre les personnes handicapées et les personnes valides sont le fait d’une organisation socialement et historiquement construite.
En distinguant la déficience du handicap, construit socialement, le modèle social du handicap bouleverse les représentations et ouvre de nouvelles perspectives. Le fait de ne pas pouvoir marcher n’explique en rien qu’une salle ne soit pas accessible ; une rampe, un ascenseur la rend accessible à touTEs. Le fait d’être malentendant n’explique en rien le fait de ne pas pouvoir assister à une conférence ; un micro ou un surtitrage peuvent rendre cette conférence accessible.
Le modèle social du handicap s’intéresse à l’environnement qui handicape et aux capacités des personnes handicapées, il défend l’accessibilité universelle et se centre sur les droits humains.
Contrairement aux déficiences, le handicap n’est, lui, que le résultat d’un choix de société : celui de ne pas rendre accessible à tous et à toutes l’ensemble du monde social. Dès lors, on comprend que les rapports de domination ne sont pas le produit d’une condition biologique, mais bien celui d’un rapport de force.
« La position inférieure qu’occupent les personnes handicapées dans la société et la domination qu’exercent les personnes valides n’est pas la conséquence naturelle d’une fatalité biomédicale mais le résultat de choix politiques et en ce sens elles sont historiquement et socialement construites » (Cécile Morin, stage SUD éducation Pour une école vraiment inclusive, mai 2023) Cette prise de conscience constitue la première étape de la déconstruction antivalidiste.
Puisque ce rapport de domination est socialement et historiquement construit, il peut être changé. Tous les mouvements progressistes militant pour l’émancipation de touTEs et la justice sociale ont donc le devoir de s’engager dans ce combat.
Avant toutes choses, dans une démarche de repolitisation de la question du handicap, il est nécessaire de conscientiser les discriminations vécues par les personnes handicapées.
Le validisme engendre la précarisation systémique des personnes handicapées. Il engendre des dépenses très importantes pour les personnes handicapées. C’est ce qu’on appelle « the disability price tag ». Malgré les aides financières telles que l’AAH, les personnes handicapées vivent très souvent dans la précarité car la condition handicapée implique souvent des temps partiels imposés et un accès à l’emploi compliqué (le taux de chômage des personnes handicapées est par exemple presque deux fois plus élevé que celui des personnes valides). Les travailleuRses handicapéEs sont de surcroît moins bien rémunéréEs et occupent des postes plus pénibles : 74% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi qui travaillent sont soit ouvrierEs, soit employéEs, contre 50% de l’ensemble de la population en emploi. Les employé∙es des Esat sont rémunéréEs en-dessous du SMIC pour un travail à plein temps.
Marina Carlos écrit « Lorsqu’il est physiquement impossible pour les personnes handicapées de se déplacer sur les trottoirs, d’entrer dans un immeuble, de prendre un verre ou d’aller voir un concert, la ségrégation des personnes handicapées est un fait. Elles sont exclues de l’espace (public et privé) et empêchées d’être autonomes ». C’est une ségrégation sociale et spatiale qui empêche aux personnes handicapées l’exercice plein et entier de leurs droits. Si, dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est écrit que « l’accessibilité est due à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap », force est de constater que le manque d’accessibilité est encore extrêmement important partout. Il concerne les transports, la culture, l’emploi, le logement, les loisirs, le sport, la formation, la fête et l’éducation. Tous les aspects de la vie donc.
Les lieux publics devaient par exemple tous être rendus accessibles en 2015, c’était un engagement de la loi de 2005. Non seulement l’engagement n’a pas été tenu, mais en plus, là où il avait été prévu que les lieux publics non accessibles paieraient des amendes, l’état a juste prolongé le délai.
Finalement, c’est le droit des personnes handicapées à vivre une vie autonome qui est bafoué.
Prenons l’exemple du logement, un des éléments essentiels à une vie autonome. La France a de ce point de vue encore complètement trahi les promesses faites aux personnes en situation de handicap, puisque la loi Elan promulguée le 23 novembre 2018 revient sur la loi de 2005 sur l’accessibilité, en instituant que ce ne sont plus tous les logements nouvellement construits qui doivent être accessibles, mais seulement 10%. Ainsi que l’explique Elena Chamorro dans la revue Polysème de juillet 2019, pour une personne handicapée, puisque les logements ne sont pas accessibles, il faut commencer par faire des travaux. Si c’est une location, les propriétaires préféreront donc évidemment unE locataire valide. Si la personne handicapée cherche à devenir propriétaire, il faudra ajouter au prix de l’appartement le prix des travaux. Pour les financer, deux problèmes se posent : la difficulté pour obtenir des aides et les délais d’attente si celles-ci sont accordées. Si on envisage des prêts bancaires pour payer d’éventuels travaux, il faut savoir que les prêts sont bien souvent refusés aux personnes handicapées, soit en raison de leur faibles revenus, soit en raison de leur condition de personnes handicapées. Reste la possibilité de ce que le gouvernement appelle le logement inclusif, l’habitat partagé, ou encore, plus cyniquement, des colocations. Ce sont des appartements où les personnes handicapées vivent entre elles, dans l’entre-soi. Ce sont souvent les associations gestionnaires qui gèrent ces formules. La plupart de ces appartements sont prévus pour une seule personne, interdisant donc de fait, la vie en couple ou la vie de famille.
De très nombreuses personnes handicapées sont enfin placées dans des institutions comme les IME, Itep, Esat, Mas… Ce sont des lieux où les enfants puis les adultes handicapéEs jugéEs non scolarisables ou non intégrables à la société sont orientéEs, c’est à dire excluEs des espaces ordinaires communs. Il faut comprendre que le spectre du placement en institution hante la vie des personnes handicapées. Ce sont des lieux définis par l’ONU comme des espaces de ségrégation, de discrimination et de privation de liberté, contraires aux droits humains. Dans ces lieux, les personnes handicapées sont souvent orientées contre leur gré, sont soumises à des règles qu’elles n’ont pas décidées du matin au soir, ne décident plus de leur vie, ni de ce qu’elles mangent, de l’heure de leur coucher, de leurs activités, de leur vie amoureuse…
Cette orientation vers les institutions concerne de 9 à 11 % des personnes handicapées en France contre 1 à 3 % dans les autres pays développés.
Le Comité des droits des personnes handicapées écrit : « L’autonomie de vie et l’inclusion dans la société supposent un cadre de vie excluant toute forme d’institutionnalisation ».
Il est nécessaire d’ajouter que les personnes handicapées sont davantage victimes de violences sexuelles. À titre d’exemples, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) indique en juillet 2020 que les femmes handicapées sont deux fois plus victimes d’agressions sexuelles que les femmes sans handicap. Elles sont également moins écoutées car on accorde moins de crédit à leurs paroles. Derniers chiffres, 35 % des viols et 36% des agressions sur mineurEs handicapéEs ont lieu dans les IME, des espaces présentés comme étant des espaces protégés. (Source : Ministère de l’Intérieur, bulletin SSMSI Interstats n°29)
Dans cette longue liste – non exhaustive – des discriminations vécues par les personnes handicapées, il faudrait ajouter l’infantilisation, les violences policières (le concept psychophobe de forcenéE a engendré de nombreuses violences), la prise en soin différenciée des personnes handicapées pendant le COVID, la sous-représentation des personnes handicapées dans les médias, le cripping up, l’intimité forcée…
Dans cette démarche de repolitisation de la question du handicap, il est enfin nécessaire de faire entendre les voix de celles et ceux qui se sont battuEs hier et de celles et ceux qui se battent aujourd’hui.
Le combat anti validiste est d’abord une lutte qui a une histoire.
Ainsi que le dit Cécile Morin dans l’épisode 3 de l’émission Handicap : la hiérarchie des vies diffusée sur France culture : « Dans ces années 70, les ouvriers et ouvrières handicapéEs ont participé à ces grands mouvements de luttes et ces grands mouvements sociaux post 68 qui, justement, voyaient agir les fractions les plus dominées de la classe ouvrière, c’est-à-dire les femmes, les immigréEs, mais aussi les travailleurs handicapés. Par exemple, à Besançon, il y a eu une occupation du CAT sur le modèle des LIP, avec des grèves productives. »
En France toujours, il faut parler du CLH (comité de lutte des handicapés) et de leur revue Handicapés méchants. Fondé en 1973, dans la période du grand 68, le CLH engage des réflexions et propose des analyses politiques du handicap, défend l’accessibilité et s’oppose radicalement aux associations gestionnaires et à la logique productiviste du capitalisme, mène des actions qui visibilisent les discriminations et portent leurs revendications.
Ces luttes sont également internationales.
Judith Heumann, que l’on voit dans le film CRIP CAMP, témoignage essentiel des luttes antivalidistes des années 1970, occupe avec 150 personnes pendant 28 jours le Ministère de la santé et de l’éducation à San Francisco pour l’application de la première mesure de protection fédérale américaine des droits civils des personnes handicapées. Ils et elles sont soutenuEs par les Black Panther et des collectifs féministes.
Ed Roberts, activiste américain qui développe, avec d’autres, le mouvement pour la vie autonome, ouvre le premier centre pour la vie autonome en Californie en 1972.
L’Upias (Union des handicapéEs physiques contre la ségrégation) en Angleterre développe un programme – Principes fondamentaux sur le handicap – qui aboutit au modèle social du handicap (Mike Oliver).
Internationalement, des collectifs antivalidistes s’engagent contre le Téléthon depuis les années 80, notamment aux États Unis et au Royaume Uni où était scandé le slogan « Piss on pity ».
Hélas, ainsi que le remarque Cécile Morin dans l’émission Handicap : la hiérarchie des vies, cette histoire est silenciée. Dans la foulée des lois de 75, ce sont les associations gestionnaires qui, en France, ont gagné la bataille. Ce sont toujours les vainqueurs qui racontent l’histoire, et les associations gestionnaires n’ont aucun intérêt à rappeler cette histoire des luttes antivalidistes.
Aujourd’hui, nous assistons cependant à une nouvelle séquence de luttes, en particulier depuis la mobilisation « Non au report » de 2015. Les collectifs français sont nombreux – Handisocial, le Clhee, les dévalideuses, Cle autistes, le Cuse… – et très actifs. Tous ces collectifs partagent des orientations pour la vie autonome, pour la désinstitutionalisation, contre le validisme, l’handiphophie et les discriminations, pour une représentation juste des personnes handicapées et pour le respect des droits humains.
SUD éducation et l’Union syndicale Solidaires s’engagent désormais dans cette lutte.
Comme pour le reste, la question de l’éducation et du handicap est éminemment politique.
Des enfants sont-ils et elles inadaptéEs à l’école où est-ce l’école qui est inadaptée à l’accueil de touTEs ? Si on considère que des enfants sont inadaptéEs à l’école, nous continuerons à les exclure dans les espaces de ségrégation que constituent les IME et les Itep. Si au contraire nous abordons cette question sous l’angle du modèle social du handicap, alors c’est l’école qu’il faut transformer pour permettre à touTEs d’être scolariséEs dans l’école ordinaire. Il ne s’agit pas de nier les besoins particuliers des élèves, il s’agit d’intervenir sur l’environnement pour le rendre accessible et répondre aux besoins de touTEs et de déployer les moyens médicaux-sociaux nécessaires pour accompagner touTEs les enfants dans l’école ordinaire et ses locaux.
- Zig Blanquer, Nos existences handies, Le Monstrographe, 2022
- Cécile Morin, La lutte anti-validiste est une lutte d’émancipation, Mouvements, 2021
- Charlotte Puiseux, De chair et de fer – Vivre et lutter dans une société validiste, La Découverte, 2022
- Elisa Rojas, Mister T et moi, Hachette, 2020
- Marina Carlos, Je vais m’arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, 2020
- Clémence Allezard, Assia Khalid, Handicap : la hiérarchie des vies, LSD, France Culture, 2022
- Thibault Petit, Handicap à vendre, Les Arènes, 2022 (enquête d’un journaliste pendant 6 ans sur les Esat)
- Rapport final des Nations Unies sur l’application de la CDPH par la France
- Crip Camp – La révolution des estropiés, 2020 (documentaire de James Le Brecht)
- Carnet de recherches en ligne de l’historien Gildas Brégain : Handicap, histoire et politique au XXe siècle
- Sites internet des collectifs antivalidistes : le CLHEE, les Dévalideuses, CLE Autistes
- Blogs d’activistes handicapé-es : Amongestedefendant (No Anger); Auxmarchesdupalais (Elisa Rojas); Blog d’Elena Chamorro sur Mediapart
2 - Une autre place sociale, une autre école
« L’institution d’une séparation débouche sur des situations sociales différentes selon la nature de la communauté et des principes d’intégration qui la caractérisent. Ainsi, des statuts particuliers, soutenus par des valeurs collectives, peuvent permettre de concilier des incapacités reconnues avec une affiliation sociale : cela constitue une situation d’acceptation. Mais il existe également des situations de rejet qui dépendent des caractéristiques de la communauté. […] la spécificité du rapport social de handicap ne réside pas dans l’institution d’une séparation, mais dans l’absence d’attribution d’une autre place sociale. L’individu flotte dans les interstices de la structure sociale. […] Cette situation de seuil est qualifiée de liminalité. »
Dans « Le handicap comme situation de seuil : éléments pour une sociologie de la liminalité », Marcel Calvez analyse le concept de liminalité appliqué au handicap, à la suite des analyses de l’américain Robert F. Murphy, devenu tétraplégique dans les années 70, et qui a porté sur son expérience du handicap son regard d’anthropologue. Celui-ci pose que « les handicapéEs à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé, ni morts ni pleinement vivants, ni en dehors de la société ni tout à fait à l’intérieur. »
La Loi n°75 – 535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui est considérée généralement comme un progrès en France, alors que des luttes menées par des personnes handicapées pour leurs droits civiques se déroulaient à la même période dans les pays anglo-saxons, offre aux personnes handicapées un statut social séparé, en désignant leurs places sociales dans des établissements ségrégués. « L’institutionnalisation de la catégorie du handicap en France marque la consécration d’un nouveau mode de gestion de l’altérité qui se caractérise par des objectifs de normalisation des populations ayant des déficiences […], produit d’un ordre négocié entre les différentes instances qui traitent de la gestion de cette altérité sous l’égide de l’État. »
La théorie de Murphy s’appuie sur celle de l’ethnologue allemand Arnold Van Gennep au sujet des rites de passages d’une situation sociale à une autre. « Chaque séquence de passage se caractérise par une succession de trois stades : la séparation, le seuil et l’agrégation ».
Trente ans plus tard, la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » commence à sortir la situation des personnes handicapées du stade de la séparation. Celle-ci entre en France dans le deuxième stade défini par Van Gennep, celui du seuil, « ni en dehors de la société ni tout à fait à l’intérieur », entre le stade séparé conféré par le placement en établissement socio médical et le stade d’agrégation à la société.
Cette situation a connu des évolutions.
Tant que les élèves en situation de handicap étaient contenuEs dans le giron de l’enseignement spécialisé, la situation était acceptable pour l’institution scolaire. Le pacte consistait à favoriser l’intégration sociale des élèves en situation de handicap dit « léger », sans ambition particulière scolaire ou professionnelle ni exigence pour eux-elles, tout en prétendant éduquer à la différence les élèves dits ordinaires.
Une décennie après la loi de 2005, on est passé d’une logique d’intégration à une logique d’inclusion de touTEs les élèves en situation de handicap, sous l’impulsion internationale. Mais ce passage s’est effectué en France sans que soit pensée la rupture avec le système antérieur, ni que les moyens afférents soient transférés. Du fait de situations difficiles à gérer dans l’environnement actuel, ceci a provoqué progressivement des tentations de retour en arrière, voire alimenté des attitudes réactionnaires.
L’inclusion ne pourrait être « systématique » ou « à tout prix », prétend-on.
On attribue cette impossibilité au handicap même, créant une nouvelle catégorie d’élèves « hautement perturbateurs », renouant ainsi avec la « faute » dont est entaché le handicap de longue date. La place de ces élèves serait dans les établissements médico-sociaux. On préfère cette allégation plutôt que de constater que de toute évidence l’école s’adapte moins aux élèves que les élèves ne doivent s’adapter à elle. Ou si on le constate, on l’admet beaucoup plus aisément que pour la défense des élèves issuEs des classes populaires par exemple.
« La spécificité du handicap réside dans le fait que le passage n’aboutit pas et que la situation liminaire se cristallise en un état intermédiaire. […] Les individus qui restent dans une situation intermédiaire représentent une menace pour l’ordre social. […] Des imputations de danger, de souillure ou de contagion permettent de justifier la marginalité dans laquelle ils sont placés. »
Comment sortir de cette étape de liminalité ? L’agrégation des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins particuliers en général, nécessite que le système scolaire français se refonde et qu’on y mette les moyens.
La loi de 2005 a ouvert les portes de l’école aux élèves en situation de handicap, mais sans leur accorder totalement un nouveau statut. Leur place est sans cesse interrogée : relèvent-ils et elles du médico-social ou de l’école ? La question de leur orientation est sans cesse posée. Vont-ils et elles être inclusEs et dans quelle matière ? Une inclusion, avec quels objectifs ? Peuvent-ils et elles participer à telle sortie ou tel projet ? Leur place est l’objet de négociations perpétuelles, dont les enseignantEs spécialiséEs et les AESH comme les personnels du médico-social peuvent se faire les témoins.
Cette place s’est agrandie. Des milliers d’élèves suivent un parcours scolaire qui les conduit aujourd’hui jusqu’à la fin du collège et souvent en lycée professionnel, ce qui aurait été impensable il y a une vingtaine d’années. Mais le chemin à parcourir reste très important. Le rapport récent de la Cour des comptes sur l’inclusion des élèves en situation de handicap montre « une école à bout de souffle » : une politique inclusive dont les objectifs ne sont pas clairs, un parcours scolaire des élèves en situation de handicap qui relève encore du parcours du combattant, une accessibilité matérielle et pédagogique défaillante, un manque de formation des personnels, un statut précaire pour les accompagnantEs. L’école reste sous-tendue par son modèle méritocratique et l’inclusion tributaire du modèle médical. L’alternative médico-sociale ou scolaire est bien révélatrice de cette situation de liminalité évoquée par Murphy.
Revendiquer un cadre favorisant réellement la scolarisation des élèves en situation de handicap dès leur plus jeune âge, c’est-à-dire un cadre où les professionnelLEs ne sont pas réduitEs à faire comme ils et elles peuvent sans formation avec les moyens du bord. Un cadre pensé et ambitieux pour touTEs les élèves, est la seule réponse syndicale possible : c’est-à-dire sortir de cette période transitoire qui malmène élèves et personnels et faire place aux élèves en situation de handicap en favorisant un travail d’équipe interdisciplinaire de personnels du médical, du social, de l’éducatif et du scolaire et en remaniant espaces, temps scolaire, programmes, supports, objectifs, pratiques et valeurs de l’école. Déconstruire pour reconstruire.
3 - L’école française est validiste
Texte de la fédération SUD éducation, publié le 18 octobre 2024
Il y a toujours ce problème avec l’école lorsqu’on s’intéresse aux discriminations et aux rapports de dominations, c’est qu’elle se pense elle-même comme le lieu de l’universalisme républicain. Les politicienNEs parlent d’elle de cette manière, les journalistes, les travailleurEUSEs de l’Éducation nationale aussi. L’école ne pourrait être le lieu de discriminations dans la mesure où elle s’envisage comme un « sanctuaire » et dans la mesure où on y enseigne le principe républicain d’égalité et de tolérance. Puisque le principe d’égalité y est sans cesse invoqué, puisqu’il est écrit au fronton des écoles, alors il serait déjà pleinement réalisé.
Ceci est évidemment une fiction et les rapports de domination sont à l’œuvre à l’école comme dans le reste de la société.
L’école française est d’abord validiste parce que la société française est validiste et que l’école ne se situe pas en dehors de la société.
L’école française est validiste parce que les représentations que se font les travailleurEUSEs de ce que doit être unE élève, de ce que doit être leur travail et de ce que sont les besoins d’unE élève handicapéE sont erronées et peu remises en question. Il faudrait écrire un article entier sur ce seul sujet, mais l’essentialisation des élèves handicapéEs à leur handicap constitue un des problèmes majeurs. Le validisme, comme tous les systèmes de domination, est diffus, présent partout et toujours. Nous avons grandi dans une société validiste, le validisme nous a en partie façonnéEs, tous et toutes. Il a façonné nos imaginaires et nos représentations ; il a façonné également celui des travailleurEUSEs de l’Éducation nationale qui, dans leur grande majorité, pensent sincèrement que si les élèves handicapéEs doivent être misEs à l’écart, c’est pour leur bien, qu’ils et elles relèvent du soin et pas de l’école, qu’unE élève qui ne peut pas suivre le programme n’a pas sa place en classe.
L’école française est validiste parce que c’est le lieu d’une grande normativité. Ses normes sont celles de la réussite scolaire, de la productivité, de la bienséance par exemple. Elle intime aux élèves présentant un écart à la norme de manière générale – élèves allophones, en grande difficulté, trans, pauvres… – et aux élèves handicapéEs en particulier de se conformer à ces normes. Le rôle de l’école n’est pas de permettre à touTEs de s’épanouir depuis les singularités propres à tout individu. Les élèves doivent pouvoir suivre les programmes, le rythme, le groupe. Qui ne peut le faire n’y a pas sa place.
L’école française est validiste parce qu’elle est l’école d’une société capitaliste. Elle est conçue comme un levier de la compétitivité économique. L’école capitaliste valorise l’efficacité, la performance, la productivité, la compétitivité et exclut par là un nombre important de ses élèves, dont les élèves handicapéEs. De la même manière qu’une fois adulte il ou elle aura à s’adapter au monde du travail, c’est à l’élève de se conformer à l’école, pas l’inverse. Dans l’école capitaliste, c’est un enjeu d’apprentissage.
L’école française est validiste parce que son histoire se structure autour de la mise à l’écart d’une partie des élèves en fonction d’un écart à la norme (cf article Histoire d’une école pas vraiment inclusive dans la brochure École, inclusion et handicap de SUD éducation). Cette histoire est longue ; elle n’est pas remise en question et apparaît comme étant évidente et pleine de bon sens. Pourquoi changer puisque ça a toujours été comme ça ?
L’école française est validiste parce qu’elle se structure toujours autour de la mise à l’écart d’une partie de ses élèves en fonction d’un écart à la norme. Une partie des élèves sont toujours excluEs de l’école ordinaire pour être placéEs dans des institutions (Itep, IME…) qui sont définies par l’ONU comme des lieux de ségrégation.
L’école française est validiste parce que l’institution ne lui donne pas les moyens d’accueillir correctement touTEs les élèves.
L’école française est validiste parce qu’elle contraint les corps et a pour objet de contraindre les esprits.
4 - Le Covid-19 et l’inclusion scolaire, la fin de l’histoire ?
En janvier 2020 apparaissaient les premiers cas de COVID en France. Commençait alors une période d’exception pour le système éducatif français. En effet, la circulation d’un nouveau virus associée à l’absence de mesures de protection suffisantes ont eu pour conséquence de rendre impossible la scolarité telle qu’elle s’effectue habituellement. Le gouvernement adopta alors comme principale stratégie la création de protocoles qui avaient pour objectif de maintenir des conditions minimales de scolarisation, et à terme de permettre un retour à la normale.
Or ce « normal » n’a pas vraiment été interrogé. Au lieu d’affronter directement les enjeux liés à la pandémie, comme la protection sanitaire ou la mise en place d’une scolarité alternative, il semble que c’est plutôt le chemin du déni de ces enjeux qui a été majoritairement choisi par nos décideurEuses politiques. Le « normal » a été retenu comme une situation désirable sans réellement se demander si nous ne pouvions pas espérer mieux que retourner à la situation précédente. Alors que la pandémie aurait pu permettre de repenser en profondeur la question de l’inclusivité scolaire afin de mieux protéger notre école contre ce type de catastrophe et de permettre une scolarisation pour touTEs, pandémie ou non, elle n’a été qu’un temps « anormal » de scolarisation.
Dans cet article on se demande alors quels auraient pu être les autres choix concernant la question de l’inclusion scolaire, suite à la pandémie. On remarquera que si le Covid a mis en avant des enjeux centraux de l’inclusion pour touTEs les élèves, pour autant ces questions sont largement restées sans réponse une fois la période médiatique et politique passée.
Une mise à l’écart d’exception pour la plupart des élèves mais aussi l’expérience ambivalente d’une autre école pour des élèves en situation de handicap.
Comment faire quand les cours ne sont pas accessibles aux élèves ? C’est sans doute la question qui a été la plus importante et qui a été paradoxalement la moins prise au sérieux par nos responsables politiques. Déjà en mars 2020 à l’annonce du premier confinement, les inquiétudes étaient mises en avant sur la capacité de l’ensemble des élèves à suivre les cours, en mettant notamment l’accès sur la fracture numérique. Les enseignantEs se sont d’ailleurs souvent retrouvéEs livréEs à euxElles-mêmes pour produire des cours sur le tas, sans moyens supplémentaires. Or ces situations d’inadaptation et d’exclusion scolaire touchent depuis longtemps les élèves en situation de handicap. Le Défenseur des droits a ainsi récemment pointé du doigt le manque de moyens et de considération de l’État français vis-à-vis de ses engagements. Pour autant le Covid-19, qui aurait pu être une opportunité pour repenser la scolarisation de tous et toutes les élèves, à la fois en termes d’accessibilité à la classe, mais aussi en termes de supports mobilisés, n’a pas mené les acteurs et actrices à cette association. Or comme pour les élèves en situation de handicap en temps normal, le bilan de cette période n’est pas vraiment flatteur pour la majorité des élèves, notamment pour les élèves en situation de handicap. Il semble donc que l’occasion ici ait été manquée, de faire de la pandémie un événement moteur permettant une école pour tous et toutes. L’expérience n’a pour autant pas forcément eu que des effets néfastes, le confinement permettant localement de réaliser une expérience en direct d’autres conditions de scolarisation quand les moyens sont au rendez-vous, par exemple à l’Université :
« Un élève, dont nous n’avions jamais entendu la voix jusque-là, a pris la parole : il s’agit d’un camarade dont le handicap n’avait jusqu’alors pas permis d’assister au cours sur le Campus Condorcet. Celui-ci a admis que le confinement a considérablement facilité et simplifié son accessibilité au cours dont il n’avait auparavant que l’enregistrement audio a posteriori. »
D’autres formes de scolarisation sont donc aussi nécessaires. Il devient urgent de repenser globalement l’accessibilité égale et sans condition de l’école, afin de permettre l’accès au cours à tous et à toutes, pandémie ou non, handicap ou non.
De manière plus discrète, la question de la protection sanitaire a été presque complètement occultée au fur et à mesure que l’on sortait officiellement de la pandémie. Or là aussi ces questions ne se posent pas uniquement lors des situations de pandémie. L’école a ainsi toujours été fréquentée par un public dit « vulnérable » pour lequel les protections sanitaires sont importantes pour garantir sa sécurité à l’école. Il en est ainsi des personnes immunodéprimées, des personnes cardiaques et des proches de ces personnes qui peuvent potentiellement les contaminer. Ainsi « les enfants en âge d’être scolariséEs sont le moteur principal de la transmission de la grippe dans la population », qui produit environ 9000 décès chaque année pour ne citer que le plus évident. Vouloir une école qui protège la santé des élèves devrait pourtant être une des priorités. L’école ne devrait pas être un lieu où l’on risque plus qu’ailleurs de tomber gravement malade. Le COVID-19 a particulièrement mis en avant cette problématique, sa circulation actuelle entraînant des infections à répétition, qui peuvent à terme causer d’importantes séquelles, dites de « COVID long ». Ainsi, la qualité de l’air intérieur est par exemple souvent dénoncée comme étant insuffisamment bonne, mais cela reste peu relayé dans le milieu scolaire.
La pandémie a donc illustré à quel point l’accessibilité de l’école n’était toujours pas une priorité pour les décisionnaires, alors même que le contexte s’y prêtait pour l’ensemble de la société. Aujourd’hui alors qu’on se dirige vers une acceptation générale de la présence continue du COVID-19 dans la société, ces enjeux vont continuer à ressurgir de manière plus ou moins périodique pour la majorité de l’école, tout en continuant à peser sur la minorité d’élèves en situation de handicap. Aujourd’hui encore, il faut donc rappeler que l’accessibilité scolaire reste un enjeu global et permanent.
5 - Le tri social c’est dégueulasse… tout le temps !
En février 2024, la prise de fonction tumultueuse de la ministre Amélie Oudéa-Castéra nous jetait touTEs dans la rue ; pour se justifier d’avoir scolarisé ses enfants au collège privé catholique Stanislas, elle colportait le mythe de l’absentéisme généralisé des profs.
Cette provocation jetait de l’essence sur le feu déjà allumé des contestations : nous exigions des augmentations immédiates de salaires, des moyens conséquents pour une école pour touTEs et pour l’éducation prioritaire, un statut pour les AESH et l’abandon de la réforme “choc des savoirs” et de la réforme de la voie professionnelle.
Une intersyndicale très large rédigeait une motion à propos du choc des savoirs, lue le 22 mai lors d’une réunion du Conseil supérieur de l’éducation, et dans laquelle on pouvait lire :
« Nos organisations dénoncent l’ensemble des mesures, du premier au second degré, qui signent une certaine vision de la société, celle du tri et de l’assignation sociale, dangereuse pour notre démocratie. »
Les organisations syndicales dans leur ensemble s’indignaient du tri social que mettrait en œuvre le choc des savoirs et la mise en place des groupes de niveaux. Elles refusaient qu’une réforme ne creuse les inégalités, n’assigne un groupe d’élèves à une identité dévalorisante et ne relègue une partie de ces élèves dans les marges de la scolarité.
Elles sont restées et restent pourtant, dans leur très grande majorité, absolument silencieuses à propos du tri social que mettait déjà et continue de mettre en œuvre l’école française dans sa gestion du handicap. Pire, certaines de ces organisations syndicales développent des revendications réactionnaires qui réclament la mise en œuvre de ce tri social par la mise à l’écart d’un certain nombre d’élèves – les élèves handicapéEs – en raison de leur écart à la norme, en réclamant le développement des Itep et des Ime.
Cette ségrégation scolaire est pourtant manifeste en France pour les élèves en situation de handicap à la lecture du rapport de la cour des comptes sur l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap de 2024. On y apprend qu’à la fin de l’âge de scolarité ordinaire 38,2 % des élèves handicapéEs sont par exemple orientéEs vers des structures médico-sociales comme les Itep et les Ime. Cette pratique, qui semble en France indispensable, est une spécificité française condamnée par l’ONU parce que contraire aux droits humains et parce que ces espaces sont définis comme des espaces de ségrégation, de discrimination et de privation de liberté.
Comment expliquer ce traitement spécifique des minorités handicapées par les syndicats de l’Éducation nationale ? Pourquoi, pour les élèves handicapéEs – comme pour les adultes par ailleurs – les revendications de justice sociale ne sont-elles pas portées par les organisations syndicales ?
La lutte contre le validisme dans l’Éducation nationale, contre l’inaccessibilité de l’école française et contre la mise à l’écart des élèves en situation de handicap s’inscrit pourtant au cœur d’un nombre important de luttes menées par les syndicats progressistes. Nous le rappelons avec force : si nous nous battons pour une école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice, alors nous devons nous engager contre le validisme et l’institutionnalisation des personnes handicapées en général et des élèves handicapéEs en particulier.
Nous affirmons qu’il n’y a pas d’enfant inadaptéE à l’école mais que c’est l’école qui est inadaptée à l’accueil de touTEs.
Antisexistes, antiracistes, anticlassistes et antivalidistes, jamais l’exclusion d’élèves en raison de leur appartenance à une minorité dominée ne pourra être notre réponse. En tant que travailleurEUSEs de l’éducation nationale, et en tant que militantEs, nous avons à développer des réflexions, à définir une posture syndicale et des revendications sur le thème du handicap en accord avec les principes d’égalité et d’émancipation.
L’enjeu de cet article est de mettre en lumière un certain nombre de pièges politiques dans lesquels tombent si souvent nos collègues et des camarades en allant trop vite en besogne et en ne prenant pas la question de la discrimination comme point de départ.
Il est d’abord essentiel de conscientiser que le validisme et le classisme entretiennent des liens très étroits. Un nombre très important d’élèves sont excluEs du système scolaire ordinaire en raison de leur origine sociale. Dit autrement, plus les élèves sont issuEs des classes sociales favoriséEs, plus ils et elles sont maintenuEs en classe ordinaire ; plus les élèves sont issuEs des classes sociales défavorisées, plus ils et elles sont renvoyéEs dans des espaces de ségrégation.
Ce document emprunté au site Fractures scolaires est à ce propos très éclairant.
On y apprend qu’en 3ème, les enfants handicapéEs issues des classes sociales très favorisées sont entre 60 % et 70 % dans des classes ordinaires (avec ou sans maintien) lorsque moins d’unE élève sur deux issuE des classes sociales défavorisées y a droit. On y voit très explicitement que les élèves handicapéEs issuEs des classes sociales défavorisées sont massivement envoyéEs dans d’autres espaces.
Un nombre important d’élèves soutenuEs par les dispositifs Ulis – qui en réalité fonctionnent encore largement comme des classes spécialisées regroupant des élèves handicapéEs qui n’en sortent que très rarement – ou envoyéEs dans les ESMS (Itep, Ime) ont pour principal handicap celui d’avoir une origine sociale populaire. L’injustice sociale, la précarité, se double d’une injustice scolaire, la ségrégation. L’école écarte ainsi celles et ceux qui ne partagent pas sa culture. Combien d’élèves pauvres et très pauvres sont ainsi désignéEs comme élèves handicapéEs à l’école ? Ce graphique parle de lui-même.
Par ailleurs, combien de travailleurEUSEs de l’Éducation nationale partagent des représentations pauvrophobes et handiphobes ? Combien sont-ils et elles à les lier dans une même approche mêlée d’aversion, de mépris voire de répulsion ou de dégoût ? Combien de fois avez-vous entendu des collègues parler de « cassos » pour désigner unE élève victime de la précarité faisant ainsi preuve, sans que cela ne froisse grand monde, d’une véritable discrimination sociale ? Combien de fois avez-vous vu des collègues imiter des élèves en grande difficulté ou en situation de handicap pour faire rire ? Il s’agit de l’affirmer ici, nos professions sont pétries de stéréotypes et de représentations de ce que doivent être des élèves de tel ou tel âge, de ce que devrait être notre travail d’enseignantE, d’AESH, de CPE, … Pour qu’une école pour touTEs éclose, il est nécessaire de conscientiser que, si des moyens plus importants sont absolument nécessaires, ils ne suffiront pas. Il faudra déconstruire le validisme, le classisme et le mythe méritocratique.
Lutter pour une école pour touTEs, c’est lutter contre une école classiste. Revendiquer la mise à l’écart des élèves handicapéEs, c’est se positionner pour une école de la bourgeoisie et du tri social.
L’école française est l’école d’une société capitaliste. Depuis la Stratégie de Lisbonne, qui devait faire de l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde », l’éducation est explicitement subordonnée au marché du travail. Les politiques éducatives sont définies à partir des besoins de l’économie et l’impératif de l’employabilité dans le cadre d’un marché du travail flexibilisé. L’école conçue comme un levier de la compétitivité économique doit offrir un retour sur investissement, c’est-à-dire que les dépenses éducatives ne se justifient que par leurs rendements. C’est pour cette raison qu’elle valorise, chez ses élèves, la performance, la productivité et la compétitivité. Il est assez simple de voir de quelle manière une telle école exclut par-là un nombre important de ses élèves, dont les élèves handicapéEs.
La mise à l’écart des élèves handicapéEs s’opère souvent à partir de la notion de productivité. Qui est trop lent, qui n’a pas le niveau, qui est en retard, qui a besoin d’aide ou qui ne peut pas faire doit partir.
Si nous luttons pour une autre école et une autre société, à savoir une école débarrassée des injonctions néolibérales de compétitivité et de productivité, et de l’évaluation permanente, il faut le faire pleinement. Ce sont ces injonctions qui écartent les élèves éloignéEs de la norme scolaire (élèves allophones, handicapéEs, à besoins éducatifs particuliers…). Malgré les discours et les rustines, l’école capitaliste, c’est l’école du « marche ou crève », expression validiste s’il en est.
Lutter pour une école pour touTEs, c’est lutter contre une école capitaliste. Accepter de trier nos élèves en fonction de logiques de productivité, n’est-ce pas tourner le dos à nos revendications d’école émancipatrice et souscrire aux principes d’une école capitaliste ?
L’école française est le lieu d’une très grande normativité. Les injonctions auxquelles nos élèves doivent se soumettre sont nombreuses. En règle générale, on se met en rang, on se tait et on obéit ; rien ne doit dépasser. Ce qui n’est pas conforme y est suspect. La place de celles et ceux qui ne se soumettent pas à l’ordre dominant est remise en question.
Cet ordre des choses exclut de fait de nombreuXses élèves. Plus le cadre est normatif et plus il bannit. Notre école intime aux élèves présentant un écart à la norme de manière générale – élèves allophones, en grande difficulté, trans, pauvres, voyageuRses… – et aux élèves handicapéEs en particulier de se conformer à ces normes.
Les pédagogies émancipatrices constituent d’ailleurs toujours un lieu de bataille politique et il suffit de penser simplement, dans le 1er degré, à l’uniformisation pédagogique par la labellisation des manuels scolaires pour comprendre à quel point l’institution cherche à uniformiser les pratiques enseignantes et à mettre à mal les professionnelLEs qui n’obéissent pas à ces injonctions.
Concernant les élèves handicapéEs, on identifie aisément quelles normes sont à l’œuvre pour les exclure. La bienséance, le silence et l’immobilité sont encore très souvent la règle. UnE élève doit suivre les programmes de sa classe d’âge, de sa cohorte (terme issu du langage militaire).
Ce jeu des normes participe à la construction d’une vision binaire du monde social. Il y a celles et ceux qui sont conformes à ces normes et qui sont chez elles et eux à l’école, et il y a celles et ceux qui ne correspondent pas à ces normes. Comme dans tous les autres systèmes oppressifs, il y a une binarisation qui oppose les personnes handicapées et les personnes valides, qui les sépare. Cette binarisation nie tout continuum : on est soit valide, soit handicapéE. Autrement dit, dans le système validiste, être handicapéE exclut de la validité, et vice versa. Cette binarisation instaure une hiérarchie qui est la base de tout le système validiste, dans lequel la vie des personnes handicapées a moins de valeur que celle des personnes valides.
Lutter pour une école pour touTEs, c’est donc lutter contre une école de la norme, du conforme, contre une école qui entretient les violences et les oppressions dont la norme, toujours dictée par les groupes dominants, est la loi. Ne pas le faire, c’est accepter les discriminations à l’école et s’asseoir sur nos revendications de justice sociale.
SUD éducation se bat au quotidien pour une école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice.
Pour SUD éducation, l’École et l’Université ne sont pas déconnectées du reste de la société. C’est pourquoi avec l’Union syndicale Solidaires, SUD éducation porte des revendications pour transformer la société dans son ensemble.
Alors, camarades, allons‑y !
6 - La parole aux travailleur·ses
SUD éducation donne ici la parole à des travailleuses et travailleurs militant·es qui nous parlent de leur rapport au métier, de leurs conditions de travail, de leurs constats et interrogations sur la réalité au quotidien de ce qu’ils et elles vivent dans le cadre de l’accueil et de l’accompagnement des élèves handicapé·es à l’école.
Il s’agit de témoignages personnels, d’une parole libre que nous avons souhaité publier ici.
Je suis devenu AESH il y a quatre mois à peine. Pourtant je sais déjà que je ne continuerai pas ce métier l’année prochaine. Et ce n’est même pas la faute de la rémunération insuffisante : c’est bien le rôle qu’on m’a attribué qui me pose problème. Je précise, avant toute chose, que je n’exprime que mon petit point de vue sur ce métier dont je sais que la nature peut varier en fonction de l’établissement, du type d’accompagnement, du degré, des handicaps concernés, des collègues etc. Je suppose simplement, sans en être certain, que d’autres s’y reconnaîtront.
Ce qu’on me demande de faire, essentiellement, c’est de m’asseoir à côté des élèves que j’accompagne en cours. Mais est-ce que ce n’est pas intrusif, dans leur vie d’enfant ou d’adolescent·e, d’être sans cesse sous la surveillance rapprochée d’un·e AESH ? Est-ce qu’ils·elles ne préfèreraient pas s’asseoir à côté de leurs copains et copines ? Est-ce que le fait qu’on leur assigne personnellement et ostensiblement l’assistance d’un·e adulte ne risque pas d’être stigmatisant, par rapport aux camarades de classe qui ne sont pas forcément au clair sur ce que recouvre le terme “handicap”, par rapport aux profs qui ne le sont pas forcément plus, et puis par rapport à elles·eux-mêmes qui ont souvent déjà des manques de confiance en soi ? Toutes ces questions importantes, j’ai l’impression que personne ne se les pose. On est déjà bien gentil de leur accorder un accompagnement particulier, on ne va quand même pas EN PLUS se soucier de la façon dont ils·elles le reçoivent !
Bien sûr je ne dis pas que la présence proximale de l’AESH pose un problème à tou·tes les élèves que nous accompagnons, il y en a qui en sont sans doute très content·es et c’est tant mieux. Mais je dis qu’on ne devrait pas considérer comme allant de soi que notre présence les aide plus qu’elle ne les gêne. Une aide n’en est d’ailleurs pas vraiment une si elle n’est pas pleinement acceptée par son bénéficiaire. Et pourtant, ce sont ses parents et non l’élève lui·elle-même qui ont le dernier mot sur la poursuite de l’accompagnement par un·e AESH.
Surtout, j’ai l’impression que l’AESH représente le gage de bonne volonté permettant au système scolaire pensé par et pour des valides de ne surtout pas se remettre radicalement en question dans son fonctionnement général et dans ses intangibles principes pédagogiques. Par exemple, on peut continuer les cours magistraux qui consistent à dicter ou faire copier de longs paragraphes sur le cahier de cours en gardant l’auditoire silencieux et bien assis sur sa chaise, bien que ce soit difficile pour les élèves TDAH, fatiguant pour les élèves dyslexiques (et ennuyant pour tout le monde) : tout est pardonné, il y a un·e AESH !
Je dis souvent que mon métier, c’est de mettre du lubrifiant pour faire passer des ronds dans des trous carrés, alors qu’il suffirait tout simplement d’arrêter de mettre des trous. La fonction de l’AESH est entièrement centrée sur l’individu porteur du handicap (d’ailleurs, son avis pédagogique sur l’organisation de la classe ne compte pas) : cela découle d’une logique de compensation, à distinguer d’une logique d’inclusion qui nécessite de voir aussi le handicap d’un point de vue collectif.
Imaginons une école où on laisse aux élèves une plus grande liberté de mouvement, de rythme d’apprentissage, où on favorise davantage l’entraide entre les élèves : n’y aurait-t-il pas déjà beaucoup moins de handicap ? Peut-être que dans cette école, on aurait quand même besoin d’un·e adulte dont le rôle est d’apporter une aide supplémentaire à celles·ceux qui en expriment ponctuellement ou durablement le besoin, mais ce serait déjà bien autre chose.
J’ai été AESH (AVS à l’époque) pendant les années scolaires 2020 – 2021 et 2021 – 2022. J’ai commencé ma prise de poste en plein confinement (le premier). J’ai donc effectué ma formation d’adaptation à l’emploi, d’une durée minimale de 60 heures, à distance pendant cette période.
Année scolaire 2020 – 2021
Lors de ma première année, j’avais la responsabilité de deux enfants en primaire (CP et CM2) présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages.
Concernant mon intégration dans l’établissement, je n’ai à aucun moment été présentée aux professeur·es des écoles ni aux enseignant·es spécifiques des enfants dont j’avais la charge. Mon seul contact initial a été un entretien avec le directeur, pour régler les formalités administratives liées à mon embauche (procès-verbal d’installation, PVI).
Un tiers des AESH employé·es dans cet établissement étaient en arrêt maladie. J’ai donc pris mon poste « à l’aveugle », en m’adaptant aux consignes des professeur·es des classes où se trouvaient les élèves en situation de handicap.
En tant qu’AESH, nous étions censé·es avoir un·e référent·e. Cependant, je ne l’ai jamais rencontré·e. Pour comprendre mes droits et mes devoirs, j’ai eu la chance de participer à une formation syndicale organisée par Sud Éducation. À l’issue de cette formation, j’ai enfin obtenu des informations précieuses sur mon poste et j’ai pu échanger avec d’autres AESH d’autres établissements. Impressionnée par l’écoute et le professionnalisme des intervenantes, j’ai choisi d’adhérer à Sud Éducation, bien que ce soit ma première expérience syndicale.
Concernant les enfants que j’accompagnais, j’ai rapidement remarqué qu’ils·elles ressentaient un certain malaise lié à ma présence, qui les stigmatisait auprès de leurs camarades. De plus, ils·elles avaient tendance à confondre mon rôle d’accompagnant·e avec celui de « faire à leur place ». Il a fallu régulièrement leur réexpliquer mon rôle, ce qui était un sujet récurrent et sensible entre nous.
Quant aux professeur·es, j’ai été choquée de constater qu’aucune adaptation pédagogique n’était mise en place pour répondre aux besoins des élèves. Lorsque je proposais des idées pour adapter leurs exercices, on me rappelait systématiquement que je n’étais pas enseignante. Mon âge, 50 ans à l’époque, semblait parfois susciter une méfiance de leur part.
Année scolaire 2021 – 2022
Pour ma deuxième année, j’ai accompagné deux enfants en maternelle présentant des troubles du spectre autistique (TSA). Ces enfants, attachants mais nécessitant une attention constante, manifestaient des troubles de la communication, des interactions sociales, ainsi que des comportements répétitifs, colériques ou agressifs.
N’ayant jamais travaillé avec des enfants autistes auparavant, j’ai dû apprendre sur le terrain, sans accompagnement ni formation spécifique. Là encore, j’ai constaté que les enseignant·es attendaient des enfants qu’ils·elles s’adaptent au fonctionnement classique de la classe, plutôt que d’adapter leur pédagogie à leurs besoins particuliers.
Mon rôle s’est souvent résumé à contenir les enfants pour éviter qu’ils·elles ne perturbent la classe, ce qui signifiait régulièrement les sortir. Les activités ordinaires étaient quasi impossibles pour elles et eux dans leurs situations. Cela m’a frustrée profondément.
De plus, les moyens matériels manquaient cruellement : pas de trampoline, pas de jeux adaptés (toboggans, balançoires, ballons sauteurs, etc.). Dans la cour de récréation, je devais constamment interdire aux enfants d’utiliser une aire de jeux devenue dangereuse, bien qu’on nous ait promis sa réhabilitation depuis plus d’un an.
Un constat amer
Après deux ans, j’ai décidé de démissionner, fatiguée par le manque de moyens pour les enfants, l’absence de reconnaissance (concernant le statut précaire et le salaire) et d’accompagnement pour les AESH, et une inclusion qui, malgré son importance, s’avère souvent mal pensée et mal exécutée.
J’ai quitté ce poste avec tristesse, sans pouvoir expliquer les véritables raisons de ma décision aux parents, de peur de pointer du doigt l’Éducation nationale et son système d’inclusion dysfonctionnel.
Sur l’inclusion scolaire
Je reste convaincue que l’inclusion est essentielle pour ces enfants et leurs familles. Mais, sans formation adaptée ni moyens suffisants pour les professeur·es, les ATSEM et les AESH, elle devient une violence pour les enfants comme pour les accompagnant·es.
Conclusion
Malgré ces constats, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes motivées et compétentes, profondément investies dans leur rôle auprès des enfants. Leur engagement m’a souvent donné l’énergie nécessaire pour continuer dans ce contexte difficile.
Cependant, ce système hiérarchique, rigide et insuffisamment structuré, crée des blocages qui freinent à la fois les initiatives individuelles et les avancées collectives nécessaires à une inclusion réussie.
Malgré tout, je garde la satisfaction d’avoir contribué, à ma manière, à ce que ces enfants puissent vivre, apprendre et évoluer au sein de leur groupe de pairs. Ces moments de partage et de progrès, aussi infimes soient-ils parfois, restent précieux dans mon parcours.
D’abord AVS en contrat d’insertion, payée 650 euros pour 20h, j’ai été recrutée pour mes compétences en biologie pour accompagner un élève au baccalauréat STL (techniques de laboratoires) et mes compétences de travailleuse sociale. Puis 3 ou 4 CDD. Je suis aujourd’hui AESH en CDI 24h payée 1000 euros net, mais 900 euros seulement sont versés car j’ai une dette à cause d’un long arrêt maladie.
J’aime beaucoup accompagner les élèves, les voir devenir autonome, permettre aux enfants handicapés d’obtenir des diplômes, mais je suis souvent inquiète pour leur insertion professionnelle. L’idée d’inclusion de toutes et tous a toujours été logique pour moi, ça devrait être la normalité.
J’aime le travail en équipe, les professeurs sont maintenant des vrais partenaires de travail, ce n’était pas le cas au début car les AESH ont été ajoutées dans les classes comme des cheveux dans la soupe ! Ça arrive encore mais moins souvent.…
Je ne considère pas que le métier d’AESH existe, j’aimerai bien, mais il n’existe pas de formation diplômante pour cette fonction. j’occupe une fonction.… Je suis travailleuse sociale, je ne suis pas aide soignante ni AMP donc je refuse les gestes paramédicaux (prise de médoc, transfert aux toilettes, aide aux repas..) mon boulot c’est faciliter l’accès aux apprentissages.
Quand on bosse dans le secteur public, on se prend des nouvelles lois dans la tronche qui change notre boulot, et l’administration attend qu’on se la ferme et qu’on exécute.
Pas d’augmentation de salaire en vue, pas de reconnaissance du métier en vue. Va y avoir les PAS à la place des PIAL, y a toujours un tas d’abréviations pas claires : TDAH, Dys, TDA, Tmachin, c’est comme ça que l’administration parle de nos élèves dans les formations.
J’ai souvent pensé à changer de boulot à cause de ce petit salaire, mais finalement j’ai appris à mobiliser les aides sociales en complément (droits et/ou aides facultatives). Mais ma retraite ce sera la cata !
C’est sûr je continuerai à faire mon boulot, c’est à dire favoriser l’inclusion et l’autonomie de tout‧e‧s. C’est sûr je continuerai à ne pas me laisser faire, être AESH c’est aussi et surtout savoir prendre du recul et lutter pour nos conditions de travail.
Parachutée un peu par hasard dans le milieu éducatif, me voilà AESH, sans formation ni expérience, j’ai juste reçu une affectation. Au début j’observe, j’interroge, je cherche à comprendre mes missions et les fonctionnement de cette nouvelle institution. Mais celui-ci va vite s’imposer à moi, les changements d’accompagnement s’enchaînent, de la maternelle au collège avec des élèves aux besoins différents. Une remise en question permanente de mes pratiques avec pour seule ressource la volonté de m’auto-former, d’élargir mes compétences. On explique souvent que les AESH restent car ça devient un métier « passion », pour moi c’est plutôt devenu un métier « combat ». Un combat social, face au mépris et à la précarité quotidienne subie. Faire ses preuves, être évaluée en permanence pour les renouvellements de contrat, pour faire sa place dans chaque nouvel établissement. Un combat sociétal, pour une école inclusive, avec des moyens humains et matériels pour toutes et tous les élèves. Mais surtout un combat hyper enrichissant, une découverte incroyable des esprits, des corps, des cultures différentes.
Après 10 ans, ce combat s’est transformé en force, pour revendiquer des compétences spécifiques et un statut , pour construire des liens avec les élèves, qu’iels puissent être au cœur de leur accompagnement, des liens avec les équipes enseignantes. Je me vois comme le fil qui relie les envies et besoins de l’élèves, la vie scolaire et les apprentissages. Je m’autorise même à rêver, une école où dans chaque classe un binôme enseignant‧te et éducateur‧trice scolaire spécialisé‧e pourrait accueillir les élèves dans un petit groupe classe, dans des locaux adaptés, accessibles.
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle A. Je suis professeur des écoles. Je suis issue des classes populaires.
Depuis 6 ans je travaille dans une école de 9 classes dans une ville moyenne d’un département rural qui accueille un public avec une grande mixité sociale. J’enseigne dans le cycle 2 exclusivement (CP/CE1 ou CE1) depuis que je travaille dans cette école. Je suis militante à Sud éducation.
J’accueille dans ma classe une grande diversité d’élèves : élèves voyageur·euses, allophones, sans papier avec des trajectoires parfois difficiles, des élèves en situation de handicap, des élèves avec des difficultés – beaucoup de troubles du comportement et de difficultés langagières. Sans caricaturer, ce qui est très marquant, c’est surtout le fossé entre les élèves issu·es des classes favorisées – beaucoup d’enfants de professeur·es, de travailleur·euses de la culture ou du monde associatif, beaucoup d’enfants de soignant·es – et celles·ceux issu·es des classes populaires.
C’est quoi une école inclusive pour toi ?
Une école inclusive serait une école qui se passerait du mot « inclusive » c’est à dire une école pour tou·tes, une école qui accueillerait sans condition tou·tes les élèves, toutes les familles, sans discrimination mais sans non plus nier les singularités de chacun·es, une école qui ferait sa place à tout le monde en respectant les besoins de tou·tes, une école qui travaillerait à l’accessibilité universelle, une école bienveillante et conscientisée des différentes oppressions vécues dans la société, une école qui ne reproduirait pas les violences vécues dans la société.
Ce serait aussi une école respectueuse de ses travailleur·euses, y compris celles et ceux qui, un jour dans leur carrière, éprouvent des difficultés, physiques ou psychiques.
En ce sens, politiquement, une école réellement inclusive serait pour moi une école qui accueillerait tout simplement tout le monde, inconditionnellement et dans de bonnes conditions. Elle ne s’intéresserait pas seulement aux élèves en situation de handicap. Elle serait nécessairement antisexiste, antiraciste, anticlassiste, antivalidiste…
C’est une école qui ne permettrait pas le tri social en proposant des espaces alternatifs : école privée pour la bourgeoisie, espaces ségrégués pour les élèves handicapé·es…
Quelles difficultés rencontres-tu dans la mise en œuvre d’une école inclusive ? Quels sont les freins ? Quels pourraient être les leviers ?
Les difficultés sont nombreuses.
Les premières concernent le manque de moyens. Le nombre important d’élèves par classe est une difficulté que je rencontre, notamment après des mesures de fermetures de classes dans l’école.
Le territoire sur lequel interviennent les membres du RASED de mon école est extrêmement large tout comme celui de la collègue UPE2A, ce qui ne permet presque plus de pouvoir nous rencontrer pour qu’on puisse travailler ensemble.
Les moyens matériels insuffisants sont également un frein selon moi. Les territoires sont dotés inégalement en termes de qualité de locaux (taille des espaces, circulation, sanitaires, luminosité, insonorisation…). Je travaille avec du mobilier qui n’est pas adapté, des bureaux trop vieux et inadaptés à la taille des élèves. Ils prennent de la place, grincent, les plaquages sautent, ils rendent difficile la modulation de l’espace… La mairie avec laquelle je travaille n’investit que trop peu en matériel : matériel informatique, casques anti bruit, assises alternatives, photocopieurs datés qui ne sortent que des impressions dégueulasses, exclusivement en noir et blanc, gênant la lecture pour les élèves les plus en difficulté…
L’espace de ma classe est insuffisant pour créer un sas de décompression pour les élèves qui en auraient besoin.
La circulation dans la classe n’est pas aisée, la visibilité des affichages et du tableau n’est pas optimale pour tout le groupe. Les bâtiments datent de la fin du XIXème siècle, les plafonds sont très hauts et les sons résonnent, gênant les élèves qui ont besoin de beaucoup de calme.
Les moyens concernent également les temps de concertation. Les temps de concertation avec l’ensemble de mes collègues, PE ou AESH, sont absolument nécessaires pour mettre en œuvre une école vraiment inclusive. Je travaille actuellement, par exemple, avec deux collègues AESH qui accompagnent une élève de ma classe mais qui travaillent également auprès de quatre autres élèves, scolarisé·es dans l’école ou ailleurs. Ces personnes travaillent également à accompagner les élèves sur les temps périscolaires. Les temps de concertation sont impossibles à mettre en œuvre. Pour coopérer, les discussions entre deux portes ne sont pas satisfaisantes. S’il y avait une réelle volonté politique de mettre en œuvre une école pour tou·tes, ces temps de concertation seraient organisés sur nos temps de travail, ce qui impliquerait un nombre de travailleur·euses de l’Éducation nationale beaucoup plus important. Cette hausse des personnels permettrait aussi d’avoir du temps pour travailler en équipe (enseignant·es, AESH, CPE, AED, partenaires divers…) sur des temps de classe à la construction d’outils et de projets qui favorisent l’accessibilité. La hausse du nombre d’enseignant·es permettrait en plus de mettre en œuvre d’autres modalités d’enseignement comme le co-enseignement.
Parler de moyens, c’est également parler de formation. Il faut évidemment que les collègues s’en saisissent, notamment en ce qui concerne la formation continue, mais les formations initiales devraient former à l’accessibilité universelle. Dans l’idée, tou·tes les enseignant·es devraient être des enseignant·es spécialisé·es. J’ai presque envie de dire que, contrairement à ce que disent certains syndicats, l’inclusion doit être systématique, en ce sens que c’est ça qui doit faire système, pas la mise à l’écart d’élèves qui ne correspondent pas à l’image d’Épinal de l’élève comme il faut. Il faut conscientiser que l’école est orientée politiquement ; il ne peut pas y avoir d’école pour tou·tes dans une école néolibérale qui ne valorise que la compétitivité et la productivité, le silence et l’obéissance.
Les collègues doivent aussi se former à la sociologie, c’est-à-dire aux rapports de domination, aux déterminismes sociaux que nous sommes censé·es combattre.
Il faut donc remettre en question les programmes, l’organisation de l’école, les questions de rythmes… Il faut aussi très certainement casser la seule réponse d’une présence AESH auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les pratiques enseignantes sont centrales.
Je mets par exemple en œuvre la classe du et au dehors, des pédagogies de projets autour d’une pratique de la radio. Je ne sais pas tout, c’est parfois complètement expérimental, j’essaie des choses, mais je mesure l’intérêt pour l’accueil de tou·tes les élèves. Et l’idée, ce n’est pas d’être moins exigeant·e, de faire quelque chose de plus socialisant, qui apporterait moins de savoir. Les pédagogies émancipatrices constituent, je crois, une véritable réponse à un accueil adapté de tou·tes les élèves. Les principes mêmes des pédagogies émancipatrices mettent l’enfant au centre et croient en lui·elle.
Il y a aussi la question des familles. C’est incroyable que des collègues pensent les familles comme des adversaires. La violence, elle est exercée par l’institution, pas par les familles. On a tout intérêt à travailler avec elles car nos intérêts sont convergents. Il est inadmissible de faire ruisseler la violence institutionnelle sur les familles et les enfants. Nos combats doivent être pour une autre école et une autre société, plus égalitaires, plus émancipatrices.
De ce point de vue, l’utilisation massive des médicaments pour adapter les élèves à l’école m’interroge et je l’envisage comme une camisole chimique. Que faisons-nous subir à leurs corps et leurs esprits ? Quels impacts sur leurs vies futures ?
Les liens avec les travailleur·euses du médico-social sont également essentiels. J’ai par exemple accueilli une élève malvoyante. Le Seerda est intervenu de manière très régulière pour que nous co-construisions un accueil adapté de cette élève. Ils et elles travaillaient avec moi mais également avec l’AESH de l’élève. Ils et elles nous apportaient énormément de conseils mais également du matériel adapté. J’ai beaucoup appris et l’élève en question a pu progresser et s ‘épanouir dans un environnement qui ne faisait plus obstacle. J’ai eu beaucoup moins d’aide pour accueillir des élèves pour lesquel·les l’organisation de la classe et ses exigences généraient des difficultés et de la violence, et qui ne pouvaient l’exprimer qu’en étant violent·es eux·elles-mêmes.
Le dernier point, c’est le manque de continuité et de coopération entre la maternelle et l’élémentaire, puis entre l’élémentaire et le second degré. Si on veut accueillir correctement toute la diversité des élèves, cette coopération me semble tellement importante.
En tous cas, cette école pour tou·tes, contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là, je l’appelle de mes vœux. Je ne le vis pas comme une injonction hiérarchique. C’est pour moi une question de droit et je me bats syndicalement pour l’obtenir.
Je milite à SUD éducation depuis une quinzaine d’années, c’est-à-dire depuis que je travaille. Je milite également au Cuse (collectif une seule école).
J’ai commencé à travailler dans l’enseignement spécialisé il y a une dizaine d’années, d’abord en Clis, puis en Ulis. J’ai fait fonction pendant 8 ans et j’ai passé le Cappei il y a trois ans.
Je travaille dans le cadre d’un double dispositif Ulis, c’est-à-dire qu’avec une autre coordonnatrice Ulis et deux AESH collectives nous soutenons 24 élèves.
Je préfère parler d’école pour tou·tes que d’école inclusive. L’expression école inclusive porte en elle-même l’idée d’un corps étranger à qui on doit faire place. Je préfère penser que nous sommes tous et toutes singulier·ères et que l’école doit partir de ces singularités pour permettre à tou·tes d’apprendre et de s’émanciper, de s’épanouir.
Je m’engage dans mon travail pour l’émancipation de tou·tes et la justice sociale ; je m’oppose radicalement à l’école capitaliste et néolibérale. Mes choix professionnels sont guidés par les principes d’égale dignité des personnes et d’éducabilité de tou·tes.
La conscientisation du validisme constitue un moment très important de ma courte carrière. En travaillant sur la première brochure fédérale de SUD éducation, la rencontre avec des militant·es du Clhee a instauré une toute autre manière d’envisager mon métier et de le pratiquer. La prise de conscience des oppressions subies par les personnes handicapées en général et les élèves handicapé·es en particulier a bouleversé mes représentations. J’ai compris que la manière dont nous envisagions les élèves handicapé·es en France était contraire aux Droits de l’Homme. Je m’engage donc désormais pleinement pour la désinstitutionnalisation et contre toute forme de ségrégation.
Une école réellement pour tou·tes reste à inventer. Il s’agirait d’une école qui permettrait à tous et à toutes d’y être scolarisé·es ou d’y travailler en ne compensant qu’à la marge parce que sa structure même – architecture, liens médico-social et éducation, programmes, nombre d’élèves par classe, … – offrirait un environnement universellement accessible.
Les freins sont encore nombreux cependant et empêchent encore l’éclosion d’une telle école.
Il y a évidemment l’orientation néolibérale de notre école qui met au banc un nombre important de nos élèves en ne valorisant que la productivité et la compétitivité, en ne se préoccupant que des résultats aux évaluations et en réduisant toujours davantage les moyens dans une obsession austéritaire.
Mais il y a également nos représentations de ce que devrait être un·e élève, de ce à quoi devrait ressembler une classe et nos emplois de travailleur·euses de l’éducation. Un important travail de déconstruction est à engager en nous-mêmes pour sortir du modèle médical du handicap – qui est la base du validisme systémique – et pour mettre en œuvre une école de l’émancipation.
De ce point de vue, un des principaux freins à mes yeux concerne la place centrale donnée aux enseignant·es spécialisé·es et aux AESH dans la gestion des handicaps à l’école. Il y a quelque chose de l’ordre de la délégation. Si les élèves à besoins éducatifs particuliers sont majoritairement considéré·es comme les élèves des enseignant·es spécialisé·es et des AESH, si ce sont ces travailleur·euses qui sont leurs principaux·ales référent·es, alors c’est que les élèves à besoins éducatifs particuliers échappent au commun ; c’est qu’ils·elles ne font pas pleinement partie du groupe des élèves. Une école pour tou·tes, c’est certainement une école dans laquelle tou·tes les élèves sont de la responsabilité de toute l’équipe éducative.
J’essaie quotidiennement, avec mes collègues, d’avancer vers une école pour tou·tes. Parmi toutes les choses que nous essayons de mettre en œuvre, voici celles qui me semblent les plus intéressantes.
D’abord, le co-enseignement. J’ai la chance de travailler dans un double dispositif, ce qui nous permet, avec ma collègue coordonnatrice, de multiplier les co-enseignements. Nous travaillons collectivement à l’école pour l’accessibilisation de nos séquences d’apprentissage. Les enseignant·es spécialisé·es ne sont plus les seul·es habilité·es à travailler pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. C’est désormais une responsabilité partagée avec l’ensemble de l’équipe. Nous développons également des pratiques de coopération avec nos collègues AESH. Ces pratiques réclament cependant du temps de concertation, ce temps si difficile à trouver.
Les pédagogies émancipatrices offrent également des leviers intéressants pour le développement d’une école pour tou·tes. Elles sont nombreuses et l’idée n’est pas ici d’en faire une description détaillée, mais, par la place centrale qu’elles donnent toutes à l’enfant – comme personne de droits, comme étant capable, comme étant acteur·trice…- et par leur projet émancipateur, elles offrent des perspectives plus qu’intéressantes. Une école pour tou·tes, c’est une autre école dans une autre société ; les pratiques « IIIème République » n’y seront d’aucun secours.
Je ne peux pas distinguer, pour conclure, mon engagement syndical de mon action de pédagogue. Pour obtenir cette école de l’émancipation et de la justice sociale, l’un ne s’envisage pas sans l’autre.
Je me présente :
Je suis enseignante depuis 17 ans. J’ai passé 11 ans en école ordinaire et j’entame cette année ma 6ème année en tant qu’enseignante spécialisée en IME. J’ai passé mon Cappei en 2022.
Qu’est-ce qu’un IME ?
Un IME est un institut médico-éducatif. C’est un établissement du secteur médico-social dans lequel on accueille des enfants et adolescent·es considéré·es comme « atteint·es de handicap mental, ou présentant une déficience intellectuelle liée à des troubles de la personnalité, de la communication ou des troubles moteurs ou sensoriels. » (Définition de la MDPH).
Il existe des IME qui ne font que de l’accueil de jour ou des IME qui ont des internats. La majorité des IME en France sont des structures privées associatives, que l’on appelle communément « associations gestionnaires ». Les dernières statistiques disponibles que l’on peut retrouver sur le site du ministère de la Santé indiquent qu’il existe 1368 IME en France. Ils accueillent plus de 70000 enfants et adolescent·es.
La CNSA attribue aux ARS un budget annuel d’environ 30 milliards d’euros en 2023 pour les établissements médico-sociaux (environ 15 milliards € pour les personnes âgées et 15 milliards € pour les personnes handicapées).
Qu’est-ce qui m’a amené à travailler en IME ?
Je suis entrée dans l’Éducation nationale en 2006, j’ai donc connu l’arrivée des élèves handicapé·es dans les classes avec les premières accompagnant·es (AVS à l’époque !) des élèves dans les classes dites « ordinaires ». La question de la défense d’un meilleur statut de ces nouveaux personnels a été un de mes premiers combats syndicaux. Il y avait quelque chose d’insupportable pour moi à l’époque : des élèves parmi les plus fragiles et vulnérables les plus déconsidéré·es du système scolaire, exactement comme pour les personnes censées s’occuper d’eux-elles.
Et puis plusieurs de mes proches (famille, ami·es) étaient enseignant·es du premier degré et se sont orienté·es vers l’enseignement spécialisé. J’ai eu beaucoup de récits intéressants à cette époque. Et comme j’avais moi-même un sentiment d’insatisfaction permanent dans la classe dite « ordinaire », surchargée de difficultés structurelles (éducation prioritaire sans moyens suffisants), je voyais dans les ESMS (établissements médico-sociaux) un moyen de faire mieux mon travail, parce que j’aurais moins d’élèves en charge et davantage de professionnel·les différent·es au quotidien.
Quels avantages j’y vois en tant qu’enseignante ?
Alors il faut rappeler que les enseignant·es en ESMS n’ont que très peu d’avantages financiers : indemnité dite « Segpa » de 147€ bruts par mois et, lorsque l’on est enseignant·e spécialisé·e, l’indemnité de fonction de 73€ bruts par mois. Clairement, ce n’est donc pas la rémunération qui m’a amenée à choisir un poste ASH !
Quand j’ai démarré en IME à la rentrée 2019, j’ai eu effectivement une forme de satisfaction de me dire « ça y est, je suis là où je voulais être ». En fait, j’avais enfin la sensation que j’avais le temps d’observer les élèves, leurs réussites, leurs blocages, leurs fonctionnements… J’avais beaucoup de collègues autour de moi avec qui je pouvais parler « autrement » des élèves : l’infirmière, le kiné, la psy, l’éduc référent·e, la psychomotricienne… Bref, plein de professionnel·les dont je découvrais le métier et qui voyaient l’élève-enfant dans sa globalité. C’était très différent des échanges en salle des maitre·sses à l’école élémentaire. Là, j’avais l’impression qu’on pouvait tout dire, ce qui n’est pas toujours le cas à l’école quand on est en difficulté avec un·e élève.
Il y avait également une question de rapport au temps qui fait du bien au quotidien : finie la course au programme, à la période, à la séquence ceci, à la séance cela ! Dans la classe à l’IME, on fait avec les élèves, selon leurs disponibilités et il n’y a pas d’angoisse si la séance de lecture a raté, si on a dû s’arrêter pour chanter une chanson, si on a mis sur pause la résolution de problèmes pour faire un tour dehors et s’aérer un peu. Cette liberté-là, je ne la retrouvais plus à l’école dite « ordinaire », et j’ai eu l’impression de la retrouver à l’IME.
Et puis surtout, il y avait quelque chose de très nouveau pour moi professionnellement, c’est la question globale du rapport aux normes qui a pris une autre dimension dans ma pratique au quotidien. Plus de débat sur la question du « niveau scolaire », de « l’âge ». À l’IME, on arrête avec cette idée du « à 7 ans, la construction du nombre, blablabla… », « à 6 ans, la fusion syllabique, blablabla… ». Non, là, on remet en question toutes les normes qu’on nous a appris à prendre pour des injonctions présentes dans chacun de nos dits « gestes professionnels ». Tout l’enjeu est de maintenir un haut degré d’exigence en termes d’apprentissages pour chacun·e des élèves, mais en respectant les rythmes, les progrès, les centres d’intérêts, les difficultés et les écarts à la norme scolaire ! En tant qu’enseignante, cet aspect-là de mon métier en IME m’a apporté beaucoup. C’est une prise de distance très particulière après 10 ans d’enseignement en classe dite « ordinaire » alors que j’avais pourtant expérimenté les pratiques coopératives, la classe triple niveau en zone d’éducation prioritaire, inspirée des modèles pédagogiques type Freinet/pédagogie institutionnelle. J’avais l’impression d’avoir finalement toujours fait attention aux besoins des élèves, aux besoins du groupe, j’avais cherché, notamment dans la classe multi-âge, à gommer les catégorisations faciles des élèves, de leurs compétences. Mais en me confrontant aux élèves de l’IME, c’est comme si je m’autorisais enfin à ne plus tenter de répondre aux injonctions paradoxales de notre système scolaire. Je prenais enfin complètement en compte les « à côtés » de l’apprentissage à proprement parler : comment l’élève se sent aujourd’hui, qu’est-ce qu’il-elle ramène dans la classe ce matin d’un point de vue sensoriel et/ou émotionnel, quelles sont les interactions, les rituels, les gestes, les mots, les images, qui vont permettre la mise en activité, l’écoute, la concentration, à quel moment il va falloir stopper, couper, faire une pause, lâcher prise…
Mais j’ai bien conscience que si je suis parvenue à prendre conscience de tous ces aspects, et d’adapter mes propositions pédagogiques aux élèves, c’est aussi parce que le contexte d’exercice a été facilitant au sein de la structure IME : effectif réduit (8 élèves maximum dans la classe), présence d’adultes renforcée, apports pluri-professionnels, formations (Cappei entre autres)…
Je décris un peu l’organisation de mon travail à l’IME
Aujourd’hui, je travaille dans un petit IME qui dépend de l’Unapei et qui accueille une cinquantaine d’enfants et d’adolescent·es âgé·es de 6 à 15 ans. Nous sommes 2 enseignant·es titulaires du Cappei sur l’établissement. Nous scolarisons environ 40 élèves (les autres étant soit non scolarisé·es, soit sur d’autres prises en charge scolaires avec Sessad, en Ulis…).
L’IME possède une UEE en école élémentaire dans laquelle nous emmenons 6 élèves sur 5 demi-journées par semaine. Ce groupe bénéficie de 18h de scolarisation par semaine sur l’école élémentaire et à l’IME (1 enseignant·e + 1 éducatrice en permanence sur ce groupe). Pour les autres élèves, nous les prenons en charge sur le site de l’IME, dans une salle de classe dédiée. Les « créneaux scolaires » varient selon les élèves : de 1 à 6 par créneau, de 30 minutes à 3 heures par créneau. Pour résumer, 6 élèves sont scolarisé·es 18h, les 30 autres au maximum 6h15 par semaine.
Mon temps de service est celui d’une PE : 24 heures face élèves + 3 heures hebdomadaires de réunions avec l’équipe pluriprofessionnelle. Les temps de formation continue sont selon les années très inégaux et sont la plupart du temps placés par la circonscription sur le temps de service face élèves puisque les IEN savent que nos 3 heures de réunions hebdomadaires à l’IME sont indispensables au bon fonctionnement du service. Je suis rattachée administrativement à une circonscription ASH et donc à une Inspectrice ASH. Mais j’ai une autorité hiérarchique supplémentaire dite fonctionnelle puisque soumise au règlement intérieur de l’IME dans lequel je travaille.
Quelles sont les limites de la prise en charge en institution spécialisée que tu constates ?
Maintenant que j’ai un peu d’expérience et de recul sur l’IME, et que j’ai commencé à me former aux questions antivalidistes, je me rends compte des nombreux écueils, dysfonctionnements, limites qui me questionnent beaucoup quant à ma place en tant qu’enseignante et militante.
Le mensonge institutionnel
En fait, l’IME n’est plus aujourd’hui une institution globale, totale comme elle avait été imaginée. Certes, les enfants sont accueilli·es de 9h à 16h30 tous les jours (et la moitié des vacances scolaires), mais le manque de moyens et les problèmes de recrutement de personnels ont considérablement dégradé la prise en charge dite « totale ».
Par exemple, dans mon établissement, il y a en moyenne 2 à 3 éducs absent·es par jour (en général 1 remplacé·e par du personnel intérimaire souvent non diplômé). Le poste d’orthophoniste est vacant, la pédo-psychiatre est présente une demi-journée par semaine, la psychologue à 80% mais sur 3 structures de l’association différentes, idem pour l’assistante sociale. Il y a un poste de psychomotricien·ne pourvu par 2 professionnel·les.
En fait, certains enfants/jeunes n’ont pas l’accompagnement nécessaire sur les aspects médicaux et sociaux. Ou bien tout le monde en interne se plaint d’une forme de « saupoudrage » d’accompagnement. C’est une réalité peu connue, y compris par les familles qui ne sont parfois pas informées que leur enfant n’a plus telle ou telle prise en charge car le-la professionnel·le est absent·e et non remplacé·e ou bien que le poste est vacant. En conséquence, on pousse à l’externalisation des soins.
Concernant la scolarisation, la réalité est bien loin de l’affichage qui peut être fait depuis le point de vue de l’école ordinaire. Les temps de scolarisation sont faibles, en moyenne 6 heures par semaine. Et par exemple, dans le précédent IME dans lequel j’ai travaillé, chaque enseignant·e avait une classe de 8 jeunes mais comme nous étions 3, 24 enfants/jeunes étaient scolarisé·es 24 heures par semaine. Par conséquent, plusieurs dizaines d’enfants/jeunes n’avaient tout simplement jamais classe alors qu’ils-elles étaient en âge de la scolarisation obligatoire !
La mascarade de l’ouverture vers le milieu dit « ordinaire »
Dans l’IME dans lequel je travaille, il y a une UEE en école élémentaire. Le projet a été imposé à l’équipe enseignante de l’école élémentaire, sans concertation, juste « parce qu’il y avait des locaux disponibles », c’est ainsi qu’on me l’a raconté. Dans la réalité, il y a une classe qui nous est réservée pour les 6 élèves de l’IME, un·e enseignant·e et l’éducatrice référente. Nous avons mis en place des créneaux de partage d’activité en commun entre élèves de l’IME et élèves des autres classes, 30 minutes par jour. Nous partageons un temps de cantine par semaine et les temps de récréation. C’est beaucoup et si peu à la fois ! L’équipe enseignante est débordée, les créneaux sont régulièrement oubliés, nous peinons à assister aux réunions, conseils d’école, des maître·esses. Les temps festifs de l’école sont posés systématiquement en fonction des familles de l’école, pas celles de l’IME qui de fait, ne connaissent même pas les locaux puisque nous y venons chaque jour en minibus depuis l’IME. Aucun temps de concertation ne nous est donné pour travailler réellement ensemble. Nous ne faisons officiellement pas partie de l’effectif de l’école, ni du côté Éducation nationale, ni du côté mairie.
Entrer en IME, y rester, ne pas en sortir…
Avant de travailler en ESMS, je n’avais pas réalisé à quel point les structures étaient fermées sur elles-mêmes. Enseigner en IME, c’est tous les jours rencontrer un public d’élèves qu’on ne voit pas « ailleurs ». Toutes ces personnes avec des corps et des comportements « en dehors de la norme », on ne les voit pas dans la rue, au resto, à la terrasse d’un café, à un concert… ou de manière si exceptionnelle que c’est alors « remarquable ».
Cet enfermement des enfants et jeunes handicapé·es historiquement construit en France est en fait légitimé par un discours des institutions. La direction du premier IME dans lequel je travaillais était claire sur ce sujet en réunions institutionnelles. En gros, les IME récupèrent les élèves handicapé·es qui ont été cassé·es par l’école ordinaire, donc on ne va pas les y remettre, cela traumatiserait les jeunes et les familles qui ont des expériences douloureuses sur ce sujet. Donc on les garde ! Et ce discours est intériorisé par les professionnel·les qui travaillent en IME et qui, pour beaucoup, ne peuvent que faire le constat d’une école ordinaire qui n’a de toutes façons pas les moyens actuellement de les accueillir.
De ce fait, les « retours » à l’école, les initiatives pour des scolarités partagées aboutissent très rarement, tout le monde se satisfaisant d’avoir « enfin » la place en IME. C’est particulièrement vrai pour les familles qu’on a convaincues que l’institution était la seule possibilité de prise en charge pour leur enfant, la plus adaptée. Enfin, les enfants partent le matin et rentrent le soir à la maison, « comme les autres ». Enfin les mamans peuvent envisager de retrouver du travail, enfin, une institution a dit « oui » pour l’enfant.
Mais en réalité, dans cette bulle désormais si sélective que peut représenter un IME, personne n’en sort. J’ai vu des adultes âgé·es de 35 ans qui étaient arrivé·es dans la structure à l’âge de 8 ans !
La question de « l’après IME » est un tabou extrêmement compliqué dans l’institution spécialisée, pour les professionnel·les, les familles. Il y a en réalité très peu de solutions pour les jeunes et les adultes en IME. D’autres types de structures existent : IMPro, foyers de vie…
Mais les « passations » se font au compte-goutte, souvent dans des conditions imposées aux familles (« une place se libère dans 48h donc untel par demain », c’est ce que je constate régulièrement là où je travaille actuellement). Et lorsque les situations d’enfants, de jeunes sont dégradées, faute d’accompagnements, de soins, de personnels, il n’est pas rare qu’après l’IME, ce soit « retour à la maison ». De ce point de vue, les annonces gouvernementales sont fortes (exemple des « 50000 solutions » annoncées en 2023) mais sur le terrain, il n’en est rien !
Le tri social des institutions
De mon expérience professionnelle depuis 6 ans en IME, le constat d’analyse est sans appel. Dans les IME, les enfants et jeunes qui sont présent·es sont très massivement issu·es de familles monoparentales (absences, ruptures avec le père), provenant de milieux populaires voire extrêmement défavorisés socialement et économiquement, avec une majorité d’enfants racisé·es.
J’ai fait mes petits calculs récemment pour vérifier si statistiquement, on retrouve ces observations faites sur le terrain. Prenons un indicateur, les enfants suivis par l’ASE (aide sociale à l’enfance).
11,4% des enfants d’IME sont pris en charge par l’ASE
4,4% des enfants scolarisés dans le 1er et 2nd degré sont pris en charge par l’ASE
Les données sont sans appel…
Effectivement, là où je travaille, beaucoup d’enfants et d’adolescent·es sont en situations de grande précarité (logement, papiers d’identités, parcours migratoires traumatiques, accès à la santé, maîtrise du français oral et écrit…).
L’analyse que j’en fais pour l’instant c’est que les familles qui ont un capital économique, culturel et scolaire élevé connaissent davantage le système scolaire et ses logiques d’orientation. Elles font davantage de démarches pour maintenir une scolarité dans l’ordinaire le plus possible et ont accès à des prises en charge externalisées (soins médicaux ou paramédicaux, éducateur·trices spécialisé·es à domicile, AESH privées pour l’école…) coûteuses qui permettent d’aider à ce maintien.
Pour les familles n’étant pas dans cette situation, l’IME est la solution « symboliquement » obligatoire.
Le silence assourdissant des personnes concernées
Je ne souhaite pas généraliser ici mon propos car il convient de préciser que les choses avancent sur ce point. Néanmoins, je peux attester que la parole de l’enfant, à l’IME, est peu écoutée, entendue, comprise par les adultes encadrant·es. Je faisais déjà ces constats lorsque je travaillais dans les écoles dites « ordinaires ». Sauf qu’à l’IME, les conséquences du déni des adultes sont souvent bien plus terribles.
Qu’il s’agisse des choix de scolarisation, d’orientation en IME, d’emplois du temps au sein de l’IME… les enfants sont globalement peu consulté·es, particulièrement lorsqu’il y a des difficultés liées au langage.
Par exemple, lorsque des projets sont mis en place à l’IME (sportifs, culturels…), ce sont les adultes qui prennent les décisions quant à la constitution des groupes de participant·es. Certes, les décisions sont prises au regard des objectifs définis dans le projet de l’enfant. Mais dans la réalité, il s’agit souvent d’adapter les contraintes logistiques et RH de l’IME à l’emploi du temps de l’enfant.
L’aspect le plus inacceptable dans ce fonctionnement enfantiste se révèle dans la prise en compte de la parole des enfants lorsqu’ils-elles s’expriment sur des violences intra-familiales et/ou sexuelles subies. J’ai assisté à plusieurs situations d’enfants en danger pour lesquels on a :
- Remis en cause les paroles de l’enfant
- Minimisé la parole de l’enfant
- Refusé de faire un signalement/une information préoccupante
- Tardé à faire un signalement/une information préoccupante
- Finalement pas traité la situation connue par tous·tes les professionnel·les
Certes, la question des violences faites aux enfants concerne tous les milieux dans lesquels évolue un·e enfant (famille, école, loisirs, institutions…). Mais par exemple, « 9 % des femmes handicapées déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles au cours des deux années précédant l’enquête, soit 3,2 points de plus que les femmes non handicapées. À âge et situation comparable, l’écart est de 4,8 points ».
Ou encore « Les femmes en situation de handicap sont au moins deux à trois fois plus susceptibles que les autres femmes de subir des violences, notamment par la famille, les partenaires intimes, les soignants et les établissements institutionnels ».
Ces chiffres sont désormais connus de tous·tes, et en tant que professionnel·les de l’éducation cela doit nous interroger et nous obliger à la prise en compte systématique de la parole de l’enfant en IME comme ailleurs.
Je témoigne ici d’une expérience pédagogique, fondatrice dans mon parcours professionnel, militant et de vie. Je raconte la dynamique réflexive autour du concept d’inclusion dans laquelle m’ont engagée les élèves que j’accompagnais alors. Consciente que du contexte particulier, voire limite, ici évoqué, je n’ai pas la prétention d’une démarche transférable.
Par ce récit, je partage un processus de rencontre avec mes élèves et comment celui-ci est venu bousculer mes représentations, générer un questionnement sur le fondement de mes bonnes intentions pédagogiques et l’orientation du travail prescrit. Génératrice d’inconfort, cette expérience m’a obligée à composer avec le réel et en premier celui d’élèves invisibilisé·es, expert·es de leurs conditions, les mieux placé·es pour nous inviter, éducateur·rices, à co-imaginer des pratiques inclusives plus incarnées.
Pendant cinq ans, j’ai enseigné auprès d’enfants avec polyhandicap, IMC, troubles moteurs, troubles associés et/ou maladies rares et invalidantes, au sein de l’Unité d’Enseignement d’un IEM-EEAP , au départ, dans le cadre de la formation CAPPEI. Ainsi, j’étais volontaire pour travailler spécifiquement auprès d’enfants en situation de handicap sans avoir envisagé le public qui m’attendait.
Avant le Cappei, des lectures, rencontres et quelques expériences en ESMS m’avaient amenée à me positionner du côté du modèle social du handicap. Ce modèle induit de penser le handicap comme une construction sociale qui sépare les personnes et crée les catégories valides et invalides en opposition au modèle médical, encore puissant en France, qui a ancré une vision individualisée et naturaliste du handicap.
Dans l’histoire récente, les mouvements sociaux et l’influence internationale, ont participé à la primauté du modèle social du handicap sur le modèle médical dans les discours et les instructions officielles français. Progressivement, l’émergence d’un regard davantage centré sur les contextes et les environnements générant des situations de handicap, au détriment du regard stigmatisant sur les individus à réparer car « porteurs » de handicap, incite à s’emparer du projet inclusif et du concept d’accessibilité universelle pour une participation de tou·tes à la vie en société, dans toutes ses dimensions. Il n’empêche que l’écart reste immense entre les intentions officielles et les réalités de terrain. Au-delà des besoins criants de moyens humains et matériels, il y a tout un travail de déconstruction de l’autorité du modèle médical à poursuivre. Se positionner du côté du modèle social implique en effet d’interroger les représentations qui participent de cette construction sociale et les séparations symboliques et matérielles entre les catégories (valide/invalide) toujours opérantes. Penser le modèle social du handicap oblige à penser le validisme, à savoir le système qui place les personnes valides comme la norme sociale et qui légitime les discriminations envers les personnes assignées dans une position invalide.
À mon arrivée à l’IEM-EEAP, il ne m’a toutefois pas été possible d’incarner les convictions que je brandissais haut et fort. L’écart entre ma posture théorique et la manière avec laquelle j’accueillais ce que je découvrais était troublant : Je percevais d’abord et seulement les corps au travers des limitations motrices, des paralysies, des hypotonies, des appareillages orthopédiques et respiratoires, des cris, des cris sans les mots, des mots qui ne se récupèrent pas, des difficultés d’élocution, des convulsions, des fausses routes, des couches et des odeurs, des regards non adressés, du bavage, des intrusions par diverses sondes, de l’énigme des lésions cérébrales, de la maladie infantile dégénérescente… Médusée, je découvrais la grande dépendance, les vies cachées de personnes dont on ne soupçonne pas l’existence, au dehors des institutions françaises. Coincée dans la peur de l’étrange et de l’étrangeté, je ne voyais pas tout à fait mes élèves comme des personnes, je les objectivais par leurs limitations et ce, de manière fragmentée. Une collègue chevronnée m’avertit : « Tu vas voir, avec ces enfants, il faut avoir le feu sacré. Si tu ne l’as pas, il faudra passer à autre chose. »
La plupart de mes élèves étaient non-oralisant·es voire ne communiquaient peu ou pas. Iels étaient en grande difficulté pour exprimer de l’intentionnalité, manipuler et se mouvoir. Tout droit sortie de dix ans d’enseignement en maternelle, où les enfants bougent et s’affirment à mesure qu’iels investissent les langages, qu’allais-je donc pouvoir proposer à ces enfants qui m’apparaissaient emmuré·es dans leur corps et contenu·es par leurs appareillages ? Je manquais d’éclairage pour construire des situations pédagogiques intéressantes et adaptées dans ce contexte hétérogène et complexe. En comparaison au travail individualisé de mes collègues rééducateur·rices, en quoi mon intervention, non experte, pouvait trouver de la légitimité ? Clairement, ma créativité pédagogique se trouvait entravée par les limitations apparentes, et je me persuadais de leur fixité intrinsèque (me concernant : mes affects, mon ignorance, et concernant mes élèves, leur mode apparemment étrange d’accès/non-accès au monde) et extrinsèque (le manque d’accompagnement humain, d’adaptation ergonomiques de l’espace, de formation, de connaissances accessibles, de modèle). Bref, ni la grâce ni le feu sacré ne semblaient m’avoir touchée.
Accrochée à mes convictions de départ, je refusais qu’une sensibilité ou un don eurent été nécessaires pour construire une présence avec ces élèves plus qu’avec les autres. Il m’était impossible de céder au principe du feu sacré qui validait une vision déficitaire du handicap et empêchait de reconnaître ces élèves à égalité d’humanité avec les autres enfants jusqu’ici rencontré·es.
Je cherchais : Pourquoi la relation était plus compliquée, qu’est-ce qui m’empêchait de considérer ces enfants autrement que depuis leurs corps « abîmés » ? Étais-je définitivement une sale validiste ? J’ai pensé : L’enfermement et l’invisibilisation des personnes en situation de handicap choisis et construits par la société française dans les institutions spécialisées renforce un « rapport d’altérité radical au handicap » (Ployé, A., 2021). Je n’étais ainsi pas seule responsable des représentations qui me traversaient et peut-être alors allais-je pouvoir les dépasser.
Par un patient travail d‘écriture expressive, j’ai tenté d’identifier ce que je projetais sur les élèves, leurs parents, et leur environnement médicalisé. Il s’agissait de chercher les effets de la fragilité et de l’étrange perçue chez l’autre, de chercher les racines de mon dégoût, de ma pitié et de mon misérabilisme. Être traversée par tout cela n’est pas très glorieux, c’est violent, mais c’eût été une erreur de me considérer seule maçonne des murs de séparation d’avec ces élèves. Il fallait me souvenir, depuis la conception sociale du handicap, que je n’étais qu’un maillon d’une société héritière et productrice de rapport sociaux de handicap, emprunts de domination. Pour autant, s’il était inutile de m’attribuer la maternité de ces affects, j’avais la responsabilité de les mettre à jour pour les transformer, c’est-à-dire, comme dans une perspective féministe, de ne pas faire l’impasse sur le travail de déconstruction. Doucement, je commençais ainsi à dévoiler, penser et assumer ce qui ne l’est pas tout à fait mais qui continue d’agir, dans une société qui se voudrait déjà inclusive. On peut toutefois regretter que ce mouvement de déconstruction repose sur la bonne volonté individuelle et se réalise de manière isolée et il va sans dire que l’absence d’analyse de pratique dans un tel établissement est plus que problématique.
S’il est vrai que j’ai réussi ainsi à agir sur mes propres résistances à la relation, la part des élèves dans l’émergence de celle-ci a été déterminante. Ce sont elleux, in fine, qui ont ouvert le chemin de la relation, notamment quand il m’a fallu articuler ma pratique d’enseignante spécialisée à la perspective inclusive.
La deuxième année, en plus des temps de classe en interne auprès des enfants avec polyhandicap, j’intervenais à mi-temps, en externe, au sein de l’UEE rattachée à l’école proche de l’IEM-EEAP. Chaque matin, j’accueillais dans une salle dédiée, sept enfants de l’IEM. Les attentes institutionnelles concernant l’UEE étaient claires. Je devais développer les inclusions particulièrement individuelles (valorisées car perçues comme plus scolaires), construire des actions de sensibilisation sur le handicap, et enfin poursuivre le travail de conviction auprès des collègues enseignant·es et rééducateur·ices pour accompagner le changement vers l’inclusion et la désinstitutionalisation. Les deux enseignantes de l’UEE qui m’avaient précédée s’étaient attelées à appliquer ce travail prescrit. Ainsi, tou·tes les élèves se joignaient à la chorale de l’école, les élèves aux profils les plus scolaires bénéficiaient de temps d’inclusion individuelle et des actions de sensibilisation au handicap étaient réalisées chaque année par les professionnel·les de l’IEM-EEAP aux élèves des classes de l’école.
Entre ce que mes collègues enseignantes spécialisées m’avaient raconté du génial de l’affaire qui roule et ce que j’ai observé à mon arrivée, il y avait comme un décalage malaisant. Il est important d’indiquer que les enfants se rendaient seul·es en inclusion individuelle, l’aide humaine restant sur l’UEE afin d’assurer les soins. Cela limitait les possibilités d’adaptation et de compensation pour assurer la participation des élèves inclus·es. Ainsi, en inclusion individuelle, mes élèves étaient accueilli·es en auditeur·rices libres, quand bien même ce qui était abordé n’était pas du tout adapté à leur parcours d’apprentissage et/ou à leurs besoins éducatifs particuliers. Les collègues qui m’avaient précédée me rassuraient : « Ne t’inquiète pas, ce qui compte, c’est l’inclusion sociale, iels sont content·es d’aller dans la classe, c’est ça qui compte. »
Effectivement, iels étaient content·es. Mais que vivaient-iels tout à fait ? Étaient-iels content·es ou se contentaient-iels de la place qu’on leur concédait ? Les enfants de l’IEM étaient là, à l’école, allaient en inclusion mais n’y apprenaient pas ou rien. Il aurait fallu co-construire les inclusions mais les obstacles se révélaient multiples.
Je ne pouvais pas assumer cette « forme de scolarisation se satisfaisant d’une intégration de l’élève à besoins éducatifs particuliers faisant de celleux-ci des élèves qui sont « dans l’école », mais qui ne sont pas membres « de l’école » » (Foreman, 2001 ; Hegarty, 1993). Je décidais alors de suspendre les inclusions, le temps de trouver des pistes de participation intéressantes pour mes élèves, consciente de me placer en défaut par rapport au travail prescrit.
Les collègues PE partageaient tou·tes leur admiration : « Moi, je ne pourrais pas travailler avec tes élèves, iels me font mal au cœur, quand je les vois dans la cour peiner à marcher, peiner avec leur fauteuil. Et ton petit là, il a une maladie ? Et celui avec la machine pour respirer aussi ? Heureusement qu’il y en a qui peuvent. Toi, tu as la fibre, ça se sent. »
Partant de là, je retrouvais ce que j’avais moi-même ressenti, à savoir le regard déficitaire et vulnérabiliste du modèle médical et à nouveau l’idée du feu sacré. Je comprenais qu’à ce stade, le rapport social de handicap restait impensé et impensable. Comme on ne peut pas provoquer leur petite révolution à la place des autres, j’ai concentré mon attention sur les élèves et leur manière de se vivre à l’école.
Le moment le plus attendu était la récréation. Mes élèves la réclamaient et y partaient gaiement. J’y observais les modalités de relations et non-relations établies avec les autres. Du côté des élèves de l’école, je remarquais les CP s’approcher de M. pour jouer à se faire peur avant de repartir en hurlant. Lorsqu’il y avait un problème, on venait me voir pour me parler des « zandicapés », sans recherche autonome de régulation. Adultes et enfants me parlaient d’elleux, devant elleux. Il y avait autant de gestes de soutien qui s’imposaient à mes élèves sans qu’elleux n’aient exprimé de demande d’aide (pousser les fauteuils, ramasser à leur place un objet tombé). Je ne pouvais m’empêcher de faire un lien entre certains cérémonials de politesse à l’initiative d’enfants et la condescendance dont les adultes sont capables dans les interactions avec des personnes désignées handicapées. Les enfants de l’école étaient acculturé·es aux actions de sensibilisation au handicap, conçues dans un esprit de catéchisme vertical. Je pensais : Donnons-nous le droit aux enfants d’exprimer leur rapport d’altérité (radicale) au handicap ? Les adultes n’attendent-iels pas des enfants une attitude d’emblée déconstruite qu’elleux-même n’ont pas encore atteinte ?
Du côté de mes élèves, je remarquais des errances, une frustration puissante face à la difficulté de participer aux jeux collectifs, de la précipitation, de la colère d’être incompris·e/incompréhensible, de l’expulsion de certains appareillages, de l’évitement de certaines interactions et beaucoup, beaucoup de bagarre.
Lorsque nous revenions en classe, les élèves étaient emprunt·es d’une frustration qui n’avait pu être adressée. En réponse, j’ai proposé un temps quotidien spécifique, la papote récré. Par la conversation critique, issue de la pédagogie d’initiation, je décidais de partir de ce qui mobilisait les enfants de l’UEE, à savoir les difficultés rencontrées pour participer au temps de récréation. Converser ensemble était loin d’être envisageable pour ces élèves. Après un accueil enthousiaste, L. a réagi, fâché, à l’ouverture de la première papote récré : « Nous pas parler, pas possible ! ».
Petit à petit, le recours à différents langages (danse, parole et CAA, étayage par la production d’hypothèses, dessin codés, cartographie, théâtre, boîtes à histoire), leur a permis d’investir des formes de récits accessibles et de raconter avec grand sérieux les nœuds relationnels rencontrés pendant les épisodes de récréation. Puis, les élèves, peut-être rassuré·es quant à leur capacité de narration, ont investi leurs outils respectifs de communication alternative, n’ayant plus systématiquement besoin de recourir aux autres formes de récit et bénéficiant d’une solidarité grandissante de la part des pairs plus autonomes, qui s’associaient à la production d’hypothèses pour les enfants non-oralisant·es, réalisée exclusivement par mes soins au départ. Ensemble, les enfants cherchaient à construire du récit singulier et commun de leur vécu social scolaire. Iels revenaient chaque jour déçu·es, frustré·es de vivre des expériences éloignées de ce qu’iels avaient espéré. À partir de ces déceptions, nous recensions les problèmes, les obstacles. De là, des questions émergeaient et je m’attachais à mobiliser le groupe pour encourager l’émergence d’une recherche collective en favorisant l’appui sur les références communes de l’histoire partagée et cumulée du groupe. Est-ce qu’on peut obliger quelqu’un·e à être notre copain·ine ? Est-ce que c’est pareil de rire avec les autres et de rire des autres ? Comment faire pour montrer qu’on n’est pas d’accord, si on ne peut pas dire ? ….
Enseignante spécialisée, je trouvais alors la piste d’une position qui me semblait porteuse, celle de médiatrice cherchant à soutenir les élèves pour qu’iels trouvent des moyens de participation à ce temps particulier de récréation, ce temps où tou·tes les enfants se retrouvent, éloigné·es du contrôle social, (re)trouvent un peu de liberté d’agir et d’interagir spontanément, parfois en décalage avec les comportements dociles et normés exigés des adultes.
De questions assez généralistes, les papotes récré ont avancé vers des questionnements plus articulés et plus étroitement liés à la condition singulière des élèves de l’UEE dont voici un exemple :
Un jour, P, de retour de récréation, n’a plus ses chaussures orthopédiques mais ses chaussures du commerce.
L. commente : « pas possible, pas les bonnes. ».
P. détourne la tête, pas vu pas pris.
Mais L. insiste : « ce n’est pas normal ! »
P. au moyen de son tableau de communication nous explique qu’il ne veut plus mettre ses chaussures orthopédiques, car elles ne sont pas pareilles.
Je me tourne vers le groupe et demande : « Et vous, est ce que ça vous arrive aussi de ne plus vouloir mettre vos chaussures ? ».
Le groupe s’engage dans une longue conversation ponctuée d’affirmations, de questions sans réponses et surtout de l’incidence du regard des autres enfants.
« Nos chaussures, elles sont pas pareilles, elles sont moches, on veut des chaussures comme les autres ».
Des comparaisons avec les fauteuils, les attelles, les coquilles arrivent progressivement. Comme d’habitude, j’écris toutes les questions au tableau, à mesure. À la fin de la conversation, il n’y a plus de place sur le tableau, les élèves sont impressionné·es de tout ce qui est écrit.
Je leur partage : « Les chaussures, les coques et les attelles, c’est un sujet important, ça vous intéresse. Qui pourrait aider à répondre à vos questions, à comprendre pourquoi on vous demande de les porter ? ».
Iels finissent par s’accorder sur l’expertise des orthoprothésistes qu’iels connaissent bien car ceux-ci sont présents tous les lundis, au centre. On décide de les solliciter mais avec la forme qui convient : Une lettre est rédigée en dictée à l’adulte et leur est envoyée. Le lundi suivant, les orthoprothésistes enthousiastes, nous répondent en direct en proposant un rendez-vous à leur cabinet.
Une occasion en or pour donner du sens aux appareillages que les enfants n’acceptent pas de manière linéaire. Le jour J, une visite « mise en situation » nous attendait. Les enfants ont enfilé des blouses et se sont grimés en orthoprothésistes réalisant toutes les étapes de la fabrication des attelles, des coques et des chaussures.
L’attention n’a pas été évidente à maintenir tout au long de la visite mais les élèves ont tou·tes attrapé quelque chose permettant à postériori une reconstitution narrative de l’expérience. Surtout, iels ont eu des réactions spontanées étonnantes : « Maintenant, on aime nos chaussures, on sait pourquoi. ». « Maîtresse, il faut qu’on dise aux enfants de l’école de venir. Il faut qu’on leur fasse la visite pour qu’ils comprennent nos chaussures. ».
À la suite de cet épisode, P. a remis ses chaussures orthopédiques sans problème, les enfants de l’UEE ont invité les autres enfants de l’école et le projet d’une nouvelle visite chez les orthoprothésistes a démarré. À la suite aussi, les papotes récré ont été plus marquées par des questions résonnantes : L, atteint de myopathie de Duchêne a pu raconter sa détestation du fauteuil, étape prochaine de l’évolution de sa maladie. M. a rebondi en disant que lui aussi détestait les fauteuils. G., déjà en fauteuil, a pleuré en expliquant qu’elle trouvait ça très méchant, parce que son rêve, c’était de marcher mais qu’elle ne pourrait jamais.
Je n’ai pas l’espace ici pour détailler toutes les interactions et déplacements que ces interventions ont générés mais ce qui semblait stimulant pour les enfants, c’était d’avoir investi progressivement cette papote récré pour parler leur condition et les prises de conscience de leurs écarts à la norme. À mesure que ces conversations s’étoffaient et que des projets de ce type en découlaient, il aurait été intéressant de mener une étude ethnographique afin d’objectiver l’éventuelle incidence de leur effet sur la qualité des relations entre enfants en récréation.
Si ces conversations se sont déroulées en non-mixité, je n’ai pas pensé celle-ci comme une fin en soi, mais plutôt en référence aux luttes, qui la mobilisent comme un outil pour viser à terme une mixité égalitaire. Une simple étape donc, qui n’empêche pas la pratique de la conversation critique en mixité à l’école afin, par exemple, de provoquer une première recherche nécessaire à la relation entre enfants communiquant différemment : Comment converser ensemble quand on ne communique pas pareil ? Une remarque me semble importante : Si la non-mixité est un outil d’émancipation potentiel pour les enfants désigné·es handicapé·es, quid de l’accès à ce type d’espace pour les nombreux·ses enfants inclus·es de manière individuelle ?
Les inclusions ont repris, petit à petit. En inclusion inversée, mes élèves invitaient les autres à participer à des projets, que, du fait de l’hétérogénéité des BEP au sein de l’UEE, nous co-concevions en accessibilité universelle. À mesure qu’iels apprenaient à parler leur condition, mes élèves devenaient en effet capables de participer à la réflexion à priori et à posteriori autour des adaptations les concernant individuellement et collectivement.
Modestement, je ne peux que remercier mes élèves qui m’ont invitée à ne plus les regarder avec ce qui me semblait leur manquer mais à davantage encourager l’expression de leur curiosité, terreau de l’activation de leurs ressources ! Grâce à leur détermination, j’ai pu trouver une place d’enseignante spécialisée, alignée à mes convictions, celle de soutien à la recherche revendicative et collective des conditions de participation sociale de tou·tes les élèves à l’École.
7 - Ecole et handicap : comparaisons internationales…
Les premières réponses aux besoins des personnes handicapées
L’éducation des personnes en situation de handicap a longtemps reposé sur des approches ségrégatives. Avant le XXᵉ siècle, ils et elles étaient souvent excluEs des systèmes éducatifs traditionnels. Les premières réponses étaient principalement caritatives ou médicales, considérant les personnes handicapées comme des êtres à soigner ou à assister. Les premières institutions spécialisées, créées au XIXᵉ siècle, visaient à rééduquer et insérer ces « populations » dans la société. Cependant, ces établissements fonctionnaient en parallèle des systèmes éducatifs généraux, renforçant la ségrégation.
Les débuts de la normalisation et de l’intégration
Un tournant significatif intervient dans les années 1960 – 1970 avec l’émergence de mouvements en faveur de la normalisation et de l’intégration. Inspirés par des initiatives pionnières en Suède et aux États Unis, ces courants visaient à rapprocher les conditions de vie des personnes handicapées de celles du reste de la population. La normalisation implique que les personnes handicapées puissent vivre et apprendre dans des conditions aussi proches que possible de celles de leurs pairs. Par exemple, aux États-Unis, la Loi sur l’éducation des enfants handicapéEs de 1975 (Individuals with Disabilities Education Act) a garanti le droit à une éducation publique gratuite et adaptée grâce aux luttes d’émancipation organisées par les personnes concernées elles-mêmes.
En Europe, des pays comme l’Italie et la France ont commencé à modifier leurs politiques. En France, la loi d’orientation de 1975 a reconnu le droit à l’éducation pour touTEs les enfants handicapéEs, mais ce droit était majoritairement exercé dans des établissements spécialisés. En Italie, le rapport Falcucci de 1975 a jeté les bases d’une éducation inclusive, avec la suppression progressive des écoles spécialisées au profit de l’intégration dans les écoles ordinaires.
La déclaration de Salamanque et la notion d’éducation inclusive
Les années 1990 marquent un véritable changement de paradigme avec la déclaration de Salamanque adoptée en 1994 lors d’une conférence organisée par l’UNESCO : il s’agit de passer d’une prise en charge centrée sur les troubles ou déficiences à une approche focalisée sur les besoins éducatifs spécifiques des élèves. Ce texte fondateur prône une éducation inclusive, estimant que les écoles ordinaires constituent le meilleur cadre pour accueillir les enfants à besoins éducatifs spéciaux (BES), et sont le moyen le plus efficace de lutter contre les discriminations et de favoriser la socialisation et la citoyenneté.
La déclaration appelle les États à adapter leurs systèmes éducatifs afin de répondre à la diversité des besoins, affirmant que l’inclusion est non seulement une question d’égalité, mais aussi d’efficacité sociale.
D’après Marcel Calvez (2018), elle vise à encourager l’intégration scolaire de ces enfants et à combattre l’exclusion dans laquelle ils sont le plus souvent tenus. Elle dispose ainsi que « les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable de répondre à ses besoins ». Cette déclaration repose sur la conception d’un système éducatif devant être en capacité de répondre à la diversité de caractéristiques, d’aptitudes et de besoins d’apprentissage des enfants. Elle considère que « les écoles ordinaires ayant une orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires en créant des communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l’objectif de l’éducation pour tous ».
En 2006, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a renforcé cette vision en faisant de l’éducation inclusive un droit fondamental (ratification par la France en 2010). L’article 24 de la convention stipule que les États parties doivent garantir un système éducatif inclusif à tous les niveaux, en veillant à ce que les enfants handicapéEs puissent apprendre aux côtés de leurs pairs dans des écoles ordinaires : les États signataires de la convention doivent veiller à ce que « les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général » (enseignement primaire et secondaire) ; ils doivent également veiller à ce que les enfants handicapés puissent « sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès dans les communautés où [ils] vivent à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit et à l’enseignement secondaire ». (M Calvez, 2018).
Nous noterons ici que la version anglaise de la convention utilisera le terme d’ « inclusion » tandis que la version française gardera le terme « intégration » dans la traduction du texte international.
Les évolutions récentes et la diversité des approches
Trois grandes tendances se dessinent dans l’histoire récente des politiques éducatives liées au handicap :
- Le passage de l’approche médicale à l’approche sociale : Le handicap est de plus en plus perçu comme une interaction entre les limitations individuelles et les barrières environnementales. Cette vision pousse les systèmes éducatifs à s’adapter aux besoins des élèves, plutôt que l’inverse.
- La reconnaissance des droits : L’éducation inclusive est désormais ancrée dans les droits humains, grâce à des instruments juridiques internationaux comme la Convention des Nations Unies.
- La diversification des modèles : Les pays explorent différentes voies pour mettre en œuvre l’inclusion, allant de la création d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) en France à des approches totalement inclusives en Suède ou au Nouveau-Brunswick (Canada).
Les législations nationales diffèrent dans la manière d’organiser ces soutiens, car les systèmes scolaires sont influencés par des conceptions distinctes du handicap, des finalités du système éducatif et des représentations du lien social. Cette diversité de visions conduit à des approches variées, mais elles peuvent être regroupées selon deux approches du handicap (Rapport du CNESCO de 2016, centre national d’étude des systèmes scolaires) :- Approche essentialiste : Le handicap est vu comme une déficience par rapport à une norme. Le besoin éducatif particulier est donc perçu comme étant lié à la personne handicapée, et la solution réside dans la compensation, la correction ou l’adaptation des capacités déficientes.
- Approche universaliste : Le handicap est compris comme une forme de diversité présente dans la société. Plutôt que de se concentrer sur la déficience individuelle, cette approche met l’accent sur la capacité du système éducatif à être inclusif et à s’adapter aux différents profils d’élèves. Le défi réside dans l’accessibilité et l’accueil des élèves, indépendamment de leurs particularités.
Petit rappel en introduction : touTEs les enfants handicapéEs ne vont pas à l’école…
Rapport mondial de suivi sur l’éducation : « Inclusion et éducation : tous, sans exception ! » (UNESCO 2020)
» Les enfants, les adolescents et les jeunes handicapés représentent 12 % des effectifs scolarisés mais 15% des effectifs non scolarisés. En général, la probabilité que les enfants handicapés figurent parmi les effectifs non scolarisés est d’autant plus élevée que le taux d’enfants non scolarisés est faible, ce qui semble indiquer que les enfants handicapés sont les plus difficiles à atteindre (figure 3.4). Par rapport à leurs pairs en âge de fréquenter le primaire, le premier cycle du secondaire et le second cycle du secondaire, la probabilité de ne pas aller à l’école est plus élevée d’1 point de pourcentage dans le primaire, de 4 points de pourcentage dans le premier cycle du secondaire et de 6 points de pourcentage dans le second cycle du secondaire pour les enfants handicapés ; cette probabilité est plus élevée de 4, 7 et 11 points de pourcentage respectivement dans le cas des enfants souffrant d’une déficience sensorielle, physique ou intellectuelle. Mais pour ces enfants la probabilité de n’avoir jamais été scolarisé est 2,5 fois plus élevée que dans le cas des enfants sans handicap. »
Aujourd’hui, les pays diffèrent dans leur approche des besoins éducatifs particuliers (BEP) en fonction de leurs conceptions du handicap et de l’intégration des élèves. Certains pays, comme la Belgique et l’Allemagne, adoptent une approche essentialiste, considérant le handicap comme une déficience qui nécessite des soutiens et des aménagements spécifiques. Ces pays tendent à avoir des systèmes éducatifs plus sélectifs, où la diversité est perçue comme une exception et le redoublement est plus fréquent.
À l’opposé, des pays comme la Suède et l’Irlande adoptent une approche universaliste, où le besoin éducatif particulier est perçu comme une question sociale et la diversité des élèves, incluant celles et ceux issuEs de milieux sociaux défavorisés ou avec des difficultés linguistiques, est vue comme une richesse. Ces systèmes éducatifs sont plus intégratifs, mettant l’accent sur l’autonomie et la participation sociale des élèves. Dans ces pays, les établissements scolaires sont conçus comme des espaces de vie où les enseignantEs jouent un rôle de partenaires dans l’accompagnement des élèves, favorisant ainsi leur inclusion dans la classe.
Les pays intégratifs, comme ceux scandinaves, cherchent à renforcer la cohésion sociale et à favoriser un climat de confiance entre élèves et enseignantEs. En revanche, les pays ayant une approche plus essentialiste tendent à isoler les matières enseignées et à privilégier les savoirs scolaires, réduisant l’impact des activités périscolaires et des soutiens à une minorité d’élèves en difficultés.
Cette diversité dans les approches du besoin éducatif particulier reflète les conceptions sous-jacentes des systèmes éducatifs, qui peuvent soit favoriser la cohésion sociale, soit isoler les élèves en difficultés, celles et ceux qui ne sont pas « dans la norme ».
Alors que certains pays privilégient une scolarisation inclusive, où les élèves à BEP sont intégréEs dans les mêmes classes que les autres (comme en Islande ou à Malte), d’autres, comme la Grèce et le Danemark, préfèrent des classes spécialisées. Certains pays, comme la Belgique, l’Allemagne ou les Pays-Bas, optent pour un milieu spécialisé, séparant les élèves à BEP des élèves traditionnelLEs. La France, quant à elle, adopte une approche mixte.
Quand le ministère de l’Éducation Nationale fait son « auto-promo » … critique ?
Dans un colloque de 2018 organisé par le ministère de l’Éducation nationale, la France se présente comme inscrite dans une dynamique inclusive, en s’orientant vers un système plus accessible, centré sur l’autonomie des élèves. Les principes abordés lors de la conférence incluent : l’accompagnement vers l’autonomie, l’importance du partenariat entre les acteurICEs éducatifIVEs et sociauxALES, la formation initiale et continue des enseignantEs, ainsi que l’insertion professionnelle comme étape clé de l’inclusion sociale.Trois modèles nationaux sont analysés pour illustrer les approches contrastées de l’inclusion scolaire en Europe :
Italie : Pionnière de l’intégration totale
Depuis les années 1970, l’Italie se distingue par une intégration complète des élèves à BES dans les écoles ordinaires. La loi de 1977 a aboli les écoles spécialisées, établissant la présence d’enseignants de soutien dans les classes. Les municipalités garantissent l’accessibilité et les écoles bénéficient d’une autonomie pédagogique pour répondre aux besoins individuels des élèves.
Les enseignants de soutien représentent 13,2 % du personnel éducatif en 2014, et leur nombre a doublé en une décennie.
Chaque élève bénéficie d’un plan éducatif individualisé, élaboré avec la famille et les experts, intégrant des ressources pédagogiques adaptées.Malgré les défis, tels que le coût élevé ou l’équilibre entre inclusion et individualisation, l’Italie reste un modèle exemplaire dans la mise en œuvre d’une inclusion généralisée.
Allemagne : Un système segmenté
En Allemagne, la ségrégation scolaire demeure marquée : 54 % des élèves à BES sont orientés vers des écoles spécialisées, tandis que 46 % partagent partiellement leur temps avec des élèves ordinaires. Ce modèle reflète une dualité entre inclusion partielle et éducation spécialisée, souvent fondée sur une approche médicale des troubles.
Les décisions sont prises au niveau des Länder, entraînant des disparités régionales notables.
Les Förderschulen (écoles spécialisées) accueillent les élèves identifiés comme ayant des troubles spécifiques, après un avis collégial incluant enseignants, psychologues et parents.Malgré des efforts récents pour promouvoir l’inclusion, notamment dans certaines régions comme Brême, le système éducatif allemand reste caractérisé par une forte ségrégation.
Suède : Une inclusion quasi-totale
Depuis les années 1970, la Suède a mis en place un système inclusif qui intègre 99 % des élèves à BES dans des classes ordinaires. Contrairement à d’autres pays, ces élèves ne reçoivent pas de statut spécifique, et leurs besoins sont abordés comme une adaptation pédagogique universelle.
Les municipalités, responsables des services éducatifs, bénéficient de l’appui d’agences spécialisées pour organiser les ressources nécessaires.
La loi de 2010 affirme que les écoles doivent répondre aux besoins de tous les élèves et collaborer avec les services sociaux et de santé pour soutenir ceux ayant des besoins spécifiques.
Une détection précoce des troubles, dès la petite enfance, permet des interventions rapides et adaptées.Ce modèle décentralisé favorise une approche intégrée de l’éducation, bien que des écoles spécialisées existent pour certains cas rares (enfants sourds, aveugles).
Enjeux et tensions présentés en conclusion du colloque :
L’inclusion scolaire pose des défis complexes, notamment :
- Ressources et moyens : Les approches inclusives nécessitent des investissements conséquents en enseignants, infrastructures et accompagnement.
- Coordination institutionnelle : La séparation entre les systèmes scolaires et médico-sociaux, comme en France ou en Allemagne, complique l’intégration.
- Tensions entre inclusion et spécialisation : Les parents d’enfants à besoins très spécifiques plaident parfois pour des dispositifs spécialisés, perçus comme mieux adaptés.
Pour les chercheurEUSEs du Cnesco, les disparités dans les modes de scolarisation montrent que l’intégration des élèves à BEP dépend largement des concepts éducatifs et des politiques d’inclusion. La formation des enseignantEs joue un rôle clé. Certains pays (comme la Finlande, le Royaume-Uni ou le Danemark) ont une approche plus ouverte à la pédagogie inclusive, avec des pratiques comme le travail en petits groupes ou l’adaptation des consignes, contrairement à des pays comme la France ou la Belgique, où ces pratiques sont moins fréquentes.
L’inclusion ne se limite cependant pas à l’accès physique aux établissements scolaires, et il est crucial que les soutiens pédagogiques aident les élèves à développer leur autonomie et à participer pleinement à la société. Une conception de l’inclusion qui se contente de garantir l’accès aux écoles, néglige les facteurs sociaux et pédagogiques qui conditionnent réellement la réussite et l’intégration des élèves. Les pratiques pédagogiques et les soutiens doivent être adaptés pour garantir l’égalité des chances et ne pas condamner les élèves à une invisibilité sociale.
Les analyses de comparaisons internationales des modèles scolaires ont permis de mettre en avant trois conceptions idéales-typiques : la conception éducative, la socio-éducative et la socio-économique, chacune ayant des implications différentes pour l’accès à l’éducation et à l’intégration sociale des élèves à besoins particuliers.
- La conception éducative : Elle repose sur une vision citoyenne de l’inclusion, affirmant que la diversité enrichit collectivement. Elle considère principalement le handicap comme une forme d’inaccessibilité des institutions, plutôt que comme une déficience. Cette approche met l’accent sur la personnalisation des pratiques pédagogiques, soutenue par une législation non discriminatoire et une vision holistique de l’accessibilité. Les pays comme la Norvège incarnent cette approche, avec un projet individualisé pour chaque étudiantE à BEP. Toutefois, dans un contexte économique austéritaire, la montée du nombre d’étudiantEs et d’élèves à besoins spécifiques pourrait engendrer des contraintes budgétaires, risquant de rendre l’inclusion plus difficile sans un soutien adéquat.
- La conception socio-éducative : Elle relie l’inclusion à une approche essentialiste du handicap, dans laquelle les élèves et étudiantEs sont souvent perçuEs comme ayant une déficience ou un trouble de la santé. Les financements visent à compenser les incapacités, mais les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur ne considèrent pas la diversité comme un facteur de réussite collective. Les étudiantEs à BEP dépendent largement de l’engagement personnel des éducateurICEs et du soutien familial, souvent en raison de l’absence de formation adéquate. Cette approche aboutit à une inclusion qui reste exceptionnelle, où l’accessibilité physique prime, sans nécessairement garantir une reconnaissance sociale ou professionnelle.
- La conception socio-économique : Cette approche marchande voit l’inclusion comme un moyen d’efficacité économique, où le handicap est perçu comme un besoin de service contribuant à la réussite scolaire. Les établissements éducatifs sont motivés par des incitations financières à ouvrir leurs portes à la diversité, mais cette logique peut aussi favoriser les universités spécialisées, exacerbant les inégalités entre les étudiantEs à BEP et le reste de la population. Le handicap devient un vecteur de différenciation et de qualité, souvent en lien avec la concurrence économique.
En conclusion, l’histoire des politiques éducatives liées au handicap reflète une évolution vers une plus grande inclusion et reconnaissance des droits des élèves et étudiantEs handicapéEs. Cependant, cette transformation reste inégale selon les régions et les contextes sociaux, politiques et économiques.
Les systèmes éducatifs adoptent des approches variées face à l’éducation des élèves handicapéEs. Trois modèles principaux se distinguent désormais : le modèle ségrégatif (type Belgique ou Allemagne), le modèle intégratif (type Italie) et le modèle inclusif (type Suède).
- Modèle ségrégatif : Ce modèle repose sur des établissements spécialisés qui accueillent uniquement des élèves handicapéEs. Ce modèle se présente comme permettant une réponse adaptée aux besoins individuels, mais il limite souvent la socialisation et l’égalité des chances. Il demeure contraire aux textes internationaux concernant le droit des personnes handicapées.
- Modèle intégratif : Ce modèle vise à insérer les élèves handicapéEs dans les écoles ordinaires tout en leur fournissant un soutien spécifique. Ce modèle favorise la socialisation tout en préservant une aide ciblée, mais son succès dépend de la qualité des ressources financières allouées.
- Modèle inclusif : Le modèle inclusif, promu par la déclaration de Salamanque, repose sur l’idée que le système éducatif doit s’adapter à la diversité des élèves, et non l’inverse. Ce modèle favorise une égalité des chances et une cohésion sociale accrues, mais il suppose des investissements élevés et une coordination efficace entre les acteurICEs de terrain.
D’autres approches hybrides existent, comme au Canada, où le Nouveau-Brunswick combine inclusion et soutien spécialisé.
La France, quant à elle, adopte un modèle mixte avec des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) au sein des écoles ordinaires tout en maintenant des espaces de vie et de scolarisation ségrégués au sein des établissements médico-sociaux (ESMS). Nous rappelons ici que le système scolaire français a été remis en cause à de nombreuses reprises concernant le non-respect des droits des personnes handicapées (ONU en 2021, Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe en 2023, Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture en 2024).
La question des moyens !
La mise en œuvre de l’inclusion scolaire exige des investissements considérables en matière de formation des enseignantEs, d’adaptation des infrastructures et de recrutement d’accompagnantEs. Dans de nombreux pays, les moyens alloués restent insuffisants, compromettant la qualité de l’éducation pour les élèves à BES.
Formation des enseignantEs, de touTEs les professionnelLEs !
L’éducation inclusive nécessite une formation spécialisée pour les enseignantEs, afin qu’ils et elles puissent adapter leurs pratiques pédagogiques à la diversité des besoins. Si des pays comme l’Italie ou le Canada ont mis en place des programmes dédiés, d’autres, comme la France, peinent encore à généraliser ces formations.
Coordination inter-institutionnelle
Un autre enjeu clé est la coordination entre les différents acteurICEs impliquéEs : systèmes éducatifs, services sociaux et secteur médico-social. Dans des pays comme la France, cette séparation institutionnelle freine souvent la mise en œuvre effective de l’inclusion. À l’inverse, la Suède montre qu’une coopération intersectorielle bien organisée peut améliorer l’évolution du système scolaire adapté aux besoins de touTEs.
Fin de la spécialisation, désinstitutionalisation et accessibilité universelle
Le respect des droits des personnes handicapées exige d’entamer partout les processus de fermeture des établissements spécialisés ségrégatifs. L’accessibilité universelle à l’école, dans les transports, la santé, la culture, la justice, l’emploi, l’alimentation, la culture… dans tous les espaces de vie individuels et collectifs doit devenir un enjeu prioritaire de toute décision politique, locale, nationale et internationale.
Acceptation sociale, lutte contre le validisme
L’acceptation sociale des élèves handicapéEs dans les écoles ordinaires reste actuellement un défi dans de trop nombreux pays. La sensibilisation, la formation des élèves, des enseignantEs et des familles est essentielle pour lutter contre les préjugés. La lutte contre l’handiphobie, le validisme est essentielle pour garantir la fin des discriminations liées au(x) handicap(s) à l’école comme ailleurs.
Bep, une appellation inclusive ou ségrégative ?
L’appellation Bep pour désigner les élèves à besoins particuliers est apparue dans le système éducatif français à l’occasion des dernières réformes concernant l’inclusion. La question s’est posée aussitôt de savoir s’il s’agissait de prendre en considération la difficulté scolaire dans son ensemble ou de dénier au handicap sa spécificité et les moyens qui lui sont alloués. Était-ce par exemple une manière implicite d’augmenter les missions des AESH ? Ou au contraire cela permettait-il de sortir d’une catégorisation des élèves ségrégative, à tout le moins manquant de souplesse ?
En réalité, la notion d’élèves à besoins particuliers est apparue précocement en Grande-Bretagne en 1978 dans le rapport Warnock (« special needs »). Cette notion prenait en compte que dans les pays de l’OCDE 15 à 20 % d’élèves connaîtront des difficultés particulières au cours de leur scolarité. Rien d’étonnant à ce que cette notion soit apparue dans le monde anglo-saxon où les collectifs de personnes handicapées ont lutté pour la défense de leurs droits civiques et où des travaux de recherches (disabilities studies) ont été menés. C’est ainsi qu’est née en Grande-Bretagne l’Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) en 74, à la suite de quoi le sociologue et activiste Mike Oliver a proposé en 1983 le modèle social du handicap. En 1994 La déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux inscrit dans le marbre pour la première fois que le handicap est une différence plutôt qu’une déficience ou incapacité, qui nécessite des besoins particuliers.
Mais les signataires de la déclaration de Salamanque se sont positionnéEs historiquement et se positionnent encore aujourd’hui différemment par rapport à cette notion. Si la Grande-Bretagne a été précurseure en matière de reconnaissance des besoins éducatifs particuliers, elle peine encore à scolariser aujourd’hui les élèves en situation de handicap. L’Italie a contrario a scolarisé en milieu ordinaire les élèves en situation de handicap dès les années 70, mais n’a pris en considération les élèves à besoins particuliers que très récemment. La définition même d’élèves Bep ne recouvre pas les mêmes réalités d’un pays à l’autre. Par exemple en France les élèves en situation de handicap entrent dans la catégorie des élèves à besoins particuliers ; en Allemagne on y adjoint les élèves avec des difficultés de lecture ; dans d’autres pays les élèves à besoins particuliers ne désignent que les élèves scolariséEs dans les classes spécialisées.
On le voit, l’étendue couverte par l’appellation Bep va générer ou non telles ou telles solutions adaptées. Cette fluctuation de ce que recouvre la notion de Bep rend d’ailleurs compliquée la comparaison entre les systèmes éducatifs européens ou de l’OCDE.
La France semble quant à elle osciller ces dernières années entre traiter la difficulté scolaire de manière globale à travers l’appellation Bep (mise en place du livret du parcours inclusif, qui propose des réponses pédagogiques aux besoins éducatifs particuliers) et catégoriser les difficultés comme le montrent les différents PAP (plan d’accompagnement personnalisé), PAI (projet d’accueil médicalisé) et PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) ou la question de savoir si les élèves notifiéEs IME/Itep peuvent ou non bénéficier d’un dispositif Ulis.
De manière générale, il ne faudrait pas que cette notion d’élèves à besoins particuliers se retourne contre elle et finisse par légitimer une école à deux vitesses plutôt qu’une école pour touTEs.
Bibliographie :
- Handicap : l’amnésie collective : La France est-elle encore le pays des droits de l’homme, Bachir Kerrouni et Stéphane Forgeron, Editions Dunod, Septembre 2021
- Apprendre (dans) l’école inclusive, Ife n°127, Janvier 2019, par Catherine Reverdy
8 - École inclusive : le modèle italien
Parmi les pays européens ayant fait le choix d’une école inclusive, l’Italie est considérée comme une référence. Le rapport n°2017 – 118 de l’Inspection générale sur « l’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie » le montre. Certaines réformes récentes s’en inspirent. D’abord parce que ce choix politique a été opéré précocement et permet d’avoir du recul : en 1977 les classes spécialisées ont été abolies, le système inclusif reposant sur la co-intervention avec unE enseignantE de soutien.
Ensuite parce qu’il s’agit d’un choix d’inclusion totale. La quasi-totalité des élèves en situation de handicap (99%) sont scolariséEs en milieu ordinaire, ce qui représente 3% de la totalité des élèves (chiffre de 2017). Contrairement au modèle inclusif suédois, les élèves, y compris les porteurTEuses d’autisme et polyhandicapéEs, sont inclusEs aujourd’hui en classe ordinaire et non en classes spécialisées. Ils et elles passent au moins 80% de leur temps avec leurs pairs.
Les années 60 et 70 en Italie sont marquées par une période effervescente de luttes pour la reconnaissance des droits civiques. Sous l’impulsion des travaux du psychiatre Franco Basaglia, directeur de l’hôpital de Trieste, naît en 1973 le mouvement social de la psychiatrie démocratique, qui interpelle forces politiques et syndicales. Ce mouvement s’oppose à l’institution psychiatrique traditionnelle. L’hôpital psychiatrique de Trieste, séparé de la ville par un mur, où étaient internées 1200 personnes, sur lesquelles s’exerçait un mélange de soin et de contrôle, sans effet thérapeutique, ferme ses portes. Les premiers centres de santé mentale ouvrent. Ces communautés thérapeutiques donnent au malade un statut social, que lui dénie la psychiatrie traditionnelle en l’enfermant. Pour Basaglia, cette dernière repose sur une relation d’oppression, d’exclusion et de dévalorisation par rapport à une norme. Il s’agit de restituer une pleine citoyenneté effective aux personnes internées, d’empêcher des formes d’exclusion en trouvant des solutions adaptées sur leurs milieux de vie, et de modifier les représentations associées aux troubles mentaux. En 1978, le Parlement italien vote la Loi 180, dite loi Basaglia, qui encadre la fermeture de tous les hôpitaux psychiatriques, dirigés généralement par des congrégations catholiques dans des établissements asilaires.
C’est sous l’impulsion de ce mouvement qu’à la fin des années 70 commencent à fermer les instituts spécialisés, à l’exception des instituts pour sourdEs muetTEs et pour aveugles. Le magnifique film de Bortone, « Rouge comme le ciel » (2004), basé sur la vie de l’ingénieur du son Mirco Mencacci, rendu aveugle à la suite d’un accident, est une dénonciation du fonctionnement de ces institutions.
Dès le début des années 60, dans un contexte de croissance économique, l’Italie porte le projet d’une école pour touTEs. On est dans une période d’expérimentation pédagogique et l’école est réorganisée de façon collégiale. En 1971, la loi prévoit que « l’instruction obligatoire se déroule pour tous les enfants et les adolescents, sans distinction, dans les classes normales de l’école publique », à l’exception alors des enfants ayant des déficiences mentales et des incapacités physiques sévères. En 1974 l’enseignante de lettres classiques Franca Falcucci, une démocrate chrétienne qui deviendra la première femme ministre de l’Éducation nationale en Italie, mène une enquête nationale sur les problèmes des élèves handicapéEs.
Suite à son rapport, on passe en 1975 d’« une école pour touTEs » à une « école adaptée à chaque individu ». La scolarisation est présentée comme la condition sine qua non de l’intégration sociale : « l’école, devant rapporter l’action éducative au potentiel de chaque élève, apparaît comme la structure la plus appropriée pour dépasser les conditions de la marginalisation auxquelles seraient autrement condamnés les enfants handicapés ». La Loi 517 de 77 instaure la scolarisation des enfants en milieu ordinaire de la maternelle au collège, puis s’étend aux lycées au début des années 80 et à la crèche et aux universités dans les années 90. Les écoles sont aménagées pour pouvoir accueillir les services socio-psychopédagogiques et se mettent à former des enseignantEs de soutien.
En 1992 la Loi 104 prévoit la prise en charge de l’enfant handicapéE dès l’âge de 3 ans sur tous ses lieux de vie en impliquant les services sanitaires et médicaux et les équipes éducatives à qui revient la pleine responsabilité pédagogique. Ce n’est qu’à cette date que sont fermées réellement toutes les classes spécialisées. Le système prévoit que l’État garantisse aux régions 80% des financements nécessaires aux moyens à mettre en place pour l’école inclusive. En 1997 on assiste à une réforme globale du système éducatif qui confère aux écoles la pleine autonomie (tout en les mettant en concurrence), chacune d’entre elles devant rédiger un plan d’offre de formation qui prévoit le succès de touTEs les élèves et des parcours didactiques individualisés pour les élèves handicapéEs. En 2015 la Loi dite Buona Scola a redéfini et redéployé les missions des enseignantEs. La valorisation des compétences numériques ainsi que la filière professionnelle sont également inscrites dans cette loi qui a développé des outils d’évaluation de la politique inclusive.
On peut donc dire que la politique d’inclusion scolaire, même si elle est confrontée aux oukazes de la politique libérale comme partout en Europe en matière de réduction des moyens et d’évaluation, a conduit à une transformation en profondeur de l’école italienne, passant progressivement d’un système ségrégué à un système inclusif, au moins juridiquement. On en verra les limites plus loin.
Si l’Italie entre dans le groupe des pays européens qui défendent un modèle social du handicap, le diagnostic est d’abord médical. Mais il ne s’agit pas comme en France d’orienter vers un établissement spécialisé, un dispositif ou le milieu ordinaire. Le but est d’anticiper les besoins.
Une fois le handicap reconnu ouvrant droit à des compensations (enseignantE de soutien /matériel pédagogique et technologique adapté /indemnités d’accompagnement), un diagnostic fonctionnel est établi par les services sociaux et sanitaires avec la famille qui met en avant la fonctionnalité et les potentiels des élèves handicapéEs pour anticiper les adaptations nécessaires. Il est à noter que les troubles de l’apprentissage englobant les différents dys n’entrent pas comme en France dans le champ du handicap.
Avant de procéder à l’inscription scolaire, les parents demandent une attestation d’enfant en situation de handicap et fournissent tous les documents requis pour signaler les besoins particuliers à l’école ou l’établissement de secteur dont ils peuvent vérifier l’offre de formation. Après l’inscription, le ou la chefFE d’établissement invite le conseil de classe à formaliser le projet de scolarisation et peut faire une demande d’enseignantE de soutien et éventuellement unE assistantE de communication ou unE assistantE éducatifIVE pour favoriser l’autonomie de l’élève. Un P.E.I. (plan éducatif individualisé) est rédigé en début de chaque année par le GLHO, groupe de travail attitré à telLE ou telLE enfant tandis que le GLI est un groupe de travail interprofessionnel dédié à l’inclusion scolaire en général dans l’établissement.
La classe où est scolariséE unE enfant handicapéE ne peut dépasser un effectif de 25 élèves, voire 20 élèves et ce y compris au lycée. UnE enseignantE de soutien ne peut suivre plus de 4 enfants. On compte en Italie 15% d’enseignantEs de soutien dont le rôle est celui de co-enseignantE et de conseil de spécialiste. Après une première phase d’observation, l’enseignantE de soutien organise avec l’enseignantE de la classe la programmation didactique de toute la classe en prenant en compte les besoins éducatifs de la classe. Les enseignantEs de soutien suivent une formation de deux ans et demi et touTEs les enseignantEs suivent une formation spécifique (pour apprendre notamment à diagnostiquer précocement). Cette formation initiale est complétée par une formation à la carte (par l’intermédiaire d’une somme allouée à chaque enseignantE) et des programmes d’études auxquels les enseignantEs sont associéEs existent. Le personnel enseignant peut également s’appuyer sur des centres de ressources. Le cursus scolaire peut être allongé jusqu’à 20 ans. Programmes, méthodes et examens sont aménagés. Un certificat de compétences peut être délivré si l’équivalent du baccalauréat ne peut être passé. Un accès à la voie professionnelle est garanti depuis une loi de 2003.
En 2018, une visite d’enseignantEs françaisEs dans le cadre d’Erasmus à l’école de Montechiarogulo a pu mettre en lumière 6 facilitateurs de la mise en place de l’école inclusive :
- un regard positif et valorisant sur les élèves en situation de handicap ;
- des manuels adaptés à l’inclusion ;
- un travail quotidien entre l’enseignantE titulaire et l’enseignantE de soutien et un travail hebdomadaire d’équipe ;
- des espaces aménagés ;
- une autonomie de l’établissement ;
- une didactique inclusive : avec des leçons ancrées dans la langue et le corps pour être accessibles au plus grand nombre et une organisation de la classe basée sur la coopération.
Une étude évaluative de 2020 a montré que le point fort en Italie reste la planification pédagogique et didactique : « La qualité de l’inclusion est reliée à un climat de collaboration et de sérénité permettant un véritable apprentissage ainsi qu’un accueil et un dialogue entre élèves et enseignantEs. »
Cette politique inclusive a été freinée en 2008 par le gouvernement Berlusconi qui a détérioré l’image des enseignantEs et a procédé à des coupes budgétaires sur les effectifs du personnel éducatif. Le fondement de l’école italienne qui repose sur la co-intervention et le travail d’équipe a été touché : la précarité des postes d’enseignantE de soutien, le manque de formation, le nombre insuffisant d’heures allouées à chaque enfant et le défaut de synergie avec les autorités administratives locales font partie comme en France des limites posées à la politique inclusive. Mais grâce à l’action syndicale et une saisine auprès de la Cour européenne en 2015, l’Italie vient d’être traduite devant la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas avoir mis fin à l’utilisation excessive de contrats à durée déterminée et à des conditions de travail discriminatoires dans l’enseignement.
Il existe également des disparités géographiques importantes, certaines régions n’attribuant pas la totalité des moyens alloués au handicap.
On n’échappe pas non plus à la persistance de représentations archaïques liées aux images véhiculées par la « malformation », la « folie », les « anomalies ». L’influence chrétienne est également déterminante en ce qu’elle charrie de représentations associées à une « faute » ou qu’elle renvoie à des actions de « charité ».
L’autre écueil est que l’école italienne, si elle a mis l’accent historiquement sur la scolarisation des élèves en situation de handicap en y allouant des moyens importants, a négligé l’ensemble des élèves à BEP, qui n’ont été reconnuEs qu’en 2010 et ont pu être scolariséEs dans des classes spécialisées jusque dans les années 90, comme c’est encore le cas en France pour les élèves scolariséEs en Segpa. Aujourd’hui elle distingue trois situations : les personnes porteuses de handicap, les personnes avec des troubles spécifiques d’apprentissage comme les porteurEuses de troubles dys et les élèves avec des besoins spécifiques comme les enfants migrantEs. Pour chaque catégorie d’élèves les moyens alloués et les accompagnements ne sont pas équivalents. Par exemple, unE enseignantE de soutien n’intervient pas auprès des élèves dys. On peut dire que l’école italienne n’a pas terminé sa mue vers une école véritablement inclusive et qu’elle n’est pas encore adaptée à touTEs les élèves.
Enfin la politique inclusive n’est efficace que jusqu’à la fin du collège et montre qu’elle n’est pas associée à un véritable projet de société. Comme en France, au lycée général on retrouve un environnement élitiste non favorable aux élèves en situation de handicap, qui sont majoritairement orientéEs vers des filières technologiques et professionnelles. Plus grave, sur l’ensemble des personnes handicapées en âge de travailler, seulement 12% ont accès à l’emploi (indicateurs démographiques pour l’année 2022 publiés par l’Istat le 7 avril 2023). Une famille avec au moins une personne handicapée reçoit en moyenne un revenu moyen équivalent de 19 500 euros par an, soit 1000 euros de moins que les familles sans personnes handicapées. Les familles devant assurer les dépenses de soin et d’assistance, cela a pour conséquence que sur l’ensemble des personnes handicapées, 32,1 % sont menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale et environ un cinquième se trouvent dans des conditions de privation matérielle sévère.
Si l’élève handicapéE bénéficie d’une école inclusive en Italie, l’adulte lui ne connaîtra donc pas une société inclusive. Le modèle italien met en évidence l’opposition qui existe entre avancées progressistes et politiques libérales, celles-ci pouvant réduire à néant des avancées structurelles en termes éducatifs. Il nous rappelle que le combat pour une éducation pour touTEs est sans relâche et que céder sur ce principe et exclure de facto des catégories d’élèves, c’est céder au système capitaliste.
Au-delà, le modèle italien met l’accent sur la nécessité d’une prise en charge globale avec une répartition des missions bien définies entre le secteur médical, le secteur social et le champ scolaire. L’accessibilité à l’école est assurée à la fois par l’intervention de personnels nombreux et formés, animés par des valeurs inclusives bien ancrées, du matériel et des manuels adaptés, des pratiques réfléchies en équipe et des classes à petits effectifs. Les moyens restent donc une question centrale dans la réussite d’une politique inclusive.
Bibliographie
- Apprendre (dans) l’école inclusive, Ife n°127, Janvier 2019, par Catherine Reverdy
- L’école inclusive, des objectifs communs et des modalités différentes en Europe, Marcel Calvez, 2ème journée d’études du Cra Bretagne, Université Rennes 2, Novembre 2018.
9 - Associations gestionnaires : kesako ?
La fédération SUD éducation donne la parole aux collectifs de militantEs antivalidistes.. Ce sont donc leurs positions qui sont retranscrites dans cet article. Il s’agit pour nous de visibiliser la lutte des personnes concernées afin de mieux comprendre et débattre autour des concepts d’inclusion, d’accessibilité à l’école comme dans la société.
SUD éducation a interrogé Elena Chamorro au sujet de l’épineuse question des associations gestionnaires, institutions françaises qui, par une délégation de mission de service public « gèrent le handicap en France ».
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Elena Chamorro. Je suis professeure agrégée d’espagnol et j’ai fait presque toute ma carrière comme PRAG, au sein d’Aix-Marseille Université.
Par ailleurs, directement concernée par le handicap, j’ai cofondé en 2016 le Clhee (Collectif luttes et handicap) que j’ai quitté en 2024. C’est un collectif de lutte antivalidiste.
Actuellement, je milite au CUSE (Collectif Une Seule École), un collectif récent qui se bat pour la scolarisation inconditionnelle de touTEs les enfants dans l’école ordinaire.
Je suis aussi syndiquée à SUD éducation.
Peux-tu définir ce qu’est une association gestionnaire ?
En France, dans le domaine du handicap, il existe des petites associations mais aussi des grosses structures qui gèrent de nombreux services et établissements financés par l’État. C’est parce qu’elles gèrent ces services et structures qu’elles sont appelées associations gestionnaires.
Les plus importantes parmi ces associations sont reconnues par l’État comme les représentantes légitimes des personnes handicapées. À ce titre, elles sont présentes dans toutes les instances relatives au handicap et elles sont consultées pour tout projet de texte en lien avec le sujet.
Quelles sont les principales associations gestionnaires ?
L’APF France handicap, L’UNAPEI, La LADAPT, l’APAJH sont parmi les plus importantes.
Sont-elles comparables ?
Elles affichent toutes les mêmes objectifs, soi-disant l’inclusion sociale et la défense des droits des personnes handicapées mais elles s’adressent à des publics différents.
L’UNAPEI, par exemple, s’adresse à des personnes avec troubles du neuro-développement (déficience intellectuelle, autisme…), polyhandicap ou handicap psychique et c’est un réseau d’associations qui comprend des associations familiales, des associations mandataires judiciaires à la protection des majeurs. L’APF s’adresse plutôt à des personnes qui ont des handicaps physiques, moteurs…
Elles sont cependant comparables quant aux valeurs catholiques qui ont inspiré leurs fondateurICEs et qui sont encore bien inscrites dans leur ADN. L’APF, par exemple, a été fondée par André Trannoy qui avait grandi dans une famille très catholique. Même dans le milieu de Stanislas, à Paris, où il avait poursuivi sa scolarité, il était perçu comme un « mystique ». Suzanne Fouché, l’une des fondatrices de la LADAPT avait, elle, une vision rédemptrice de la maladie, qui était pour elle un chemin vers Dieu. Les deux associations ont organisé par le passé des quêtes pour lesquelles elles comptaient avec le soutien et l’aide du Secours catholique et sur la société saint Vincent de Paul.
L’appel à la charité est toujours d’actualité et l’APF, par exemple, finance de nombreuses actions grâce à ce qu’elle appelle la générosité du public. En général, la mainmise historique des milieux catholiques les plus conservateurs sur le handicap se poursuit de nos jours et inspire l’approche du handicap de la grande majorité de ces associations et des politiques du handicap auxquelles elles participent. Par exemple, la première visite de la première secrétaire d’État aux personnes handicapées du gouvernement Macron, Sophie Cluzel, s’est déroulée dans une « maison partagée » gérée par l’association Simon de Cyrène qui promeut des valeurs charitables et de fraternité chrétienne et a été soutenue par, entre autres, Philippe Pozzo di Borgo, Jean Vanier, fondateur de l’Arche et Laurent de Cherisey, tous de fervents catholiques.
C’est le cas aussi des Café Joyeux, qui disent employer des personnes avec des handicaps cognitifs en emploi ordinaire mais qui sous-traitent l’élaboration de leurs capsules à des Esat. Son fondateur, Yann Bucaille est proche aussi des milieux de la Manif pour tous. Pour rappel, Emmanuel Macron s’était rendu à l’inauguration de l’un de ces cafés sur les Champs Élysées en 2020 et pour la petite histoire, cette entreprise a été lauréate en 2019 du Voyage du bien commun, un événement qui avait réuni deux cents entrepreneurEuses et plusieurs évêques à Rome et au cours duquel, le Pape avait demandé aux patronNEs français de mettre en œuvre les valeurs évangéliques dans leurs entreprises, de sauver ce monde avec le Christ, d’éduquer le monde du travail à un style nouveau et de participer aux décisions politiques. Et dans ce but de mise en œuvre des valeurs évangéliques, le « monde du handicap », comme ils disent, fait partie de leurs cibles de prédilection.
Il va de soi que ces approches charitables sont contraires aux approches des droits humains défendues par les militantEs antivalidistes. D’ailleurs, parmi les slogans les plus revendiqués par les activistes du monde entier figure Rights, no charity, des droits, pas de la charité.
Quelles sont les structures gérées par ces associations ?
L’APF gère des structures spécifiques comme les foyers d’hébergement et foyers de vie (Fam), IME (institut médico-éducatif), des Sessad (services d’éducation et de soins à domicile), des Mas (maisons d’accueil spécialisé), des Esat (établissements ou services d’aide par le travail), des entreprises adaptées. L’APF gère en tout 483 structures d’accompagnement.
L’Unapei gère aussi des Itep (instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques). En tout, elle gère 3 000 établissements et services médico-sociaux.
Toutes ces structures composent le secteur du médico-social.
Pour ce qui est des Sessad, un camarade du Cuse, pointait récemment sur Twitter que les associations gestionnaires détournent à présent ces dispositifs de leurs objectifs initiaux et recrutent, au lieu d’accompagner vers l’autonomie les élèves qu’ils et elles suivent, des enfants dans l’école ordinaire pour les envoyer en IME.
On voit vraiment leur propension à prioriser l’institutionnalisation, leur désir de la perpétuer, y compris sous des formes nouvelles comme l’habitat partagé. Et leur désir aussi de l’élargir avec des « nouveautés » telles que les Esat en prison.
Quels sont les liens entre l’État et les associations gestionnaires ?
Les associations gestionnaires sont des partenaires de l’État. Elles ont un rôle de délégation de service public. Elles ont la responsabilité, comme je l’ai dit, de la gestion des établissements et services pour personnes handicapées et elles co-construisent, comme je l’ai aussi évoqué, les politiques du handicap. Elles siègent et ont une voix dominante dans des instances de concertation comme le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées), elles participent aux travaux des commissions dans les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées), notamment à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui décide de l’attribution des droits et des prestations, et des orientations pour les personnes handicapées – éventuellement vers les structures, bien évidemment. Elles siègent également dans les commissions rattachées aux ARS et contribuent à l’élaboration des programmes de santé ou de planification de l’offre du médico-social.
Elles sont partout, sont toutes-puissantes et gèrent absolument tous les aspects de la vie des personnes handicapées.
Les liens entre les associations gestionnaires et l’État sont en fin de compte des liens de subordination à ce dernier. Les derniers reculs en matière de droits se sont d’ailleurs faits avec la complicité des associations gestionnaires. Par exemple, en 2014, l’APF a accepté les reculs des règles d’accessibilité que le gouvernement a fait passer par voie d’ordonnance. L’APF a aussi accepté le principe d’un quota de logements accessibles à l’occasion de l’examen de la loi ELAN en 2018 en lieu et place du 100% accessible pour le bâti neuf que prévoyait la loi de 2005.
Elles protestent timidement contre ces reculs mais loin d’être un contre-pouvoir, elles sont inféodées à l’État, de qui elles dépendent financièrement.
Pourquoi cette délégation de service public en France ?
Les principales associations naissent dans les années 1940 – 1950 pour créer des structures et des services.
La délégation de la gestion des établissements pour personnes handicapées aux associations gestionnaires en France remonte à l’après Seconde Guerre Mondiale. Comme l’explique Capucine Lemaire dans sa contribution à l’ouvrage « En finir avec les idées fausses sur le handicap », publié par les éditions de l’Atelier :
« C’est avec la création de la sécurité sociale que l’âge d’or des « gestionnaires » est proclamé, puisqu’une délégation est donnée par l’État à ces associations pour créer des institutions, afin de prendre en charge les différents handicaps. L’installation massive dans les années 50 et 60 dans toute la France d’établissements remplace l’hospice ou l’asile.
On parle alors de « lieux ouverts » par rapport à l’enfermement hospitalier. »
Les budgets alloués par l’État sont importants et avec l’épidémie de poliomyélite antérieure aiguë qui sévit jusqu’en 1958 (date de l’arrivée du vaccin) beaucoup d’enfants arrivent dans ces lieux.
Ensuite, la loi du 30 juin 1975 reconnaît officiellement le rôle des associations dans la création et la gestion des établissements spécialisés.
L’État et les collectivités locales ont donc confié cette mission aux associations qui bénéficient de financements publics mais qui conservent une certaine autonomie. C’est une forme de désengagement de la part de l’État, justifiée par la reconnaissance d’une expertise dans le domaine du handicap à ces associations.
Quels problèmes posent les associations gestionnaires pour les personnes handicapées ? Pourquoi les associations gestionnaires constituent-elles un frein à l’émancipation des personnes handicapées ?
Les militantEs antivalidistes tiennent les associations gestionnaires pour responsables de leur ségrégation sociale et spatiale.
Le choix de l’institutionnalisation, autrement dit de l’enfermement, a eu et continue d’avoir des répercussions sur le manque d’accessibilité de l’espace public, et il est aussi au fondement de la justification de notre exclusion de la société puisque le raisonnement qu’il impose est que, s’il existe des lieux réservés, vendus comme étant des lieux adaptés pour nous, pourquoi ne pas nous y renvoyer plutôt que de nous accueillir dans l’école ordinaire, dans le travail ordinaire, etc…
Mais au-delà de l’institutionnalisation, les associations gestionnaires sont responsables de l’existence d’une culture validiste au sein de la société qui, de fait, se traduit par ce que j’appelle « l’institutionnalisation hors les murs » ou « l’institutionnalisation de plein air ».
Quand on va dans un centre quelconque qui propose des loisirs, on ne pourra souvent pas y accéder en tant que particulierE. Les activités seront prévues pour des groupes ; lorsqu’on va dans un théâtre, une salle de spectacles, on ne pourra pas se placer avec les amiEs ou la famille qui vous accompagnent mais avec unE seulE « accompagnateurICE ». On sera placéEs, concentréEs, ségréguéEs avec d’autres personnes handicapées que l’on ne connaît pas parce que le théâtre en question aura été conçu pour que cela soit ainsi. Tout le « dirigisme » que l’on rencontre dans les politiques à notre égard des établissements et services de toute sorte vient de cette culture validiste de la ségrégation, cette culture validiste qui, au nom d’une prétendue protection entrave nos choix, nos décisions, nos libertés individuelles partout tout le temps.
Pour en revenir à l’institutionnalisation proprement dite, dans les murs, celle mise en œuvre par les associations gestionnaires, elle est évidemment contraire à nos droits. L’observation n° 5 de l’ONU qui date de 2017 et qui explicite l’article 19 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées, précise que l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société supposent un cadre excluant toute forme d’institutionnalisation.
En réalité, ces associations, loin d’œuvrer à la défense de nos droits sont une entrave à l’accès à nos droits.
À cet égard, les observations du comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, qui ont fait suite au rapport initial de la rapporteuse spéciale de l’ONU Catalina Devandas après sa visite de 2017, font état de la confusion qui existe en France entre les associations prestataires de services et gestionnaires d’établissements et les associations représentatives des personnes handicapées. Cette confusion entraîne un conflit d’intérêts qui empêche le passage de la vie en institution à la vie autonome au sein de la communauté, avec le soutien nécessaire. Mme Devandas s’était montrée inquiète que l’institutionnalisation des personnes handicapées, contraire au droit international, soit privilégiée en France.
Enfin, le Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a récemment publié son Observation générale n°1 sur l’article 4 du Protocole facultatif relatif aux lieux de privation de liberté. Il a clairement indiqué que les personnes handicapées souffrent de privation de liberté dans les institutions. En plus, comme le rapportait l’association ENIL, le sous-comité fait valoir que la privation de liberté ne concerne pas uniquement l’enfermement physique, mais aussi les conditions dans lesquelles les personnes handicapées sont contraintes de vivre. Par exemple, si les personnes handicapées ne peuvent quitter leur domicile du fait d’un manque d’offre de soutien, cela doit être considéré comme une privation de liberté.
En privilégiant l’institutionnalisation au détriment de l’offre de services en dehors des établissements, ces gestionnaires portent aussi donc la responsabilité d’une privation de liberté « hors les murs ».
Et il faut surtout savoir que l’institutionnalisation ne peut pas être un choix, contrairement à ce qu’affirment les associations gestionnaires.
L’institutionnalisation ne doit jamais être considérée comme une forme de protection des personnes handicapées, ou un « choix » comme le précisent les lignes directrices sur la désinstitutionnalisation qui complètent l’Observation générale n° 5 de 2017 que j’ai mentionnée auparavant.
Ces lignes directrices ont aussi fait état d’un problème majeur qui est celui de la violence, la négligence, les abus, les mauvais traitements et la torture, y compris les contraintes chimiques, mécaniques et physiques, que les personnes handicapées subissent dans les institutions.
Quelles représentations des personnes handicapées portent les associations gestionnaires ?
Les associations gestionnaires sont surtout dans une approche médicale et paternaliste du handicap. Elles mobilisent le discours de la protection pour justifier l’institutionnalisation.
Pour le modèle médical, le handicap est une déviation de la norme biologique et c’est la logique de ce modèle qui a conduit à écarter les personnes handicapées de la société et à les institutionnaliser. Dans ce modèle, le rôle principal dans les choix de vie est donné aux professionnelLEs.
On parlait tout à l’heure de LADAPT. Il faut savoir que c’est cette association qui, en 1954, fonde les premiers ateliers protégés et les premiers CAT (centres d’aide par le travail), appelés à présent Esat (Établissement et service d’accompagnement par le travail).
Les ouvrier·ères d’Esat ont le statut de travailleurEUSEs handicapéEs. Cependant, ils et elles ne relèvent pas du code du travail, mais du code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils et elles sont considérés comme des usagerEs des établissements qu’ils et elles fréquentent. En 2022, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a rendu une critique détaillée du modèle des Esat et demandé au gouvernement de les éradiquer. Le comité ajoutait que « les environnements de travail ségrégués sont incompatibles avec [le] droit » inscrit à l’article 27.
Il y a peu, avec deux autres militantes antivalidistes, nous avons réagi à un communiqué de l’Union Fédérale de l’Action Sociale de la CGT. Ces syndicalistes de gauche s’inquiétaient de l’éventualité de l’octroi du statut partiel de travailleurEUSEs aux usagerEs d’Esat que l’on considère comme des usagerEs mais qui sont en réalité des travailleurEUSEs. La rhétorique infantilisante et paternaliste du communiqué laisse sans voix et force est de constater que les représentations émanant de l’approche médicale sont prégnantes y compris à gauche.
Pourtant, il a existé des mouvements de personnes handicapées qui, dès les années 70, le CLH (Comité de lutte des handicapés) notamment, ont dénoncé l’exploitation en CAT, la culture caritative des associations comme l’APF et qui avaient manifesté avec force contre la loi de 1975.
Malheureusement, la majorité des partis de la gauche ignorent ces luttes historiques pour la défense de nos droits, ignorent aussi les collectifs qui actuellement les ont reprises et leurs politiques ne voient pas d’incohérence à fréquenter les lieux de ségrégation dénoncés par l’ONU et gérés par des associations liées aux milieux catholiques les plus conservateurs. Ils relaient aussi allègrement les visions essentialisantes, infériorisantes, et plus généralement la culture validiste issue du modèle médical incarné par les associations gestionnaires.
Quel est l’avenir social des élèves qui sont institutionnaliséEs, orientéEs dans des Itep ou des IME par exemple ?
Dans un article qui a trait aux luttes des personnes handicapées, Cécile Morin dit que le placement dès l’enfance en institutions spécialisées conduit, par un effet de filière, à travailler une fois adulte dans des Esat selon des critères de rentabilité et de type de handicap établis par les professionnelLEs du secteur, autrement dit à présent par, entre autres, les associations gestionnaires qui siègent dans les MDPH.
Lili Guigueno, une autre militante handicapée, explique dans un article de son blog sur Médiapart que 30 % des travailleurs et travailleuses handicapéEs des Esat viennent des instituts médico-éducatifs (IME) dont les Instituts médico-professionnels (IMpro) et que 30 % vivent ségréguéEs en institutions, dans des hébergements réservés aux travailleurs et travailleuses handicapéEs.
J’avais fait un tweet il y a quelque temps dans lequel je comparais l’emploi du temps en IME et l’emploi du temps dans un établissement scolaire. Il faut quand même rappeler à toutes celles et tous ceux qui présentent l’IME comme une alternative à l’école que celui-ci n’est pas un lieu de scolarisation, d’apprentissage et que de ce fait, les IME ne dépendent pas de l’Éducation nationale. Leur gestion et leur financement dépendent de la Sécurité sociale. Et à celles et ceux qui mettent en avant le besoin de soins des enfants handicapéEs, il faut rappeler que ces enfants sont des sujets de droits et non pas des objets de soin et que la scolarisation avec les autres n’est pas incompatible avec la prise en compte des soins dont ils et elles auraient besoin.
En fait, les IME sont des lieux de dis-émancipation et conduisent à la ségrégation à vie et à la mort sociale. Un lieu qui vous prive d’instruction, qui ne vous fait pas grandir ne peut pas être un lieu d’émancipation, mais un lieu d’entraînement à la soumission à vie, un lieu de désempuissancement.
Une fois entréE dans la filière de la ségrégation, il est très difficile d’en sortir.
Le rapprochement associations gestionnaires /école (ouverture d’UEE ou d’UEMA par exemple) est-elle une solution pour désinstitutionnaliser ?
Je connais mal ces dispositifs et je ne m’aventurerai pas à faire un programme de désinstitutionnalisation dans le cadre de cet entretien. Ce qui est clair est que la solution pour aboutir à une école pour touTEs passe par la volonté d’un changement de paradigme, par le passage d’une école du tri – le validisme en opère un – à une école pour touTEs les élèves.
Ce qui est clair aussi est que d’autres pays ont avancé dans cette direction et qu’ils ont mis en place des pratiques éducatives dont nous pouvons nous inspirer.
10 - Tribune du collectif une seule école (CUSE) : La loi 2005, 20 ans après
La fédération SUD éducation donne la parole aux collectifs de militantEs antivalidistes.. Ce sont donc leurs positions qui sont retranscrites dans cet article. Il s’agit pour nous de visibiliser la lutte des personnes concernées afin de mieux comprendre et débattre autour des concepts d’inclusion, d’accessibilité à l’école comme dans la société‧
Il n’est pas facile de faire le bilan d’une loi et de ses conséquences concrètes pour les personnes handicapées quand elle est promulguée dans un pays incapable d’affronter les discriminations systémiques qu’il produit et de faire du handicap un sujet politique et non plus seulement médical. Si la loi de 2005, très imparfaite, a pu être perçue comme un progrès, son bilan met aussi en évidence la manière dont les actrices et acteurs institutionnelLEs ont pu la détourner, la déformer et produire, en se cachant derrière des termes vidés de sens comme l’inclusion, des privations de liberté et des violences, au sein du système scolaire comme dans l’ensemble de la société.
Quand des discours politiques et académiques prennent les mots sans la chose (inclusion, émancipation, autonomie).
Quand des personnels sont convaincus que les élèves handicapéEs n’ont pas leur place dans les écoles, les collèges et les lycées et veulent sans cesse le démontrer.
Quand les associations gestionnaires rapaces sont prêtes à récupérer ces élèves pour les enfermer et en tirer un maximum de profit.
Quand des organisations politiques et syndicales qui se prétendent émancipatrices et/ou de gauche décident que les luttes contre les discriminations et les oppressions s’arrêtent aux personnes handicapées.
Quand toute une société validiste trouve normal de priver de droits, de parole politique, de scolarité et de liberté des enfants puis des adultes dans des institutions parce que handicapéEs.
Le constat est plus acide qu’un citron mais il est nécessaire !
La loi du 11 février 2005 dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » promettait l’accessibilité de l’ensemble de la société aux personnes handicapées. La loi de 1975 promettait déjà l’accessibilité, mais, sans réelle volonté politique et sans échéance, elle est restée sans effet.
La loi de 2005 semblait porter un changement de paradigme : la bascule d’un modèle médical du handicap vers un modèle social. Elle confirmait l’obligation d’accessibilité des lieux accueillant du public, des transports publics et des logements, obligation immédiate sur le neuf et avec un délai de 10 ans jusqu’en 2015 pour l’ancien, pour les établissements recevant du public (ERP) et les transports. Elle remplaçait les Cotorep et CDES par les MDPH censées faciliter la vie des personnes handicapées en simplifiant les démarches administratives et en réunissant l’ensemble des acteurs au sein d’un guichet unique. Elle instituait un droit à compensation via la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle affirmait enfin le droit de chaque enfant à pouvoir être scolariséE, comme les autres, dans son école, son collège ou son lycée, au plus proche de son domicile.
Ce qui pouvait apparaître comme de réelles avancées pour les droits des personnes handicapées posait pourtant déjà de nombreux problèmes dans la rédaction même de la loi.
D’abord dans le lien avec la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme qui affirment l’égalité des droits et des chances des personnes, qu’elles soient handicapées ou non. La nécessité de rédiger une loi spécifique pour les droits des personnes handicapées montre que les personnes handicapées sont considérées en France en dehors du reste de la société quand elles devraient pouvoir jouir des mêmes droits humains.
Ensuite, la loi de 2005 ne donnait pas une définition du handicap conforme à la définition internationale de la Convention ONU des droits des personnes handicapées. Le Guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (1993) issu de la CIH (Classification internationale des déficiences, incapacités, désavantages), n’est pas remis en question. Il a juste été amélioré en 2007 par un nouveau décret intégrant les notions de la CIF (Classification internationale du fonctionnement). La CIH avait pourtant été abandonnée depuis les années 2000 par l’ensemble des pays développés – à l’exception de la France – parce qu’elle se centre sur les incapacités des personnes et non sur l’inaccessibilité de la société. Les classifications sont des outils de connaissances des incapacités et déficiences et pas des outils pour apprécier les besoins de compensation des handicaps. De ce point de vue encore, on mesure de quelle manière la loi de 2005 a une vision encore ancrée dans le trop restreint modèle médical du handicap au lieu de changer de paradigme pour aller vers le modèle social du handicap.
Enfin, la loi de 2005 ne remettait pas en question le rôle des associations gestionnaires, bien au contraire. Celles-ci ont besoin d’une société inaccessible et validiste. C’est la condition au maintien de leur fonds de commerce basé sur une approche purement économique contraire aux droits humains : les structures ségrégatives où les personnes handicapées, victimes d’un validisme systémique massif, sont enfermées une fois exclues de leur école, de leur famille, du travail ou de la société en général. Parler d’accessibilité en réaffirmant le rôle central des associations gestionnaires dans la gestion du handicap en France, c’est donc évidemment tuer la loi dans l’œuf. L’un ne peut aller avec l’autre. Les associations gestionnaires parlent à la place des personnes concernées. Les personnes handicapées ne sont pas écoutées, elles n’ont pas la parole et ne décident pas pour elles-mêmes. Un exemple parmi d’autres : en 2014, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) mandate le président de l’UNAPEI, association gestionnaire d’établissements ségrégatifs pour personnes handicapées, pour rédiger un rapport sur l’inclusion. L’une des plus grosses associations gestionnaires a tout intérêt à maintenir le système français tel qu’il est : le gâteau à se partager est de 20 à 25 milliards d’euros annuellement. Son discours n’a pour but que de protéger les institutions et les intérêts financiers des établissements, biberonnés à l’argent public. Le résultat était en profond décalage avec les standards internationaux, sans remise en question du modèle médical.
Il est important de noter que le gouvernement fait semblant de tenir compte du dernier rapport du comité des droits de l’ONU de septembre 2021 à l’instar du CNCPH qui prétend s’être réformé en assurant la présence d’une majorité d’associations représentatives des personnes handicapées au sein d’un collège dédié mais on y retrouve par exemple l’APF, organisation gestionnaire qui ne répond absolument pas aux critères de l’observation générale n° 7 de l’ONU.
Si la loi, dans sa rédaction même, pose un certain nombre de problèmes, il faut également conscientiser que la loi a de plus été détournée par ordonnances (école, emploi, accessibilité des bâtis…).
L’application de la loi et la manière dont la société française se l’est appropriée participent à la perpétuation du modèle médical.
Le handicap reste perçu comme un problème de santé, une particularité individuelle attachée à la personne, et qui pense les personnes handicapées comme étant exclusivement des objets de soins, maintenues dans la dépendance des services parallèles et dans des espaces de vie réservés. Elle n’a pas permis d’opérer le changement de paradigme, qu’elle disait pourtant porter, vers un modèle social du handicap, modèle dans lequel le handicap n’est plus envisagé comme la caractéristique d’un individu mais comme la conséquence d’un environnement qui fait obstacle à la participation sociale, modèle dans lequel le handicap n’est pas strictement un problème de santé, mais aussi une question de société. Centrer le sujet sur l’incapacité des personnes détourne des questions systémiques indispensables à construire le handicap comme sujet politique.
Le bilan, vingt ans après la proclamation de la loi, est sans appel. Pour les personnes handicapées, pas de droits effectifs à la scolarité, pas de vie autonome, un chômage structurel, une exclusion massive du droit commun et une inaccessibilité encore trop généralisée, donc excluante de la société (logement, transport, travail, culture, sport, loisirs…). Et cela commence dès l’enfance avec, si ce n’est pas une déscolarisation totale et un enfermement en institution ségrégative, une scolarité tellement partielle et empêchée qu’elle aura des conséquences sur la vie entière des personnes concernées.
Face à l’inefficacité de la loi, des collectifs des personnes handicapéEs se sont constitués et militent pour l’application de la CIDPH et contre les associations gestionnaires.
Plusieurs associations non gestionnaires d’établissements et des collectifs de militantEs handicapéEs se sont mobilisés dans les années qui ont suivi le vote de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005. Leurs luttes ont été des réponses aux tentatives – plutôt réussies – des gouvernements successifs de revenir sur les faibles avancées de la loi en matière d’égalité des droits.
En février 2014 voit le jour à travers une page Facebook un collectif éphémère, le “Collectif Non au report de 2015”. Ils se présentent comme un groupe de citoyenNEs handicapéEs sans attache politique ou associative et affirment s’être réuniEs pour s’opposer au projet de réforme du volet accessibilité de la loi de 2005. Le gouvernement prévoyait d’adopter un report visant à donner aux équipements publics ou privés qui adhéreraient au dispositif des Ad’AP (agendas programmés d’accessibilité) des délais supplémentaires de 3, 6 à 9 ans pour effectuer les travaux de mise en accessibilité. L’adhésion aux Ad’Ap leur permettrait également d’échapper aux sanctions pénales prévues par la loi de 2005, suspendues durant toute la durée des travaux.
En parallèle en mars 2014, Odile Maurin qui avait rejoint l’APF en 2013, lance des mobilisations basées sur la désobéissance civile (blocage et occupation de bâtiments de l’État, opérations péages gratuites, …) pour s’opposer à l’ordonnance accessibilité mais la direction de l’APF fera son maximum pour saboter ces mobilisations puis exclura Odile Maurin de l’APF, ce qui a permis ensuite à celle-ci de découvrir les luttes anti validistes via le CLHEE, des luttes qu’elle-même et Handi-Social, son association retrouvée, rejoindront.
De février 2014 jusqu’à l’adoption par ordonnance du report de la loi en septembre 2014, puis la ratification de l’ordonnance accessibilité en août 2015, le collectif Non au report de 2015 écrit des textes sur leur page Facebook pour dénoncer notamment la complicité des gestionnaires dans le projet de loi, se mobilise de diverses façons allant des actions coup de poing jusqu’à différentes campagnes d’activisme via les réseaux sociaux dont ils et elles sont les précurseurEs en tant que collectif de personnes handicapées.
Leur mobilisation s’est poursuivie au-delà de 2014. En 2016, certainEs de ses membres créent le CLHEE (Collectif Lutte et handicaps pour l’égalité et l’émancipation), un collectif qui affiche clairement son opposition aux associations gestionnaires et le premier collectif de personnes handicapées en France à se réclamer de la lutte antivalidiste et intersectionnelle.
En 2018, le CLHEE dénonce la loi ELAN qui a divisé par cinq la production de logements accessibles et constitue un net recul en matière d’accessibilité au logement. C’est l’APF, association gestionnaire qui, complice du gouvernement, a aidé à diviser la production de logements et proposé le terme de “logements évolutifs” pour qualifier des logements inaccessibles.
En parallèle du vote de la loi ELAN, en partenariat toujours avec des associations gestionnaires, le gouvernement Macron développe des formules telles que les “habitats partagés”, les ”logements inclusifs”, qui ne sont en somme que des nouvelles modalités d’institutionnalisation, comme le soulignent les rapports onusiens qui ont évalué les politiques du handicap en France.
En 2018 également, le tribunal correctionnel de Toulouse, lors d’un procès que les militantEs de Handi-social avaient qualifié de « procès de la honte » en raison de problèmes d’accessibilité et du traitement indigne qui leur avait été réservé, a prononcé pour quinze des inculpéEs des peines de prison avec sursis pour les actions de désobéissance civile non-violentes qu’ils et elles avaient menées. Il s’agissait notamment du blocage d’un TGV en gare Matabiau à Toulouse pour réclamer sa mise en accessibilité, après des années de promesses non tenues, et du blocage des pistes de l’aéroport de Blagnac pendant une heure, pour dénoncer la loi Elan.
S’il est clair que cette loi a globalement peu amélioré les conditions de vie des personnes handicapées, qu’elles restent toujours aujourd’hui exclues de la société et du droit commun, reléguées dans des espaces séparés, qu’en est-il plus précisément concernant la scolarisation ? La loi de 2005 est souvent présentée comme un accroissement des droits des élèves handicapéEs à l’éducation. Il est également souvent écrit que ce droit avait déjà été affirmé par la loi du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Rien n’est plus faux. Les lois de 1975 déléguaient aux associations gestionnaires la prise en charge des personnes handicapées en France. Elles réaffirmaient l’institutionnalisation comme modèle lorsque, au même moment, dans d’autres pays (Suède ou Italie par exemple), on s’intéressait aux droits humains et à l’égale dignité de tous les êtres humains en dépassant le vieux modèle médical et charitable pour le modèle social du handicap, outil bien plus politique et émancipateur.
La loi de 2005, malgré l’invocation d’une école inclusive par les gouvernantEs, ne s’attaquait pas à la tripartition classe ordinaire /classes spécialisées /établissements médico-éducatifs. Vingt ans après, le système demeure : les pouvoirs publics en France travaillent toujours à maintenir l’existence des IME et des Itep. Alors même que l’ONU ne cesse de la condamner sur ce point, la France campe sur sa position : la ségrégation des enfants et adultes handicapéEs est sa politique du handicap.
Le recours à la médecine pour trier et orienter les élèves demeure puissant et très peu remis en question, ce qui témoigne de la persistance du modèle médical en France. Ceci alors que le corps médical est lui-même peu formé aux handicaps. Les Commissions d’orientation vers les enseignements adaptés (CDOEA) pour l’orientation en Segpa et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui décident de l’orientation des jeunes en Ulis sont majoritairement constituées de professionnelLEs du médico-social et d’associations gestionnaires, et les personnes handicapées n’y ont pas la parole.
L’inclusion dans les établissements scolaires d’unE élève handicapéE est encore trop souvent conditionnée à la présence d’unE accompagnantE dont on connaît la précarité du statut qui demeure depuis bientôt 20 ans également. L’accompagnement par unE AESH (accompagnantE d’élèves en situation de handicap) est la solution très largement choisie pour permettre à unE élève handicapéE d’être scolariséE en milieu ordinaire. S’il peut être nécessaire, il reste aujourd’hui trop souvent le seul outil d’accompagnement et de compensation. Cela montre bien que nous avons du mal à sortir de la logique de compensation du handicap et à rendre accessible l’environnement pour entrer dans une approche sociale du handicap. Le principe des aménagements raisonnables consacrés par le droit européen et international n’est pas mis en œuvre. Les pratiques pédagogiques, les espaces de classe et les fonctionnements toxiques qui ont cours à l’école sont trop peu interrogés : notations/évaluations, normalisation des attitudes et conduites, élitisme, programmes et rythmes à suivre comme si l’école était une chaîne de production, mythe méritocratique.
Et lorsque les jeunes sont inclusEs dans les écoles, on constate que beaucoup trop d’entre elleux sont isoléEs du reste de la communauté éducative : isoléEs en Ulis parfois au fin fond de l’établissement, placéEs sous la « surveillance » constante d’unE AESH, elles et ils ont de trop rares contacts avec leurs pairEs et ne peuvent créer de liens qu’avec les autres élèves handicapéEs et avec les adultes qui les accompagnent. De ce fait, incompréhension, moqueries, peurs, rejets et exclusions des élèves handicapéEs restent une norme à l’école. La loi 2005 est à ce titre un échec : les préjugés à l’égard du handicap restent persistants, chez les élèves comme chez les adultes.
Beaucoup (plusieurs milliers mais aucun chiffre officiel précis) de jeunes restent aujourd’hui non scolariséEs et/ou n’ont pas d’accès à l’école. CertainEs sont à la maison, soit par absence de solution, soit par soumission à la logique de “tri” qui s’opère désormais à l’entrée des établissements spécialisés, ceux-ci cherchant à prendre en charge les enfants qui nécessitent le moins de moyens afin de rentabiliser au maximum leurs organisations. Quant à celles et ceux qui intégreraient des IME, Itep, Mas ou CEM, iels sont massivement déscolariséEs, perdent la sociabilité en étant éloignéEs de leur entourage et n’ont pas d’autres perspectives d’avenir que la vie en institution ségrégative où l’on ne choisit pas plus ses activités, que ses soignantEs, ses repas ou les personnes avec qui l’on souhaiterait vivre. En ne formant pas les enseignantEs et personnels scolaires, on organise une violence invisible à l’égard des enfants handicapéEs puis on s’étonne que leurs réactions puissent parfois être violentes. La violence originelle est le regard que trop d’enseignantEs portent sur elleux, couplé à l’absence d’adaptation du milieu scolaire au fonctionnement divers de ces enfants.
L’échec de la loi 2005 est institutionnel : en grande partie construit par les insuffisances politiques et hiérarchiques, mais également porté par les organisations syndicales, trop à la traîne sur les questions de validisme et de handiphobie.
Nous observons depuis plus de quinze ans des publications de textes officiels (circulaires, arrêtés, lois…) de plus en plus marqués par une rhétorique inclusive forte, à l’école comme dans la société en général mais, dans le même temps, nous constatons une école figée dans une organisation systémique qui continue d’exclure, de stigmatiser, de trier les élèves : les programmes, les constitutions de classe, les effectifs, les manques de formation des personnels, les évaluations des élèves (diplômantes ou non), les logiques d’orientations subies, les manques de moyens… Les injonctions paradoxales persistent, essentiellement parce que ces textes officiels sont construits avec les associations gestionnaires, seules interlocutrices des pouvoirs publics. L’objectif principal reste le maintien d’un système ségrégatif sans que les personnes handicapées elles-mêmes ne soient jamais associées pour construire ce qui les concerne au premier chef.
Il ne suffit pas de décréter l’école inclusive pour qu’elle soit pleinement mise en œuvre. Tout comme l’accessibilité, elle n’a jamais été une réalité. Pour opérer le tournant vraiment inclusif, une transformation et une déconstruction des représentations et un changement des pratiques sont nécessaires. Ces changements ne peuvent cependant pas reposer sur la seule bonne volonté de ceux et celles qui travaillent à l’école. Nous avons besoin de moyens et de formation. En ne développant qu’un discours injonctif, la hiérarchie provoque (sciemment ?) des réactions de rejet d’une partie de nos collègues, qui retrouvent dans la longue histoire séparatiste de l’école et du handicap en France un sentiment de sécurité. À croire que les intentions politiques sont de déclarer l’école inclusive pour très vite pouvoir constater qu’elle est impossible et que nous puissions repartir dans un récit totalement fantasmé d’une école républicaine faussement exigeante et méritocratique.
De fait, trop de collègues estiment encore que l’école devrait être un unique lieu de transmission, où des élèves normaliséEs devraient obéir, écouter, se taire et faire leurs devoirs à la maison. Les écueils relevant des conditions de vie, dont le handicap, ne sont pas pris en considération dans cette conception de l’élève idéalE auquelLE les enseignantEs pourraient déverser leur savoir sans avoir besoin de s’adapter.
Pire encore, mais plus fréquemment, le milieu social comme le handicap peuvent être mis en avant pour prouver une prétendue incapacité et exclure l’élève au plus vite du parcours ordinaire : orientation professionnelle, multi-exclusions, IME, etc.
C’est en cela que consiste en particulier le validisme : « un réseau de croyances, de processus et de pratiques qui produit un type particulier de soi et de corps (la norme physique) qui est projeté comme parfait, typique de l’espèce, et donc essentiel et pleinement humain. Le handicap est alors pensé comme un état inférieur d’humanité » (Fiona Campbell, spécialiste en études critiques du handicap). D’un point de vue validiste, étant considéréEs comme inférieurEs, moins capables, ces jeunes bénéficient de moins d’école, moins de droits, moins de relations sociales, moins d’autonomie. Elles et ils ne sont pas placéEs à égalité avec les autres jeunes.
Plus encore, les personnes handicapées sont toujours vues comme dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, ce qui justifierait leur exclusion et leur enfermement. C’est ce genre de discours que peuvent tenir certainEs collègues à propos de l’inclusion : élève qui mord, qui jette des chaises, qui frappe les autres. Et comme si ces situations étaient monnaie courante dans les établissements scolaires, et du seul fait des élèves handicapéEs : on n’interroge jamais les conditions qui ont amené cetTE élève à de telles réactions (mépris, harcèlements, exclusion). C’est en cela que consiste la handiphobie : du dégoût, de l’hostilité et du rejet sans complexe à l’égard du handicap.
Les organisations syndicales n’ont pas moins de responsabilités dans la permanence du validisme et de la handiphobie à l’école. Par le maintien de leurs appels à ouvrir plus de places dans les établissements spécialisés, les organisations syndicales entretiennent l’idée selon laquelle les enfants handicapéEs n’auraient pas leur place à l’école. Elles nourrissent l’idée d’un tri et d’une séparation des élèves dès lors que le critère est celui du handicap. Par leur incapacité à tenir les deux bouts de la lutte pour les conditions de travail des personnels et de la défense du droit à l’école pour toutes et tous, les organisations syndicales légitiment le rejet des élèves handicapéEs, considéréEs comme responsables d’une partie de la dégradation des conditions de travail des enseignantEs. Pour avancer dans la défense d’une école et d’une société réellement égalitaires et justes, donc non validistes, il est nécessaire que les organisations syndicales parviennent à construire des combats et des revendications où le souci des élèves, de leurs familles et le souci des personnels ne soient pas en opposition. Ce n’est que de cette manière que les luttes seront plus collectives, plus massives et permettront de gagner de nouveaux droits pour toutes et tous.
11 - Premières pistes de réflexions pour un syndicalisme accessible…
SUD éducation propose un petit “mémento” non exhaustif afin d’avancer dans nos pratiques militantes, sur l’accessibilité universelle de tous nos événements, productions, publications…
- Des locaux accessibles à touTEs
- Dans nos formulaires d’inscription (pour stages ou autres), penser à ajouter des lignes d’expression pour les besoins spécifiques des personnes (déplacements, accessibilité, lumières, alimentation…)
- En AG, aux CF, congrès, stages… utilisation du micro
- Prévoir des formes hybrides de nos événements (en présentiel ou en distanciel)
- Au-delà des questions démocratiques, être très attentifIVEs au respect des tours de paroles et au silence de celles et ceux qui ne parlent pas. Pour une personne malentendante, le brouhaha ou la confusion de deux ou trois voix qui parlent en même temps peut empêcher la compréhension et peut être très fatiguant
- Sous-titrer les vidéos
- Décrire les images sur les réseaux sociaux ALT (texte alternatif)
- Textes en FALC (Facile à lire et à comprendre)
- Normes RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité)
- Informer de l’accessibilité ou non en amont des évènements (accès du bâtiment, toilettes accessibles, places de parking…)
- Attention, pas de pdf image pour la lecture
- Masques à disposition dans nos locaux militants
- Attention au point médian pour l’écriture inclusive. Préférer les majuscules (ex : les élèves handicapéEs). Sinon, pour les personnes qui utilisent la lecture vocale, la lecture est très désagréable : « les élèves handicapé, point médiant, e ». Sur un texte entier, c’est infernal ! Ou bien, il faut proposer une lecture enregistrée des textes.
12 - Bibliographie
- Allezard, C. (productrice). (2022, 27 avril). Lutter ensemble contre le validisme (n°3) [épisode d’une série documentaire audio]. Dans Handicap : la hiérarchie des vies. France Culture.
- Baradji, É., & Filatriau, O. (2020, juillet). Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles et verbales. SSMSI, Interstats Analyse, 29.
- Blanquer, Z. (2022). Nos existences handies. Le Monstrographe.
- Bortone, C. (2006). Rouge comme le ciel [film]. Les Films du Préau.
Brégain, G. (2015-présent). Handicap, histoire et politique au XXème siècle [carnet de recherche en ligne]. Open Edition. - Calvez, M. (1994). Le handicap comme situation de seuil : éléments pour une sociologie de la liminalité. Sciences sociales et santé, 12(1), 61 – 88.
- Calvez, M. (2018, novembre). L’école inclusive : des objectifs communs et des modalités différentes en Europe. Dans 2e journée d’études du Comité scientifique et technique du CRA (Centre de Ressources Autisme) Bretagne : « École inclusive et TSA ».
- Campbell, F. A. (2001). Inciting legal fictions:« Disability’s » date with ontology and the ableist body of the law. Griffith L. Rev., 10, 42.
- Caraglio, M., & Gavini, C. (2018). L’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie.
- Carlos, M. (2020). Je vais m’arranger : comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées.
- Chamorro, E. (2017, 15 juin). #DecatholicisonsLeHandicap : À propos de l’exotique aventure Simon de Cyrène. Le Club de Mediapart.
- Chamorro, E. (2020, 2 août). Les racines de nos mots/maux. Le Club de Mediapart.
- Chamorro, E., Morin, C., & Guigueno, L. (2024, 28 mars). La lutte pour les droits des travailleurs·ses handicapéEs est encore devant nous. Contretemps.
- Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. (2021, 14 septembre). Observations finales concernant le rapport initial de la France.
- Cour des comptes. (2024, 16 septembre). L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
- Covelli, A., & Anna, L. D. (2020). La qualité de l’éducation inclusive en Italie. Le regard des enseignants en formation sur l’inclusion scolaire des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Alter. European Journal of Disability Research, (14 – 3), 175 – 188.
- Défenseur des droits. (2022, août). Rapport – Accompagnement humain des élèves en situation de handicap.
- Devandas-Aguilar, C. (2017, 13 octobre). Observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées.
- Douat, É. (2020). Handicapés et confinés en résidence universitaire : des étudiants oubliés, à l’épreuve de « la continuité pédagogique ». Alter, 14(3), 236 – 246.
- Ebersold, S., Plaisance, E., & Zander, C. (2016). École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours individuels. Conseil national d’évaluation du système scolaire-Cnesco, Conférence de comparaisons internationales.
- Ebersold, S. (2009). « Inclusion » Recherche & formation, n° 61(2), 71 – 83.
- Équipe du Rapport mondial de suivi sur l’éducation. (2020). Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 2020 : Inclusion et éducation : tous, sans exception. Unesdoc.
- Guigueno, L. (2023, 6 mars). Esat : l’exploitation institutionnalisée des travailleurs et travailleuses handicapéEs. Le Club de Mediapart.
- Kerroumi, B., & Forgeron, S. (2021). Handicap : l’amnésie collective : La France est-elle encore le pays des droits de l’homme?. Dunod.
- Lebrecht, J.,& Newnham, N. (2020). Crip Camp : La Révolution des éclopés [film documentaire]. Netflix.
- Lemaire, C., Pierre, C., Morin, C., Chamorro, E., Triguel, J., Maurin, O., Guy, R., Barnouin, S., Lagouje, S., A,F., C,B., G,M., L,C., & Lotis. (2023, 31 août). Tribune du Collectif Une Seule École (CUSE). Questions de classe(s).
- Martin, P., Félix, C., Filippi, P‑A., & Gebeil, S. (2020, 13 mai). L’école à distance à l’heure du déconfinement : Premier bilan. Le Café Pédagogique.
- Ministère de l’Éducation nationale. (2020). Regard international sur l’éducation inclusive.
- Morin, C. (2018, 20 décembre). Le travail comme terrain de luttes politiques des personnes handicapées : l’exemple des mobilisations en France dans les années 1968. CHLEE.
- Morin, C. (2021, 13 octobre). La lutte anti-validiste est une lutte d’émancipation. Mouvements
- Murphy, R. F., (1990). Vivre à corps perdu : le témoignage et le combat d’un anthropologue paralysé (traduit par Alexandre, P.). Plon. (Ouvrage original publié en 1987)
- No Anger [pseudonyme]. (2015-présent). A mon geste défendant : essais de théorisation antivalidiste à partir d’un corps [blog].
- ONU. (2017, 27 octobre). Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- ONU. (2022, 9 septembre). Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, adoptées à l’issue de la 27ème session du Comité.
- Petit, T. (2022). Handicap à vendre. Les Arènes
- Pichard, G. (2020, mars). « Dans mon lycée, 40 % des élèves n’ont pas accès à un ordinateur » : l’épidémie creuse les inégalités scolaires. Basta!.
- Puiseux, C. (2022). De chair et de fer – Vivre et lutter dans une société validiste. La Découverte
- Reverdy, C. (2019). Apprendre (dans) l’école inclusive. Dossier de veille de l’IFÉ.
- Rojas, E. (2020). Mister T et moi. Hachette
- Rojas, E. (2013-présent). auxmarchesdupalais… Un fauteuil, une robe, un combat [blog].
- Rosenczveig, J‑P. (2023, 19 février). L’Aide sociale à l’enfance à l’épreuve des chiffres. Droits des enfants. Le Monde.fr.
- Rouault, R., & Caro, P. (2019)., École et handicap. Un atlas des fractures scolaires en France. https://fracturesscolaires.org/ecole-et-handicap/#:~:text=handicap%C3%A9s%20%C3%A9taient%20scolaris%C3%A9s%20dans%20les,ULIS%20(%2B34%2C7%25).
- Rousseau, J. (2020, juillet). Derrière les cafés Joyeux, la galaxie catholique réactionnaire. Basta!.
- Van Gennep, A. (1981). Les Rites de passage, étude systématique des rites. Picard. (Ouvrage original publié en 1909)
- Ville, I., & les étudiantEs du séminaire Introduction à la sociologie du handicap. (2020, juin). Handicap et confinement : un dialogue dématérialisé. Dans Carnet de l’EHESS : perspectives sur le coronavirus. EHESS.
- Zeno, E., Lebrun, L., Simard, D., Gandy, J., Mercier, A., Rochoy, M., Lehmann, C., Limousin, G., Tanguy, S., Amouroux, T., Erissy, C., Grasset, J., Sellami, S., Marty, J., Somm, C., Valdes, M., Ribet Retel, C., Mas, A‑C., Maurin, O.,…Freymann, Y. (2024, 16 juin). La qualité de l’air intérieur, enjeu récurrent d’une vraie politique de santé publique. L’Express.
- Entretien de Elena Chamorro. (2019, juillet). Polysème.
- Histoire d’une école pas vraiment inclusive. (2022). Dans École, inclusion et handicap. Sud Éducation.
- [revue en ligne]. (2018-présent). Neurostyles.
- [site web]. (s‧d.). https://handidonnees.fr/
- [site web]. (2019-présent). http://lesdevalideuses.org/
SUD éducation remercie touTEs les auteurs et autrices de cette brochure, adhérentEs, militantEs, professionnelLEs, ou ex-professionnelLEs de l’éducation et les membres de la commission fédérale école inclusive de SUD éducation.