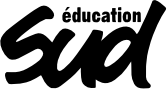Pour consulter la brochure n°92 - Changer l'école, pas le climat ! - cliquez-ici.
Le réchauffement climatique provoquant des dérèglements et phénomènes impactant de plus en plus visiblement le quotidien des Européen·nes, la notion de réfugié·es climatiques a été propulsée sur le devant de la scène ces derniers mois. Mais de qui parle-t-on quand on parle de réfugié·es climatiques ?
Cette terminologie a été utilisée et définie pour la première fois en 1985 par Essam El Hinnawi dans un rapport de l’ONU intitulé «Environment refugee » . Il définit alors les réfugié-es climatiques comme « des personnes forcées de quitter leur lieu de vie d’une façon temporaire ou permanente à cause d’une rupture environnementale (naturelle ou anthropique) qui menace leur existence et/ou affecte sérieusement leur qualité de vie. »
Si la notion de réfugié·e climatique ou environnemental·e contribue à alerter sur les conséquences du réchauffement, elle ne correspond toutefois à aucun cadre juridique international : le fait de devoir quitter son pays ou son lieu de vie à cause de la sécheresse ou d’inondation ou submersion n’ouvre à aucun droit ni aucune reconnaissance que ce soit.
Pour pouvoir bénéficier d’un statut de réfugié-e et des droits qui vont avec, il faut en effet entrer dans le cadre de la convention de Genève de 1951 qui définit un·e réfugié·e comme une personne craignant des persécutions ou étant persécutée en raison « de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
Actuellement, seules quelques jurisprudences donnent vie à ce qui pourrait être une nouvelle catégorie de réfugié·es. La première d’entre elles, rendue par la cour des droits de l’Homme de l’ONU, la jurisprudence Teitiota, qui tient son nom d’un habitant de l’archipel des Kiribati à qui la Nouvelle-Zélande avait refusé l’asile. Cette jurisprudence ne retient pas les facteurs environnementaux comme des facteurs ouvrant droit à l’asile mais introduit tout de même une obligation de non-refoulement de personnes confrontées à des conditions vie dégradées à cause du changement climatique. En France, en 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule l’obligation de quitter le territoire d’un ressortissant Bangladais sur la base de la pollution atmosphérique qui dans ce pays aggraverait l’état respiratoire du requérant. Ces décisions restent toutefois extrêmement marginales.
Le 19 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le texte reconnaît que « les phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres catastrophes liées au climat peuvent jouer dans l’incitation au déplacement et à la migration » mais rien de plus. De toute façon, rien que le nom du pacte en question indique qu’il s’agit là de limiter encore un peu plus la liberté de circulation et d’installation et donc de mener la guerre à toutes celles et ceux qui sont considéré·es comme des migrant-es indésirables.
Cette question des indésirables est fondamentale dans la réflexion que nous devons avoir autour de cette notion de réfugié·es climatiques ou environnementaux. En effet, créer une catégorie de plus, même si pour le moment elle n’a aucune existence juridique, n’est-ce pas participer à créer de nouveaux·elles exclu·es, les mauvais·es migrant·es, celles et ceux qui n’auraient aucune raison acceptable de s’installer ailleurs que là où ielles sont né·es ? Ou bien est-ce que créer une nouvelle catégorie de réfugié-es et réduire le nombre de personnes frappées du statut d’indésirables, celles et ceux qui sont catégorisé·es migrant·es ou migrant·es clandestin·es ? Que l’on adopte l’un ou l’autre des points de vue, l’un des combats politiques des syndicats de l’union Solidaire est la liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous et sur la question des migrations, ce combat nous devons toujours l’avoir en tête.
Régulièrement, des chiffres sont annoncés concernant le nombre de réfugié·es environnementaux dans les années à venir. On parle de 150 à 250 millions de personnes. En avril 2021, le HCR (Haut commissariat aux Réfugiés) estimait pour les 10 dernières années, à 21,5 millions par an le nombre de personnes contraintes de se déplacer de leur lieu de vie habituel en raison de phénomènes liés aux conditions météorologiques. Là encore, les mots sont importants. En effet, on parle là de personnes qui ont dû se déplacer, donc se réfugier ailleurs que là où elles vivaient, mais pas forcément dans un autre pays. Ces personnes ne sont pas considérées comme des réfugié-es mais comme des déplacé·es internes. Pour 2021, cela a représenté selon l’OIM (Office International des Migrations) plus de 59 millions de personnes. Quand pour alerter sur les conséquences des dérèglements climatiques sont mis en avant des chiffres de réfugié·es climatiques qui dans le futur ne cesseraient d’augmenter, les déplacé·es internes sont-ils/elles comptabilisé·es ?
En mettant en avant la notion de réfugié·es climatiques et en alertant sur des nombres de personnes perçues comme susceptibles de participer à des flux migratoires vers les pays occidentaux, il faut avoir en tête qu’on participe peut-être, même si c’est sans le vouloir et même si c’est dans l’objectif d’alerter sur les conséquences du réchauffement dû aux activités humaines, à instrumentaliser politiquement la question des migrations. Et dans un contexte de montée de l’extrême droite partout en Europe, c’est un jeu dangereux auquel il ne vaut peut être mieux pas participer... ou tout au moins en se posant la question.

Au-delà de ces questions, continuons à réaffirmer nos valeurs de justice sociale et environnementale en liant les deux dans nos luttes, dans notre quotidien, sur nos lieux de travail et nos lieux de vie. Continuons à nous battre pour un monde solidaire et sans frontières aux côtés de celles et ceux qui subissent ces frontières au quotidien : travailleur·euses sans papiers, mineur·es non accompagné·es exclu·es du droit à l’enfance et à la scolarisation, familles sans papiers, prisonnier·ères des centres de rétention… celles et ceux qu’on appelle migrant·es.