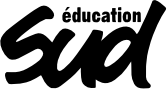Le soixantième anniversaire du 17 octobre 1961 est, cette année encore, placé sous le signe de la vérité et de la justice. La Fédération SUD éducation prend toute sa place dans cette double exigence qui passe par la reconnaissance du crime d’État et du massacre colonial qu’a été la répression féroce et meurtrière de cette manifestation pacifique de dizaine de milliers d’Algériennes et d’Algériens à Paris.
Pourquoi a eu lieu la manifestation du 17 octobre 1961 ?
En octobre 1961, la guerre d’indépendance algérienne dure depuis près de sept années.
Elle est marquée par la torture, les massacres et les assassinats des militantes et militants indépendantistes par l’armée française.
Revenu au pouvoir en 1958, De Gaulle cherche alors une issue à la guerre, contraint d’accepter l’auto-détermination du peuple algérien. Parce qu’ils la refusent, un quarteron de généraux tentent un putsch à Alger en avril 1961. L’Organisation armée secrète (OAS) a quant-à elle été créée en février de la même année par les « ultras » de l’Algérie française : organisation terroriste d’extrême droite, elle pratique meurtres racistes et attentats en Algérie comme en métropole. La violence colonialiste est à son comble.
Sur le territoire métropolitain, les populations immigrées nord-africaines, considérées globalement comme des soutiens du Front de libération nationale (FLN), sont la cible d’humiliations et de violences policières régulières et quotidiennes pouvant aller jusqu’à la mort. Le commissariat de la goutte d’Or dans le XVIIIe arrondissement est un des haut lieux de la violence policière. En cet automne 1961, on repêche de nombreux cadavres d’algérien·nes dans les canaux de région parisienne. Les historiens britanniques Jim House et Neil MacMaster évoquent l’existence de véritables « escadrons de la mort » composés d’activistes OAS et de policiers en dehors de leurs services.
La Préfecture de Police de Paris fiche les Algériennes et Algériens au sein d’un «fichier Z». Le 5 octobre un couvre-feu est décrété à l’issue d’un conseil interministériel présidé par le premier ministre, Michel Debré, qui interdit aux 150 000 «Français musulmans algériens» des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise (l’actuelle Île-de-France) de circuler après 20h.
Discriminatoire et raciste, ce couvre-feu est anti-constitutionnel.
Dans une telle situation, la Fédération de France du FLN décide de convoquer une démonstration de masse pacifique, bravant le couvre-feu au cœur de Paris, pour le 17 octobre.
Le déroulement de la manifestation et l’organisation du massacre
En soirée, de Nanterre, d’Argenteuil, les cortèges partent des bidonvilles dans lesquels vivent les travailleurs et travailleuses algérien·nes et leur famille pour converger vers les points de rendez-vous fixés en amont. C’est à l’Étoile et sur les Grands boulevards qu’ils et elles doivent se retrouver au nord, Boulevards Saint-Michel et Saint-Germain au sud. Pas même un canif n’est autorisé par le FLN.
C’est une foule désarmée de 30 000 à 50 000 personnes qui va faire face à une répression féroce et meurtrière. Le Préfet de police de Paris, Maurice Papon, a assuré ses troupes qu’elles seront couvertes. Il faut tenir les ponts et empêcher aux Algériennes et aux Algériens d’accéder au centre de Paris en mobilisant pour cela des «unités et armes de guerre» selon l’historien Emmanuel Blanchard. Sont engagées les «Forces de police auxiliaire» (FPA), directement venues d’Algérie, 24 pelotons de gendarmes mobiles, deux compagnies de CRS, 1650 « gardiens de la paix », les équipes spéciales de districts, les gardiens en poste dans les quartiers concernés.
Entre 18h et 23h, dans différents quartiers de Paris, on tire sur les Algériennes et les Algériens. Jeté·es à la Seine, la mort par noyade leur est réservée. La jeune Fatima Bedar, collégienne de 15 ans, avait rejoint la démonstration cartable au dos. Son corps est retrouvé dans le canal de Saint-Denis le 31 octobre.
S’y ajoute la rafle la plus massive depuis celle du Vel’ d’Hiv’ en 1942. Les cars de la RATP sont réquisitionnés. Entre 12 000 et 15 000 Algérien·nes sont arrêté·es et parqué·es dans la cour de la Préfecture de Police de Paris, dans des lieux réquisitionnés comme le Parc des expositions de Vincennes, le Palais des sports porte de Versailles ou le Stade Pierre de Coubertin à la lisière de Boulogne-Billancourt. Les blessé·es, laissé·es sans soins, y sont frappé·es sans ménagement à coup de «bidule», la longue matraque en bois des policiers dont certaines se brisent sous les coups en même temps qu’elles fracassent les crânes.
Le photo-reporter Elie Kagan couvre la manifestation et sa répression : les clichés pris ce soir-là montrent le sang sur les visages algériens, les marques des coups sur leurs corps.
La Préfecture de Police annoncera un bilan officiel de 3 morts.
Caractère typique des répressions coloniales : comme à Sétif, Guelma et Kherrata en 1945 dans le constantinois algérien, des civils s’improvisent ce soir-là auxiliaires de police.
Pionnier de la recherche sur le 17 octobre, Jean-Luc Einaudi établira une liste de 389 noms de nord-africain·es, essentiellement algérien·nes, mort·es ou disparu·es en région parisienne pour le seul automne 1961. Même s’il prend place dans un maëlstrom de violence criminelle, le 17 octobre en est bien le point central : s’il est quasi impossible d’en définir le chiffre exact, celles et ceux qui y ont perdu la vie sous les coups et les tirs des « forces de l’ordre » sont véritablement les victimes d’un massacre colonial.
S’y ajoutent, parmi les arrêtés le 17 octobre, environ un millier d’Algériens renvoyés.
« dans leur douar d’origine» (dans l’Algérie coloniale, le douar est la division administrative rurale), en réalité livrés aux militaires à leur arrivée et internés dans des camps. Pour certains, identifiés comme militants FLN, promis à une mort certaine.
La grande presse relaie le mensonge d’État, allant jusqu’à imputer les violences au FLN. Seules quelques minorités syndicales et politiques de gauche dénoncent dans les jours qui suivent la répression raciste du 17 octobre.
Quelques semaines après le 17 octobre, la journaliste Paulette Péju publie Ratonnades à Paris, reportage sur la manifestation et sa répression. Le livre est saisi à l’imprimerie.
Le réalisateur Jacques Panigel entame dès le lendemain de la manifestation le montage d’un film documentaire qui deviendra Octobre à Paris, censuré dès sa sortie en 1962 et dix années durant.
Pour parler du massacre du 17 octobre 1961, le grand historien Pierre Vidal-Naquet employa toute sa vie le terme de « pogrom » qu’il jugeait le plus adapté à qualifier les faits.
Les responsabilités
La mémoire du 17 octobre 1961 sera occultée de trop nombreuses années par celle de la répression de Charonne en février 1962 qui fera 9 mort·e·s parmi les manifestant·e·s anti-OAS.
En 1983, l’auteur de polar Didier Daeninckx publie Meurtres pour mémoire dont l’intrigue est centrée autour du 17 octobre 1961. Sans le mentionner explicitement il désigne le Préfet de Police de l’époque comme responsable.
Lors de l’arrivée à Paris de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de décembre 1983, un rassemblement est organisé au pont Saint-Michel en mémoire des morts du 17 octobre.
En 1991, Jean-Luc Einaudi publie, La Bataille de Paris. Enquête historique parue pour le trentième anniversaire du 17 octobre, le livre va être un révélateur et lancer un combat pour la mémoire et l’histoire qui continue encore aujourd’hui.
En 1997, l’ancien Préfet de Police Maurice Papon est jugé pour complicité de crime contre l’Humanité pour son rôle dans la déportation des Juifs.ves de la région bordelaise lorsqu’il était secrétaire général de la Préfecture de Gironde sous l’occupation nazie et le régime de Vichy. Il est condamné l’année suivante. À l’invitation des parties civiles, Jean-Luc Einaudi a témoigné au procès sur l’action de Maurice Papon durant la guerre d’Algérie, précisant ses responsabilités lors du 17 octobre 1961.
Que sait-on aujourd’hui ?
Dans les pas d’Einaudi, la recherche historique a continué. Au-delà de la responsabilité de Maurice Papon, celle du premier ministre de l’époque, Michel Debré, est clairement engagée.
Celui qui fit déporter entre 1962 et 1984 plus de 2000 enfants réunionnais·e·s en Creuse était alors un partisan acharné de l’Algérie française. Proche des « ultras » d’extrême droite, à l’automne 1961 il s’acharnait à promouvoir un hypothétique projet de « partition » de l’Algérie où le littoral resterait colonie française. La guerre faite au FLN en métropole, culminant avec le massacre du 17 octobre, doit aussi être comprise en ce sens : jusqu’au-boutiste, le colonialiste Debré continue de vouloir mater le camp indépendantiste. Même s’il faut tuer des manifestant·e·s pacifiques.
Après des années de mensonge et de déni, la reconnaissance d’État est tardive et toujours silencieuse sur ses responsabilités réelles. Le 17 octobre 2012, le président François Hollande fait un très bref communiqué : « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. »
Qui a tué ? Qui a donné les ordres ? Pourquoi ? Quels sont les faits matériels qui constituent cette « sanglante répression » ?
Ces omissions volontaires, ces atermoiements politiques sont une concession faite à la droite et à l’extrême droite. Depuis des années une véritable campagne réactionnaire et raciste est menée qui vise à dénoncer la « repentance » et valoriser un prétendu « rôle positif » de la colonisation.
Elle va de pair avec la montée en puissance d’une islamophobie désormais assumée au plus haut sommet de l’État. L’imaginaire colonial continue de se manifester dans la vision dévoyée de la laïcité du ministre Blanquer par exemple.
Le rapport de l’historien Benjamin Stora sur la mémoire de la Guerre d’Algérie remis à Emmanuel Macron le 20 janvier 2021 évoque la reconnaissance du 17 octobre 1961. Mais il faut rappeler que la lettre de mission donnée à ce rapport n’évoque que des « actes symboliques » et qu’il ne devrait y avoir « ni excuses ni repentance ». Ce rapport a par ailleurs suscité les critiques des historiens algériens Afaf Zekkour et Noureddine Amara qui y voient un “doux révisionnisme” et la volonté “de (re)faire nation avant de faire histoire”.
Surtout la consultation de nombre d’archives de la guerre d’Algérie continue d’être entravée au nom du « secret défense ».
Mais reconnaître ce qu’il s’est passé le 17 octobre 1961, c’est aussi reconnaître que ce massacre s’inscrit dans une longue série. De celui du camp de Thiaroye au Sénégal en 1944 où des centaines de soldats « indigènes » sont tués par l’armée coloniale française. De celui de Mé 1967 en Guadeloupe qui fit 87 mort·e·s. Comme de bien d’autres.
Que le racisme d’État, bel et bien hérité du colonialisme, est encore une réalité en France aujourd’hui même.
C’est ce qu’ont rappelé les mobilisations contre les violences et crimes policiers appelées par le Comité vérité et justice pour Adama Traoré à l’été 2020.
C’est ce qu’a rappelé en 2020, l’Acte 3 de la marche des sans-papiers partie le 19 septembre de plusieurs endroits en France pour arriver à Paris précisément le 17 octobre « en hommage à toutes les victimes du colonialisme, du racisme et des violences de la police, en hommage à toutes les victimes des politiques anti-migratoires et des contrôles au faciès. »
La reconnaissance pleine et entière du 17 octobre 1961 comme massacre colonial et crime d’État est une nécessité historique et politique et doit être mentionnée clairement et sans ambiguïtés comme telle dans les programmes scolaires.
Les archives de la Guerre d’Algérie et celles du 17 octobre 1961 doivent être ouvertes sans restrictions d’aucune sorte et leur accès facilité.
Des mesures de réparations, symboliques comme matérielles, doivent être prises en direction des victimes du 17 octobre 1961, de leurs familles et descendant·e·s.
Pour aller plus loin :
➜ Sorj Chalandon, « Il y a du sang dans Paris », récit publié dans Libération des 12 et 13 octobre 1991, en ligne sur le site histoirecoloniale.net
➜ Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris. 17 octobre 1961, Seuil, 1991
➜ Jim House, Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État, la mémoire, première édition 2008, réédition Folio Histoire 2021
➜ Marcel Péju, Paulette Péju, Le 17 octobre des Algériens, La Découverte, 2011 (rédigé à l’été 1962)
➜ Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens, Le passager clandestin, 2021 (première édition sous le titre La Bataille d’Einaudi en 2015)
➜ Olivier Le Cour Grandmaison, Le 17 octobre 1961, un crime d’Etat à Paris, Paris, 2001
Romans :
➜ Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire, Gallimard, 1983
➜ Leïla Sebbar, La Seine était rouge, première édition 1999, réédition Babel, 2009
Films :
➜ Yasmina Adi, Ici on noie les Algériens, long métrage documentaire, 90 minutes, 2011
➜ Daniel Kupferstein, 17 octobre 1961, dissimulation d’un massacre, moyen métrage documentaire, 55 minutes, 2001
➜ Mehdi Lallaoui, Le Silence du fleuve, moyen métrage documentaire, 52 minutes, 1991
➜ Alain Tasma, Nuit noire, long métrage de fiction, 108 minutes, 2004
➜ Page dédiée du site internet du Musée de l’histoire de l’immigration, « Histoire et mémoires de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris ».